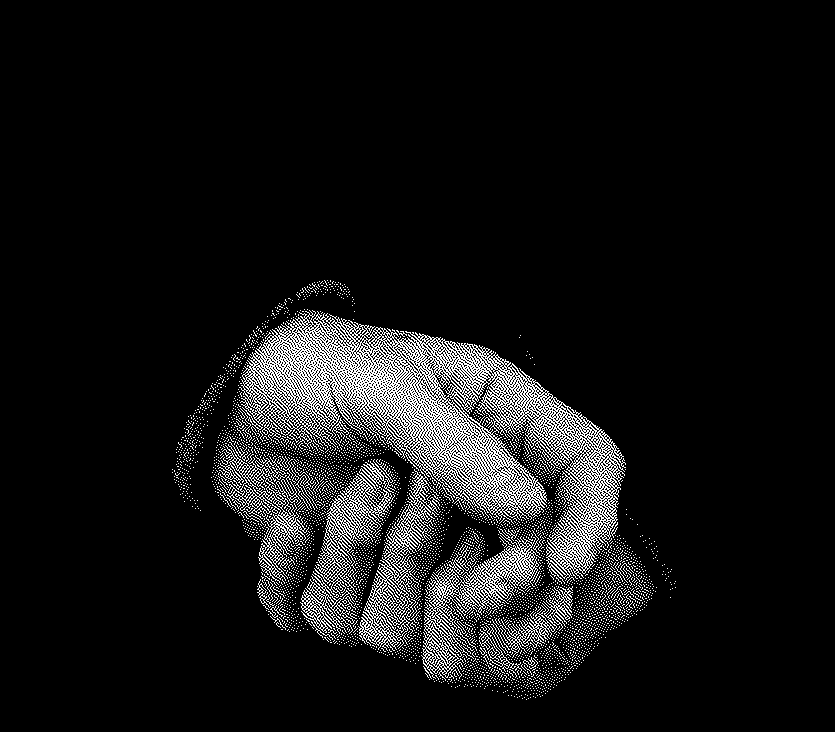Entretien réalisé par Catherine Vincent, journaliste indépendante
Le débat autour de la fin de vie a repris mi-avril en commission à l’Assemblée avec deux propositions de loi distinctes sur les soins palliatifs et l’« aide à mourir ».
Dix mois après l’interruption du débat sur le projet de loi du gouvernement, du fait de la dissolution, ces deux textes sont un quasi copié-collé du texte initial, dans l’état où il se trouvait au terme de deux semaines d’amendements. Où en est le débat qui reprend ? Les arguments des opposants ont-ils bougé ? Le député Olivier Falorni, qui porte le second texte sur l’aide à mourir, revient ici sur les enjeux de cette nouvelle séquence avant le débat dans l’Hémicycle qui commencera le 12 mai.
Les députés avaient notamment décidé de créer un droit à une aide à mourir conditionné à cinq critères : être âgé d’au moins 18 ans ; être français ou résider en France ; être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ; être affecté par une « souffrance physique ou psychologique » réfractaire aux traitements ou insupportable causée par une « affection grave et incurable, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale ». Une définition de la condition liée au pronostic amendée par les députés puisque le texte initial du gouvernement prévoyait que ce pronostic vital soit engagé « à court ou moyen terme » : sur la terminologie pertinente en l’espèce, et sur les conditions strictes d’accès à l’aide à mourir, où en est le débat qui reprend ? Les arguments des opposants ont-ils bougé ?
Un sujet précis promet des délibérations riches pour les semaines à venir : qui accomplira le geste létal ? Suicide assisté, ou bien euthanasie par un tiers ? La discussion a déjà été précisément travaillée par les citoyens de la Convention citoyenne sur la fin de vie autant que par les parlementaires, comme La Grande conversation l’a déjà retracé ici, suggérant de garder pour boussole essentielle d’intelligence collective que l’auto-détermination du mourant soit toujours intégrale – quelle que soit la main qui accomplit sa volonté substantielle exprimée. Un amendement en ce sens, adopté mi-avril par la commission des affaires sociales, ouvre effectivement au patient la possibilité de ce choix de l’effecteur, mais promet des débats polarisés dans l’Hémicycle.
Le député Olivier Falorni (apparenté MoDem), qui était rapporteur général du texte du gouvernement il y a un an et qui porte aujourd’hui la proposition de loi sur l’aide à mourir, revient ici sur les enjeux de cette nouvelle séquence avant le débat dans l’Hémicycle prévu pour débuter le 12 mai.
Le fait que ces deux textes donnent lieu à un même vote solennel suffit-il à vous rassurer sur la « manœuvre dilatoire » que constitue selon vous cette scission ?
Catherine VincentJe n’étais pas favorable à la scission en deux du texte initial car je considère que l’accompagnement de la fin de vie doit reposer sur deux piliers qui ne s’opposent pas mais qui se complètent et s’équilibrent.
D’une part sur les soins palliatifs qui sont la réponse primordiale. Et d’autre part sur l’aide à mourir qui constitue un ultime recours.
À défaut d’un texte unique, j’ai demandé alors publiquement que ces deux textes soient débattus « maintenant et en même temps », ce qu’a accepté le Premier ministre et son gouvernement.
Les auditions ont donc commencé dès le mois de mars et elles ont été communes aux deux textes (très souvent à la demande des intervenants qui voulaient parler des deux), il y a aussi eu une discussion générale commune en commission, et il en sera de même en séance publique. Et il y aura en effet un vote solennel, le même jour, à la même heure, quasi simultanément, sur les deux propositions de loi.
Le fait qu’elles soient indissociablement liées rendra en effet encore plus inacceptable toute manœuvre dilatoire car si des députés devaient se livrer au médiocre jeu de l’obstruction parlementaire, faute d’avoir su convaincre leurs collègues par des arguments, ils prendraient une double et lourde responsabilité : celle d’empêcher le débat parlementaire d’aller jusqu’au bout et de nous priver de vote sur les deux textes. Ce serait particulièrement grave.
Olivier FalorniAu-delà de la division du projet initial en deux textes, les conditions du débat ont-elles changé depuis son interruption en juin dernier ?
Catherine Vincent
Les travaux en Commission des affaires sociales ont montré que le débat avait encore progressé en termes de maturité, de densité et donc de qualité.
Les différents acteurs de la discussion publique sur le sujet en maîtrisent désormais parfaitement tous les enjeux et je m’en réjouis. Les auditions que nous avons menées en mars et avril l’ont amplement démontré par la qualité des analyses et des prises de position des intervenants, dans un climat toujours respectueux et apaisé.
Il en a été de même lors de l’étude du texte et de ses différents articles. J’ai pu observer et entendre des députés qui avaient beaucoup réfléchi et travaillé sur cette proposition de loi, avec la responsabilité de devoir être à la hauteur du sujet, tant sur le fond que sur le ton.
Tout cela n’est d’ailleurs pas étonnant, car jamais une grande loi de société n’a été autant concertée, analysée, discutée, débattue en amont que celle-ci.
Après tous les aléas et retards que cette loi a subis (reports, dissolution, censure…), il est donc vraiment temps que le Parlement se prononce.
Olivier Falorni
Au fil de ces retards, les sujets qui suscitent l’opposition contre l’aide active à mourir (AAM) ont-ils évolué, les arguments ont-ils changé ?
Catherine Vincent
Non, les arguments des opposants n’ont pas changé.
Je les écoute toujours avec attention car toutes les convictions sont intéressantes et profondément respectables dans la mesure évidemment où elles sont respectueuses des autres.
Légiférer sur la fin de vie exige en effet de l’humilité. L’humilité d’écouter avant de décider. L’humilité de ne pas prétendre avoir la vérité. L’humilité d’avoir des convictions mais pas de certitudes. Mais cela nécessite aussi de la volonté. La volonté de faire plus et de faire mieux pour les malades et leurs proches.
Je me réjouis que le débat parlementaire soit jusqu’à présent parfaitement digne et respectueux. Il n’y a aucune raison pour qu’il ne le reste pas.
Olivier Falorni
En 2024, une partie du débat s’est concentrée sur la notion de pronostic vital « à court ou moyen terme » comme condition d’accès à l’aide à mourir, terminologie finalement remplacée par les termes « en phase avancée ou terminale ». Pensez-vous que le sujet fera de nouveau problème ? De nouveaux éclairages, en particulier ceux attendus de la Haute autorité de santé, permettent-ils de mieux cadrer la discussion ?
Catherine Vincent
Le débat sur la notion de pronostic vital « à court ou moyen terme » ou « en phase avancée ou terminale », repose sur deux approches différentes.
La première s’appuie sur la prédiction du temps qu’il reste à vivre. Tous les professionnels de santé, qu’ils soient pour ou contre cette loi, nous ont dit que c’était rigoureusement impossible au-delà de quelques heures ou jours (c’est-à-dire le court terme). « Nous sommes médecins, pas devins », avons-nous souvent entendu.
La seconde approche s’appuie au contraire sur l’évaluation de l’état clinique du malade, pour reprendre les termes de l’Académie nationale de médecine. Nous utilisons donc la notion de « phase avancée ou terminale » qui figure dans la loi Leonetti de 2005, dans la loi Claeys/Leonetti de 2016 et dans le document d’information du Ministère de la santé, publié en 2023 pour définir l’aide active à mourir. C’est cette seconde approche que j’ai défendue et les députés l’ont validée à deux reprises par leurs votes, en commission spéciale puis dans l’Hémicycle.
La Haute autorité de santé (HAS) a été sollicitée par le Gouvernement sur ce point en avril 2024 et elle devrait rendre son avis prochainement. Sans en connaître le contenu, je ne vois pas comment elle pourrait infirmer l’impossibilité évidente d’établir un critère temporel fiable et aller ainsi à l’encontre de ce qu’a choisi le législateur.
Olivier Falorni
Parmi les opposants au texte sur l’aide à mourir tel qu’il se présente aujourd’hui, certains craignent une possible extension de ce droit au-delà des « conditions strictes » telles qu’elles sont actuellement définies, et ils vont jusqu’à en déduire le risque, dans un contexte de dégradation des systèmes de soin et d’extrémisme politique, de pousser les plus vulnérables vers la sortie – pour des raisons notamment économiques. Que leur répondez-vous ?
Catherine Vincent
Ma proposition de loi définit précisément des conditions strictes pour accéder au droit à une aide à mourir. Ce texte ne s’inspire d’aucun « modèle étranger » en particulier et il a vocation à incarner une voie française dans l’accompagnement de la fin de vie.
J’entends beaucoup de fake news sur les très nombreux pays qui ont déjà légiféré ou dépénalisé. Je ne suis pas forcément en accord avec toutes ces législations, par nature différentes, mais je constate que dans tous ces pays, qui sont tous des Etats démocratiques, les lois sur l’aide active à mourir sont très majoritairement soutenues par leurs peuples et il n’est nulle part envisagé de les abroger.
Ce n’est donc pas l’abomination que certains nous décrivent et, à ma connaissance, les citoyens de ces nations ne sont pas moins éclairés et civilisés que nous !
J’ai lu aussi certaines études à prétention scientifique qui se révèlent très largement erronées. Je pense par exemple à la note de la Fondapol sur le Canada, qui a été méticuleusement et scrupuleusement démentie, point par point, par l’excellente étude que vous avez publiée : Fin de vie : erreurs et errements de la Fondapol. Cette étude pointue est absolument remarquable et j’invite tout le monde à la lire !
Olivier Falorni
On repère un autre argument qui monte, adossé au débat sur la distinction entre suicide assisté et euthanasie : l’idée que l’aide à mourir entrerait en contradiction avec la politique publique de lutte contre le suicide.
Catherine Vincent
Concernant l’argument qui voudrait qu’un droit au suicide assisté détruirait la politique publique de prévention du suicide, je m’inscris en faux et je répondrai en citant le rapport de l’Observatoire national du suicide qui a été publié en février 2025 par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) qui écrit ceci : « On ne semble pas observer des effets de « report » des suicides vers les dispositifs d’aide à mourir dans les pays où ceux-ci ont été légalisés ou autorisés par la jurisprudence. Lorsque l’AAM existe, toutes les demandes de mort sont loin d’aboutir, et, dans certains cas, la possibilité de recourir à l’AAM permet un début de prise en charge du mal-être, ouvrant une perspective -certes contre-intuitive– de prévention du suicide. »
Est-il par ailleurs nécessaire de rappeler que l’aide à mourir s’adresse uniquement à des malades en fin de vie, atteints d’une affection grave et incurable, engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale.
Assimiler l’aide à mourir à l’encouragement au suicide est donc particulièrement spécieux et même scandaleux.
Olivier Falorni
Quelle est la position des soignants sur l’aide à mourir ?
Catherine Vincent
On lit un peu partout qu’il y aurait une « opposition massive des soignants ». Cette idée s’appuie sur la contre-vérité d’une pétition de 800 000 soignants qui n’a jamais existé.
Le président de l’Ordre national des médecins a indiqué lors de son audition récente à l’Assemblée nationale qu’un tiers y était déjà favorable, ce qui est très loin d’un rejet massif !
La Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne (FEHAP), qui est tout sauf une association militante, a publié en novembre 2022 une enquête particulièrement détaillée. Elle indique que 33 % des médecins seraient satisfaits d’une telle loi et qu’au total 67 % des soignants y seraient favorables.
On est donc bien loin des caricatures que l’on veut nous présenter et nous imposer.
Je rappelle enfin que cette proposition de loi prévoit une clause de conscience pour tous les médecins et les infirmiers.
C’est en effet une loi de liberté qui ne remet nullement en cause la liberté des autres, qu’ils soient malades ou soignants. Oui, c’est une loi de liberté, celle de disposer de sa mort, à l’image de la liberté de disposer de son corps que nous avons sanctuarisée dans notre Constitution. C’est aussi une loi d’égalité, qui permettrait de ne plus avoir à s’en remettre à la clandestinité ou à l’exil pour éteindre la lumière de son existence.
Et c’est enfin et peut-être surtout une loi de fraternité, pour accompagner chacune et chacun jusqu’au bout du chemin, conformément à ses choix et à sa volonté.
C’est là tout le sens de mon engagement.
Olivier Falorni