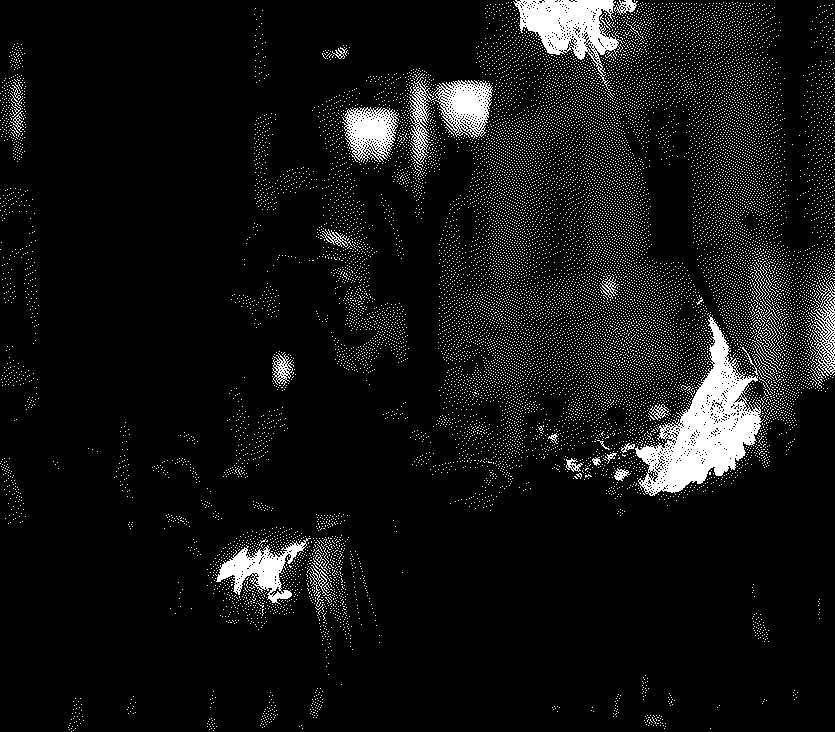La note de Marc-Olivier Padis, « A la recherche des droits culturels », publiée par Terra Nova, en 2024 interroge le peu de « portée pratique » des droits culturels dix ans après la loi NOTRe. Le temps a passé mais, depuis dix ans, le constat n’a guère changé : la politique culturelle n’a pas donné corps aux droits culturels ; elle n’a pas pris en considération la loi, ou plutôt les quatre lois, faisant référence aux droits culturels1 . De facto, elle s’est, seulement, contenté de faire valoir des arguments d’intérêt général en écho aux attentes de « ses » seuls acteurs professionnels.
Or l’actualité budgétaire voit s’effondrer la légitimité de l’argumentaire qui, jusqu’à présent, était apparu suffisant pour justifier des dépenses « culturelles » publiques et protéger l’indépendance des professionnel.le.s des arts. D’ailleurs, les récentes déclarations du Rassemblement National 2 indiquant sa volonté d’aider le secteur artistique sous condition qu’il mobilise des artistes nationaux, ne laisse plus aux progressistes qu’une seule issue : refonder le plaidoyer de la politique culturelle en l’appuyant sur le seul référentiel que la droite extrême ne peut accepter, à savoir celui du respect de l’universalité des droits humains fondamentaux, et, donc, celui des droits culturels des personnes. Autant dire que ce n’est pas le moment de disqualifier les lois sur les droits culturels.3
Je voudrais, d’abord, montrer que Marc-Olivier Padis a construit sa critique sur une interprétation partielle du corpus des droits culturels, puis plaider le retour aux valeurs des droits humains fondamentaux pour encadrer, au moins, trois chantiers aussi utopiques qu’expérimentaux de politique de droits culturels que je soumettrai à l’attention de Terra Nova.
Trois absences
Je propose de repartir à « la recherche des droits culturels » mais sur une autre piste que celle de Marc-Olivier Padis. Sa critique s’inscrit dans les paradigmes habituels de la politique culturelle à la française et, par conséquent, elle oublie trois références fondamentales pour saisir la portée politique et pratique des droits culturels.
1) Le premier texte de référence provient du « Comité des droits économiques, sociaux et culturels », à l’ONU. Ce comité, composé de 18 experts indépendants, est chargé de surveiller l’application du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels (PIDESC-1966). En 2009, le Comité a pris ses responsabilités en matière de droits culturels en explicitant la signification et la portée de l’article 15 du PIDESC relatif au droit de participer à la vie culturelle. Il a rédigé un texte de 19 pages, connu sous le nom d’« Observation générale 21 »4. Ce texte n’a pas de portée juridique ; de surcroît, il ne parle pas le langage commun des acteurs « culturels » français. Pour autant, on ne peut l’ignorer puisqu’il permet aux parties prenantes du PIDESC, dont la France, de prendre la mesure des engagements à respecter en matière de droits culturels.
2) Le deuxième texte de référence qui manque à l’appel concerne une préoccupation majeure pour les professionnels des arts : la protection de la liberté artistique. Il s’agit du rapport de Farida Shaheed, Conseillère spéciale dans le domaine des droits culturels, à l’ONU, qui explicite, en 2013, les multiples retombées concrètes du « droit à la liberté d’expression artistique et de création »5 dans le cadre des droits humains fondamentaux.
3) Le troisième texte concerne le patrimoine. Il est déterminant pour concrétiser les droits culturels des personnes. Il est, pourtant, absent alors qu’il est issu du Conseil de l’Europe dont la France fait partie. Il s’agit de « la Convention de Faro sur la valeur du patrimoine culturel pour la société » (2005)6. Ce texte propose aux européens de repenser leur conception du patrimoine commun en prenant en considération toutes les personnes qui veulent apporter les richesses de leur passé à la culture européenne. Ici, les droits culturels appellent à faire, démocratiquement, patrimoine ensemble.
Je commence par la référence à l’Observation générale 21. Le sens des droits culturels qui y figure se retrouvera, ensuite logiquement, dans les deux autres textes.
Culture-catalogue versus Culture-processus
L’Observation générale 21 est un document d’interprétation du « droit de prendre part à la vie culturelle » comme droit humain fondamental. On sait qu’il a été largement influencé par la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels de 20077. Le militantisme intellectuel mobilisé autour de Patrice Meyer-Bisch a trouvé écho auprès du Comité des droits économiques sociaux et culturels. On doit considérer, alors, que l’Observation générale 21 est un texte « autorisé », au sens où le Comité a veillé à garantir la compatibilité de son interprétation avec les principes fondamentaux de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.
Dès les premières lignes de l’Observation générale 21, on constate un grand écart entre l’approche des droits culturels et celle de la politique culturelle en France. Les mots ne sont pas les mêmes, les valeurs de référence sont différentes et les programmes d’action n’ont pas grand-chose à voir entre eux.
On peut s’en rendre compte sur le point crucial de la définition de la culture. Dans la politique publique de la culture que nous connaissons en France, la culture se présente comme un catalogue d’objets de valeur, liés à l’art d’hier ou d’aujourd’hui.
A l’inverse, la définition de ce qui vaut « culture » pour l’Observation générale 21 ne se focalise pas sur des objets particuliers qui seraient « culturels » par eux-mêmes ; la culture est d’abord comprise comme un processus interactif, toujours en mouvement, qui naît des relations d’humanité établies entre les personnes, entre elles autant qu’avec les autres vivants. Dans cette définition de la culture, le catalogue des « objets culturels » ne saurait, en aucun cas, précéder la relation entre les personnes.
Compte tenu de ce grand écart, faut-il considérer que l’opposition entre ces approches est frontale et en déduire que promouvoir l’une conduira à éliminer l’autre, comme le craignent les acteurs qui ont dénoncé les dangers des lois sur les droits culturels ? Faut-il plutôt accepter que les droits culturels comme « processus » se satisfassent, comme l’a observé Marc-Olivier Padis, d’une place modeste concédée par la politique culturelle « catalogue », dans une sorte d’arrangement léonin entre les intérêts des uns et des autres ?
Pour ma part, j’ai constaté, depuis plus dix ans, l’impasse de ces deux positions. Une autre interprétation de l’écart entre les deux conceptions de la culture est nécessaire : ni soumission des droits culturels à l’ordre culturel établi ni, à l’inverse, grand remplacement par les droits culturels des acquis de la politique culturelle.
Interpréter l’écart entre idéologie culturelle et utopie des droits culturels
Pour tenter cette autre interprétation des tensions entre les deux approches de la responsabilité culturelle publique, je voudrais m’inscrire dans le cadre proposé par Paul Ricoeur quand il analyse les relations entre l’idéologie et l’utopie.
Il n’est pas bien difficile d’établir que l’approche de la culture comme catalogue d’objets relève de l’idéologie. On retrouve les trois dimensions évoquées par Ricoeur 8de distorsion de la réalité, de domination de l’autorité et d’intégration au collectif. Distorsion du réel quand on affirme qu’une administration d’État détient le pouvoir suprême de sélectionner des objets qui, pour l’humanité entière, devrait avoir une valeur universelle d’œuvres de l’art et de l’esprit, comme on le lit dans chacun des décrets instituant le ministère de la culture en France 9. Domination quand on légitime le pouvoir des personnes, réunies en « académies invisibles » délibérant en secret pour établir la liste de ces « objets- œuvres d’art ». 10 L’arbitraire des choix est ainsi caché par arrêté ministériel ou municipal sans que la vie démocratique ne s’en émeuve. Intégration puisque l’idéologie de la culture- catalogue appelle tous les humains à profiter des bienfaits des œuvres sélectionnées par quelques-uns. « L’accès à la culture pour tous » continue de fleurir dans les politiques culturelles pour inciter chaque individu à s’élever au-dessus de sa condition médiocre en fréquentant le meilleur des arts de l’humanité.
La fermeture idéologique est là : n’importe quel « service culturel » de collectivité annonce qu’il porte des « actions culturelles », en faisant référence au « contenu culturel » de ces actions mais la définition de ce qui vaut ainsi « culture » est fixée sans égard pour les personnes qui participent à ces actions ! On les nomme, d’ailleurs « publics » pour signifier que, dans cette idéologie, elles ont tous les droits de « prendre part » sauf celui de qualifier ce qui a valeur de « culture » pour elles et pour l’humanité.
Cette idéologie culturelle organise, ainsi, la « légitimation de ce qui est » ; elle est en somme « pétrifiée », faite pour « préserver l’identité d’un groupe ».11
Dès lors, si l’on cherche les droits culturels, il faut les trouver ailleurs que dans cette idéologie culturelle ; il nous faut « regarder ailleurs » du côté de l’utopie d’une autre conception de la valeur de la culture pour l’humanité. C’est ce qui a manqué à l’article de Marc-Olivier Padis. Détaillons.
Chercher ailleurs, du côté de l’utopie des droits humains de l’humanité
Cet ailleurs est consigné dans le corpus des droits humains fondamentaux ; c’est celui « d’un monde où tous les êtres humains seraient libres et égaux, sans distinction » (DUDH). Les droits culturels appartiennent à cette Déclaration de l’idéal commun qui énonce une utopie qui veut marquer la résistance nécessaire aux dégradations que l’espèce humaine fait subir à elle-même et au monde des vivants.
Si l’on recherche les droits culturels dans leur rapport à l’humanité, on les trouve là : dans l’utopie d’une Communauté humaine qui croit à ce minimum de valeurs universelles qui la constituent : dignité, liberté, égalité, raison, conscience, fraternité.12 Une utopie fondée sur une éthique de l’humanité, toujours inaccomplie, toujours à conquérir, d’autant plus qu’elle semble devenir improbable aujourd’hui. Ce cadre d’interprétation utopique étant posé, il devient possible de saisir ce qu’il faut entendre par « culture » pour cette Communauté humaine à faire advenir ensemble.
La définition de la « culture » cohérente avec cette utopie figure dans l’Observation générale 21, dans la droite ligne de la Déclaration de Fribourg de 2007. Le point 12 l’énonce ainsi : « La culture est un processus interactif par lequel les personnes et les communautés, tout en préservant leurs spécificités individuelles et leurs différences, expriment la culture de l’humanité. » Avec les droits humains fondamentaux, la personne fait culture avec les autres quand, et seulement quand, elle s’exprime de manière à faire humanité avec les autres.
L’utopie des droits culturels et le devoir de faire humanité ensemble
L’utopie des droits culturels est ouverte : elle accorde le droit à chaque personne d’être reconnue dans son expression du « monde », avec sa langue, ses pratiques, ses symboles et ses rêves. Chaque être humain est présent avec ses manières de vivre son humanité et d’interagir avec les autres, humains aussi bien qu’autres vivants. D’ailleurs, l’Observation générale 21 ne manque pas de le rappeler.13 Par exemple, l’expression de l’humanité de la personne passe par « les méthodes de production ou la technologie, l’environnement naturel et humain, l’alimentation »…La langue, les arts, les symboles, la fiction, le sensible interviennent tout autant, dans les processus d’interaction. De même, les expressions religieuses peuvent faire partie de la culture. Mais, dans tous les cas, les expressions des personnes, religieuses ou non, ne peuvent porter en elles la haine, la destruction, la perte d’humanité des autres personnes.
La nécessité est absolue que ces expressions des personnes soient des apports à l’humanité des autres.
Autrement dit, la culture s’évanouit si l’expression d’une personne étouffe la raison d’une autre, ignore sa conscience, renonce à vivre « dans un esprit de fraternité », ne garantit pas l’égalité des dignités et des libertés ! La culture des droits culturels est ouverte à tous mais sous la nécessité que les expressions des personnes s’inscrivent à l’intérieur de ces balises éthiques de l’article 1 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme (DUDH). L’être humain des droits culturels émerge quand ses relations aux autres lui permettent de s’ouvrir une voie vers plus de liberté de choix et une plus large reconnaissance de sa dignité.
Les droits culturels sont, ainsi, à comprendre comme des devoirs de contribuer au progrès de la Communauté humaine pour essayer de toujours faire un peu mieux humanité ensemble.
Utopie des droits culturels : la « Grande conversation » pour faire humanité ensemble
Tirons les premières conséquences de cette utopie des droits culturels des personnes. Certes, le chemin de cette utopie est balisé par les valeurs des droits humains fondamentaux mais les manifestations concrètes ne sont pas fixées à l’avance par une autorité quelconque qui imposerait sa lecture idéologique de ce qui fait culture.
Pour sa part, la juriste Mireille Delmas-Marty14 avait explicité cette idée majeure en évoquant la nécessité pour chaque pratique singulière d’une personne ou d’une communauté d’être universalisable c’est-à-dire compatible avec les valeurs universelles des droits humains fondamentaux. Nul n’est astreint à penser et faire exactement comme les autres du moment que ces valeurs d’humanité soient respectées. Il n’y a pas « d’objets » qui soient « culturels » pour tous les êtres d’humanité. Il y a nécessairement des lectures « régionales » des balises universelles des droits humains fondamentaux. En revanche, nul ne peut revendiquer de faire partie de la Communauté humaine en s’excluant de ces valeurs, en ayant des pratiques qui ne soient pas considérées comme universalisables après discussion avec les autres. La Communauté humaine ne peut vivre sans se soumettre à la permanence de la critique.
On s’en doute : avec cette utopie, il n’y a pas d’illusion à se faire. Aucune personne, aucune instance collective n’a la clé de cette humanité idéale et donc de cette culture des droits culturels. Le processus qui conduit à la culture de l’humanité est empli de divergences innombrables qui imposent, en permanence, d’en discuter en réponse à la complexité des relations entre les humains, entre eux et avec les autres vivants. On ne peut donc tordre cette réalité en figeant la culture dans des « objets culturels » qui, magiquement, diraient l’humanité en réifiant les personnes qui la constituent !
Le chemin des droits culturels que l’on recherche devient, alors, inséparable de la démocratie : il va bien falloir discuter de ce qui est acceptable ou non au regard de l’éthique des droits humains fondamentaux. La démocratie par la discussion doit pouvoir être partout présente, selon des modalités facilitant « le débat public, ouvert et documenté »15. Avec les droits culturels, comme droits et devoirs d’exprimer son humanité aux autres, le centre des préoccupations de la politique culturelle est la permanence de cette « grande conversation » sur nos capacités à nouer des relations d’humanité ; la démocratie par la discussion s’impose pour que chaque personne puisse plaider la dimension universalisable de ses présences au monde, réelles ou imaginées.
Autrement dit, il y a toujours matière à discuter de l’atterrissage des valeurs universelles dans le quotidien de nos regards et de nos pratiques dans notre « monde » de terriens ! Il y a toujours l’espoir que la discussion réduira les écarts et leurs tensions ; il y a toujours la croyance que le moment de la guerre sera retardé et que la conciliation et la coopération adviendront pour faire un peu moins mal humanité ensemble. Les droits culturels sont là pour ouvrir les chemins de la discussion sur nos capacités collectives à faire culture ensemble.
La spirale de l’idéologie culturelle et de l’utopie des droits culturels
On peut, alors, mieux apprécier les relations entre l’idéologie de la culture-objets et l’utopie des droits culturels. Comme le souligne Ricoeur, les relations entre idéologie et utopie prennent la forme d’une spirale sans fin où l’une alimente l’autre : « L’idéologie est, en fin de compte, un système d’idées qui devient obsolète parce qu’il ne peut venir à bout de la réalité présente alors que les utopies sont salutaires uniquement dans la mesure où elles contribuent à l’intériorisation des changements. »
Tel se dessine l’interprétation qui permet de trouver les droits culturels là où l’idéologie de la culture ne les cherchait pas : l’utopie des droits culturels est prise de parole critique tant il est vrai que « le concept d’utopie est un outil polémique ; il appartient au champ de la rhétorique »16. Les droits culturels, comme toutes les utopies « tentent d’exercer le pouvoir autrement qu’il ne s’exerce » ; avec eux, la relation culturelle comme relation d’humanité, dans son ambition d’universalité, est toujours à interroger. Chaque personne a la légitimité de « regarder ailleurs », d’expérimenter, de critiquer certitudes et fermetures de l’idéologie culturelle.
Idéologie et Utopie vont, donc ensemble en façonnant une spirale qui oscille du conformisme endormi aux innovations imprévues… et qui ne manque jamais de faire retour sur des compromis qui enferment, avant de nouveaux assauts utopiques. Avec les droits culturels pour faire humanité ensemble, la spirale idéologie / utopie est posée comme enjeu démocratique, toujours à activer du moment qu’il soit balisé par les valeurs d’humanité. L’utopie des droits culturels se joue là, dans cette capacité à déployer la démocratie par la discussion dans toutes les sphères de la vie des personnes.
On pourrait penser que cette utopie est fantasmagorie, mais c’est loin d’être le cas car, au quotidien, les lieux de discussion entre personnes en tension sont innombrables.
Les droits culturels : la démocratie au quotidien pour faire humanité ensemble
Il y a, partout, dans notre société, des dispositifs d’écoute des écarts, des instances diverses cherchant à éviter les conflits. Ici ou là, on essaye de colmater les brèches, d’arranger les choses, d’arrondir les angles… Dans le métro, le bus, les commerces, les entreprises, les mairies ou ailleurs, on voit des médiateurs et médiatrices très visibles. Ajoutons la vie associative la plus ordinaire quand elle conduit les personnes (on dit quelque fois les « citoyens ») à beaucoup discuter entre elles pour se mettre d’accord sur des actions menées en commun. On voit, aussi comment la vie démocratique a fait naître la « Défenseur des droits » ou la « Commission nationale du débat public » pour permettre « l’expression de points de vue argumentés et leur prise en compte par l’ensemble des participants. » On ne peut négliger non plus le « Conseil économique, social et environnemental » et ses équivalents régionaux, très présents sur les territoires… La liste de ces réalités à vocation « arrangeante » semble sans fin, surtout si l’on ajoute les dispositifs mis en place pour répondre à des urgences conflictuelles : « grand débat national » ou « conventions citoyennes »…
L’épreuve de la discussion « pour que ça aille mieux » s’est imposée. Avec, en cas d’échec des conciliabules le recours aux juges appelé à trancher entre le juste et l’injuste, les bon et les mauvais, les innocents et les coupables…
Toutefois, toutes ces présences médiatrices n’ont pas de portée politique. Dans la conception de la démocratie représentative, ces dispositifs n’ont qu’une existence subalterne. L’utopie des droits culturels conduit à renverser cette interprétation : lorsque ces lieux de discussion sont organisés pour faciliter les conciliations, ils sont des espaces concrets où les personnes peuvent, in fine, exprimer leur humanité.
Si tous ces dispositifs répondaient, chacun à sa manière, aux exigences de respect de la liberté et de dignité des personnes ; si, tous, prenaient soin de doter les personnes de capacités effectives de documenter leur position, d’argumenter en raison, de suggérer des renoncements réciproques, on devrait, alors, les considérer comme des dispositifs de démocratie par la discussion visant, au final, à faire, un peu mieux, humanité ensemble.
C’est là un chantier à expérimenter où les droits culturels trouveraient pleinement leur résonance, au sein de la spirale d’humanité qui lie Idéologie et Utopie.
Dès lors, l’idéologie de la culture-catalogue gagnerait à jouer le jeu de la culture-processus : compte tenu de ses faiblesses actuelles, elle aurait bénéfice à accepter de se nourrir de l’utopie critique des droits culturels. Les « programmateurs » ne perdraient pas leur fonction ; ils feraient reconnaître leur valeur d’humanité, même aux personnes qui ne sont pas, et ne seront pas, leur « public ». Manière, pour moi, de dire, que l’enjeu de la démocratie par la discussion est moins la « participation des citoyens » aux actions communes que la reconnaissance de la dignité, de la liberté et de la capacité d’agir, de soi comme des autres.
Voilà donc la réponse à la question sur le peu de consistance pratique des droits culturels : l’utopie des droits culturels prend sens d’abord dans l’interpellation. Elle est résistance et espérance. Elle ne peut que mettre en travail critique les certitudes et croyances de l’idéologie de la culture avec ses objets valorisés hors des personnes mais pour leur bien !
Où trouver les Droits culturels dans le monde des arts ?
Marc-Olivier Padis ne manque pas de souligner le danger que présentent les droits culturels pour le monde des arts. Puisque les personnes ordinaires sont légitimées à revendiquer leur culture, elles vont vouloir imposer leurs choix aux programmateurs et mettre en péril « l’indépendance des artistes et des équipes auxquelles les missions culturelles ont été confiées par la puissance publique. » C’est d’ailleurs pour sanctuariser cette indépendance qu’en 2016, a été adoptée la loi « Liberté de la création, architecture, patrimoine (LCAP). Elle affirme, ainsi, dans son article 1 que « la création artistique est libre. »
Formulée dans ces termes, on retrouve l’idéologie de la culture-catalogue : seuls ces objets d’art dits de « création » ont droit à la liberté. Curieuse liberté qui préfère s’associer aux objets qu’aux personnes. Avec cette idéologie de la création, on ne peut trouver aucune trace positive des droits culturels. Ils sont uniquement perçus comme une menace.
On pourrait s’en satisfaire sauf que cette idéologie de la « liberté de la création » ne tient pas ses promesses. Avec cette loi, les artistes ne sont pas mieux protégés, comme je l’ai montré en détail ailleurs.17
C’est pourquoi je voudrais ouvrir une autre voie fondée sur l’utopie des droits humains fondamentaux. Elle constitue le meilleur plaidoyer pour défendre et promouvoir la vie des arts dans une société noyée par la logique marchande et bousculée par le doute sur ses valeurs. Pour cela, je reprends à mon compte la deuxième référence qui manque à l’argumentation de Marc-Olivier Padis : le rapport à l’ONU de madame Shaheed sur le « droit à la liberté d’expression artistique et de création ».18
La valeur universelle de la liberté artistique
Pour en rester aux points saillants, je retiens d’abord que « la liberté d’expression sous une forme artistique » a une valeur universelle. Elle est clairement consignée dans l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Madame Shaheed rappelle ainsi « toutes les personnes, indépendamment de leur situation particulière ou de leur statut, ont le droit à la liberté d’expression artistique et de création. » 19 La France s’est engagée à défendre et, mieux encore, à promouvoir ce pacte. Pourquoi ne le fait-t- elle pas pour cet article 19 ?
Évidemment, cette liberté de s’exprimer artistiquement ne dit rien de la reconnaissance des expressions qu’elle engendrera en pratique. Pour les spécialistes des arts, elle fera peut-être naître des œuvres artistiques majeures ; à l’inverse, elle aboutira, souvent, à pas grand-chose du point de vue de l’histoire des arts… Nul ne le peut le savoir à l’avance, mais, en tant que liberté, elle est indispensable à la Communauté humaine, car « dans toutes les sociétés, des personnes produisent des expressions artistiques et des créations, les utilisent ou entretiennent des rapports avec celles-ci. »
Ainsi, pointe madame Shaheed, « l’art constitue un moyen important pour chaque personne, individuellement ou collectivement, ainsi que pour des groupes de personnes, de développer et d’exprimer leur humanité, leur vision du monde et le sens qu’ils attribuent à leur existence et à leur réalisation ». Le regard change : les droits culturels sont bien présents positivement dans la vie des arts. Chaque personne devrait être protégée dans son droit à la liberté artistique ; chaque personne devrait être encouragée à apporter son humanité sous forme artistique, même si les spécialistes n’y verront pas, à chaque fois, une miraculeuse « création ».
L’utopie des droits culturels déclenche ces processus diversifiés fondés sur la valeur universelle de la liberté artistique ; à l’inverse, l’idéologie de la création désigne un catalogue d’objets d’art qui prétendent à l’universel mais dont le choix est empreint d’arbitraire et la valeur toujours relative à un contexte.
Une liberté fondamentale spécifique
En deuxième lieu, la liberté d’expression artistique a une spécificité par rapport aux autres libertés. Le rapport Shaheed est ferme sur ce point : les expressions artistiques puisent dans nos imaginaires opaques et ne manquent pas de dérouter les efficacités fonctionnelles qui voudraient s’imposer à la vie collective.
En ce sens, « l’utilisation de la fiction et de l’imaginaire doit être comprise et respectée comme un élément essentiel de la liberté indispensable aux activités créatrices et aux expressions artistiques : la représentation du réel ne doit pas être confondue avec le réel, ce qui signifie, par exemple, que ce que dit un personnage dans un roman ne saurait être assimilé à l’opinion personnelle de l’auteur. »
La dimension spécifique de cette liberté artistique va de pair avec des écarts à la conformité : « Les expressions artistiques et la création font partie intégrante de la vie culturelle ; elles impliquent la contestation du sens donné à certaines choses et le réexamen des idées et des notions héritées culturellement. » Le rapport Shaheed est très net sur cette spécificité : il est impératif de soutenir les libertés artistiques comme antidotes qui dressent des signaux critiques face aux mondes clos.
Cette deuxième facette de la liberté d’expression artistique a donc une forte dimension politique qui impose de mettre en place des dispositifs protecteurs du « droit » aux imaginaires discordants, dans un « monde » trop souvent réduit à des calculs d’efficacité.
La liberté artistique, un enjeu global
En troisième lieu, la protection de la liberté d’expression artistique ne concerne pas uniquement les « artistes créateurs ». Pour madame Shaheed, « les restrictions à la liberté d’expression artistique pèsent sur la société dans sa globalité. » Ainsi, « les obstacles aux libertés artistiques se répercutent sur de nombreuses catégories de personnes dans l’exercice de leurs droits : les artistes eux-mêmes, qu’ils soient professionnels ou amateurs, ainsi que tous ceux qui participent à la création, la production, la distribution et la diffusion d’œuvres d’art. » Le chantier de la liberté artistique ne pourra pas ignorer que, notamment, des « restrictions aux libertés artistiques peuvent viser certaines catégories de la population en particulier. Les femmes en tant qu’artistes ou public sont particulièrement exposées dans certaines communautés. » De même, des « minorités ethniques et religieuses » ou « des personnes handicapées peuvent subir un préjudice particulier lorsqu’elles souhaitent représenter ou exposer leur œuvre. »
Au total, les restrictions à cette liberté ont des effets négatifs sur l’ensemble de la vie commune, dans chaque territoire : « les effets de la censure ou des restrictions injustifiées à la liberté d’expression artistique et de création sont dévastateurs. Ils génèrent des pertes considérables sur les plans culturel, social et économique, privent les artistes de leurs moyens d’expression et de subsistance, créent un environnement peu sûr pour toutes les personnes qui exercent une activité artistique et leur public, étouffent le débat sur les questions humaines, sociales et politiques, entravent le fonctionnement de la démocratie et, bien souvent, empêchent également le débat sur la légitimité de la censure elle-même. » Sans compter que dans de « nombreux cas, la censure est contreproductive en ce qu’elle contribue à faire davantage connaître les œuvres d’art controversées. »
Avec les droits culturels, le chantier de la liberté artistique appelle à la permanence du débat dans une démocratie par la discussion qui ne se réduit pas à l’entre-soi du monde des arts.
Une utopie à faire progresser dans tous les recoins de nos vies
La quatrième facette du rapport Shaheed est de ne jamais oublier les très nombreuses dimensions concrètes de cette liberté artistique en acte.
Par exemple, madame Shaheed évoque la nécessité «d’améliorer le statut social des artistes, en particulier leur sécurité sociale », ou bien, la nécessité de contrôler les logiques marchandes : «Les producteurs culturels et les artistes évoquent l’existence d’une censure par le marché, qui s’exerce en particulier lorsque les industries culturelles privilégient les lois du marché, que les finances publiques sont sous pression et que les possibilités de distribution par d’autres réseaux sont minimes. » Ce ne sont pas les « programmateurs » qui se plaindront de ce rappel à l’ordre de l’utopie de la liberté artistique. « L’appui apporté aux industries culturelles devrait être revu sous l’angle du droit à la liberté artistique. » Il serait effectivement temps de progresser en ce sens.
Madame Shaheed mentionne, aussi, les fréquentes réductions de la liberté artistique qui concernent les usages de l’espace public par les artistes. Une multitude d’interdits, de contraintes de toute sorte, nourrissent l’autocensure, le pire ennemi de ce droit à la liberté artistique, et étouffent les pratiques artistiques dans la cité. On ne compte plus les réglementations inadaptées ou « appliquées de manière incohérente par des mécanismes non transparents, sans possibilité de recours. » De même, la liberté d’expression artistique disparaît quand les pouvoirs publics ne protègent pas les artistes « contre toute violence exercée par des tiers. »
Bien sur, le rapport insiste sur le respect des droits d’auteurs comme sur l’obtention plus aisée de visas pour les artistes étrangers ou le déploiement de l’enseignement des arts. Il rappelle, de même, la nécessité d’un environnement urbain sûr pour les pratiques artistiques.
Au total, la liberté d’expression artistique est une liberté que la Communauté humaine ne peut éteindre sans trahir la promesse universelle de l’article 1 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH). Tout responsable public ou privé, attachée aux droits de l’homme, devrait s’employer à la faire progresser par la mobilisation contre les obstacles qui en réduisent l’exercice. Elle est, par son utopie même, un aiguillon critique de l’idéologie culturelle qui s’autosatisfait de la « création », de « l’accès à la culture pour tous » ou de « l’action culturelle », en minorant, ainsi, le droit à la liberté de chaque personne de faire son propre récit du monde, sous des formes artistiques. Elle est le carburant de la spirale idéologie/utopie, du moins pour les personnes qui affirment vouloir contribuer au progrès de la Communauté humaine. 20
Les restrictions à la liberté artistique
Au final, la liberté artistique est universelle au sein de l’utopie éthique des droits humains fondamentaux. En ce sens, elle ne connaît de limites légitimes que dans la nécessité de respecter l’universalité des autres libertés fondamentales.
Le rapport Shaheed rappelle la règle qui s’impose dans ce cadre : aucune des libertés fondamentales mises en avant par les parties prenantes ne pourra se prévaloir d’une supériorité qui étoufferait la liberté d’expression artistique ! Même pas le droit au travail, à l’éducation, ou la protection de l’environnement… ! À l’inverse, la liberté d’expression sous une forme artistique ne sera légitime que si elle ne vient pas supprimer ces autres libertés fondamentales de notre humanité commune.
On retrouve alors le cœur de l’utopie des droits culturels : il va falloir discuter. La responsabilité publique devient de prendre en charge ces interactions contradictoires entre les libertés fondamentales. La démocratie par la discussion est inévitable pour affronter ces libertés rivales. Il est impératif de réguler les écarts entre les porteurs de ces libertés, tous légitimes mais contraints de se concilier, même partiellement, pour faire culture, donc, pour faire humanité ensemble.
Ce cadre nécessaire de négociations n’est pas nouveau. Il a été bien identifié par l’article 19 du PIDCP qui précise qu’exercer sa liberté d’expression artistique « comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales ». En conséquence, « il est possible de concevoir certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;
b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques ».
Le chantier de la protection de la Liberté d’expression artistique est, par conséquent, un chantier permanent qui devrait avoir une place centrale pour la démocratie. On ne peut s’en débarrasser en le renvoyant au juge comme a pensé le faire la loi LCAP.
Ainsi, loin d’être étrangers au monde des arts, les droits culturels sont bien présents en permanence et, en plus, de manière critique, comme toute utopie. Quand on dresse la liste de tous les volets de leurs présences, comme le fait madame Shaheed, on comprend très vite qu’aucune politique publique ne pourra se vanter de trouver des solutions à tous les problèmes. En revanche, en attribuant une valeur universelle à cette liberté au sein des droits humains fondamentaux, l’utopie des droits culturels légitime la mise en place de dispositifs de discussion permanente sur toutes les questions mal résolues. Sur chaque territoire, progresser vers plus d’effectivité des libertés artistiques des personnes nécessite des instances adaptées appréciant les écarts entre l’utopie et la réalité. Une loi ne suffira pas. Mais, sans doute, faut-il se contenter, en urgence, de lancer des expérimentations avec quelques collectivités partenaires, pour alimenter le débat public sur une meilleure protection de la liberté artistique dans un univers politique qui revendique de plus en plus de la mettre au pas. Les droits humains fondamentaux devraient mieux rassembler les résistances.
Où trouver les droits culturels pourvoyeurs du patrimoine de l’humanité ?
La recherche des droits culturels dans le « monde » du patrimoine obéit à la même critique et à la même utopie que précédemment. L’idéologie culturelle a enfermé le patrimoine dans un double carcan : le patrimoine de valeur pour la société est défini par une autorité publique et il porte sur des « objets ». C’est vrai pour le patrimoine classé ou inscrit en France et c’est vrai aussi pour le patrimoine désigné par l’Unesco au titre de la convention de 1972 sur le patrimoine mondial mais, tout autant, au titre de la convention de 2003 sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (PCI).
L’idéologie culturelle est si puissante dans les têtes et les institutions qu’elle est parvenue à officialiser la domination de la personne. Le Patrimoine culturel immatériel est exemplaire : dans la Convention Unesco de 2003, ce sont les personnes qui reconnaissent les « pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire… qui font partie de « leur patrimoine culturel », sauf que ces mêmes personnes et leurs communautés doivent soumettre la valeur de leur patrimoine à l’approbation des Etats ! Les personnes sont sous tutelle : elles doivent d’abord recevoir l’accord des Etats pour pourvoir exprimer leur humanité avec les éléments de leur passé ; leur droit culturel se réduit, au mieux, à devenir public d’un patrimoine décidé sans elles et qui pourtant vient d’elles.21
Difficile alors de trouver les droits culturels dans ces dispositifs patrimoniaux qui ne reconnaissent pas aux personnes la responsabilité de décider ce qui fait patrimoine pour elles et pour les autres êtres d’humanité. La force de l’idéologie est bien de transformer cette tutelle en dogme largement admis et reproduit.
L’utopie des droits culturels ne peut se satisfaire de cette métamorphose de la réalité. Il lui faut donc contester cette interprétation de la valeur patrimoniale pour l’humanité en prenant un autre parti. L’exercice n’est pas bien difficile. Il suffit d’introduire le troisième texte manquant dans le propos de Marc-Olivier Padis : la « Convention cadre sur la valeur du patrimoine en Europe, dite convention de Faro », proposée, en 2005, par le Conseil de l’Europe, actuellement signée par 30 États membres.22 On découvre, alors, que les droits culturels sont au fondement même du patrimoine. C’est un choix de politique publique démocratique qui, notons- le, a été rejeté, sans explication crédible, par les gouvernements français, de droite comme de gauche. Il est d’autant plus important de s’y intéresser.
Je m’en tiendrai ici à quelques points marquants, renvoyant pour plus de précisions au dossier établi par le site de la FAMDT MODAL rassemblant des contributions de membres du réseau Faro francophone.23
La Convention de Faro : le patrimoine comme relations d’humanité
En premier lieu, pour la Convention de Faro, le patrimoine tient sa légitimité des droits humains fondamentaux. La Convention reprend à son compte l’éthique des droits culturels en considérant que chaque personne a droit au patrimoine : elle affirme cette valeur universelle que « toute personne a le droit, tout en respectant les droits et libertés d’autrui, de s’impliquer dans le patrimoine culturel de son choix comme un aspect du droit de prendre librement part à la vie culturelle consacré par la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies (1948) et garanti par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) »24.
Un tel cadre éthique conduit à une conception du patrimoine où la personne est pleinement en responsabilité. Il suffit de lire l’article 2 de la Convention : « Le patrimoine culturel constitue un ensemble de ressources héritées du passé que des personnes considèrent, par-delà le régime de propriété des biens, comme un reflet et une expression de leurs valeurs, croyances, savoirs et traditions en continuelle évolution. Cela inclut tous les aspects de l’environnement résultant de l’interaction dans le temps entre les personnes et les lieux ».
Ce sont les personnes qui qualifient, elles-mêmes, ce qui est une « expression de leurs valeurs, croyances et traditions ». On retrouve, alors, la valeur de reconnaissance de la personne qui fonde l’utopie des droits humains fondamentaux. Le patrimoine culturel de la Convention de Faro ne peut donc se réduire aux objets sélectionnés à dire d’experts par les autorités publiques.
En deuxième lieu, on retrouve, évidemment, avec la Convention, l’exigence éthique qui lie le droit culturel de la personne au devoir de faire humanité avec les autres : la légitimité du patrimoine n’est acceptée que si les personnes partagent le cadre des valeurs communes des droits humains fondamentaux, de l’État de droit, de la démocratie. L’article 2 de la Convention en rappelle le principe : les personnes peuvent, certes, se grouper en « communauté patrimoniale » pour faire valoir ce qu’elles considèrent comme étant leur patrimoine mais uniquement si elles s’inscrivent dans « l’action publique », encadrée par les droits humains fondamentaux et l’État de droit qui leur correspond25. La formulation de l’article 4 fixe, alors, les balises démocratiques de cette reconnaissance des patrimoines des personnes et des communautés patrimoniales : « l’exercice du droit au patrimoine culturel ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont nécessaires dans une société démocratique à la protection de l’intérêt public, des droits et des libertés d’autrui »
En troisième lieu, on ne peut guère s’y tromper : la reconnaissance des patrimoines est une responsabilité partagée, non un droit de se replier sur son propre passé. L’article 4 de la Convention pose la règle commune : « il est de la responsabilité de toute personne, seule ou en commun, de respecter aussi bien le patrimoine culturel des autres que son propre patrimoine et en conséquence le patrimoine commun de l’Europe ». Cette dynamique installe l’utopie de faire humanité ensemble, du moins en Europe, avec « tous les patrimoines culturels en Europe qui constituent dans leur ensemble une source partagée de mémoire, de compréhension, d’identité, de cohésion et de créativité. » Chacun doit pouvoir s’identifier, en tout ou partie à ce patrimoine partagé et nul ne peut faire patrimoine en s’opposant aux autres.
L’utopie des droits culturels est donc de permettre à la personne de choisir ce qui fait sens pour son futur et celui d’une humanité durable. Nul n’est prisonnier d’un passé qui lui serait imposé et chaque personne doit pouvoir choisir les ancêtres pour nourrir son parcours au sein de la Communauté humaine.
La Convention de Faro : la conquête du patrimoine par la démocratie par la discussion
On ne s’étonnera pas que le quatrième volet de cette utopie patrimoniale soit la démocratie par la discussion.
La Convention de Faro n’est pas naïve : elle connaît la puissance des attachements identitaires et les revendications particularistes qui ancrent le patrimoine dans des racines uniques, accrochées à des ancêtres qui ne se partagent pas avec les autres communautés. Ce fut, par exemple, en 2024, le credo du Rassemblement National proposant de rebaptiser les Journées Européennes du Patrimoine en « Journées Nationales du Patrimoine » tout à son ambition de glorifier le patrimoine comme « creuset d’une grande Nation millénaire ». Le mot d’ordre était court mais en disait long : « Une Nation, un patrimoine ». Ce singulier accepte le patrimoine uniquement comme « expression, parfaite, de la civilisation française ».
Dans ce contexte, la Convention de Faro se présente comme force politique de résistance, accueillant la diversité des récits. Elle oppose à tous les relativistes, l’universalité des droits humains fondamentaux.
Pour cela, elle pose ses conditions en exigeant que les personnes (et leurs communautés) fassent valoir que les reflets et expressions de leurs valeurs, croyances, savoirs et traditions » sont universalisables, donc compatibles avec les valeurs d’humanité. Elle demande l’engagement des parties prenantes de contribuer à la discussion publique, ouverte et documentée. L’article 7 appelle à « la réflexion sur l’éthique et sur les méthodes de présentation du patrimoine culturel ainsi que le respect de la diversité des interprétations. ». Là encore, il va bien falloir discuter !
Partout où les personnes sont en relation, quartier par quartier, il est nécessaire d’organiser les temps d’écoute des mémoires. Il s’impose d’être attentif aux symboles qui donnent vie aux passés des personnes et des groupes auxquels elles se rattachent. Les dispositifs d’attention aux écarts de points de vue et d’interprétation sont, nécessairement, à prévoir car, partout, des tensions peuvent se nouer. La responsabilité politique démocratique est, ainsi, d’« établir des processus de conciliation pour gérer de façon équitable les situations où des valeurs contradictoires sont attribuées au même patrimoine par diverses communauté », comme le proclame l’article7 de la Convention.
L’utopie de Faro : une action quotidienne
L’utopie de Faro est donc un dispositif continuel de démocratie par la discussion. Elle ne fait pas du patrimoine un domaine réservé à des spécialistes ; elle se présente comme un espoir partout où les diversités du « monde » sont confrontées au tensions « multiculturalistes », où l’étranger à « son monde à soi » devient source d’hostilité. Sa perspective est l’hospitalité d’humain à humains, pour reprendre, ici, le beau slogan de la coopérative de voyage des Oiseaux de passage26, utopie concrète soucieuse de faire atterrir l »esprit de la Convention de Faro et des droits culturels.
Avec cette interprétation politique de la Convention de Faro, il ne manque pas de réalités quotidiennes où les droits culturels au patrimoine sont mobilisés. Prendre au sérieux la Convention est une affaire de tous les jours, dans tous les quartiers, dans tous les moments où se confrontent des récits différents et où se pose la question de savoir si des conciliations sont possibles. La Convention détaille, d’ailleurs, tous ce champ de l’action concrète et le Conseil de l’Europe a établi un programme d’actions visant à soutenir le réseau européen des « amis de Faro » qui mettent en travail la Convention.
Récemment, sur l’impulsion de Prosper Wanner27, suite au séminaire Faro qui s’est tenu à Bordeaux en septembre 2022, nous avons pu mettre en place un réseau Faro francophone avec des associations, des chercheurs, des collectivités territoriales… mais sans l’État, toujours aussi aveugle aux exigences critiques des droits culturels.
Ces réseaux d’acteurs offrent alors l’opportunité de traduire dans l’action de terrain, des expérimentations où l’on trouvera les droits culturels comme utopie de la démocratie par la discussion pour faire patrimoine ensemble.
Trois chantiers pour alimenter, vers le haut, la spirale idéologie/utopie
Il est sans doute temps de tirer une conclusion globale de cette recherche des droits culturels hors de l’idéologie de la culture – catalogue. Les trois textes rappelés ici affirment la nécessaire utopie critique de la culture-processus qui se reconnaît dans les expressions d’humanité des personnes, seules ou en commun.
Chacun des textes indique comment déployer des expérimentations salutaires qui alimenteront la spirale idéologie/utopie à travers la pratique de la démocratie par la discussion.
– Le premier chantier s’appuie sur l’Observation générale 21 et le droit de prendre part à la vie culturelle. Il s’agirait d’explorer des situations où des écarts et des tensions se manifestent entre des personnes, des groupes, des institutions. Dans ces situations, si fréquentes au quotidien, les personnes expriment leur hostilité et n’expriment plus leur humanité. Il n’y a plus « culture » commune au sens des droits culturels. L’utopie des droits culturels appelle alors la démocratie par la discussion pour sortir de ces cercles de haines.
Ce chantier expérimental a un point de départ tout trouvé : il devrait prendre appui sur une sélection des dispositifs de médiations existants. Il les interrogerait pour sélectionner ceux d’entre eux dont les pratiques sont universalisables, c’est à dire cohérentes avec les valeurs des droits fondamentaux. On y trouvera des situations pratiques où les écarts entre les personnes se résolvent par l’écoute, la considération, la conciliation et la mise en route de solidarités (s’associer pour faire ensemble) et des modes d’action en commun, permettant de limiter, même partiellement, les tensions des récits et des intérêts.
Il est probable que ces dispositifs nécessiteront de mobiliser beaucoup de temps mais, avec les droits culturels, ces temps pour faire humanité ensemble sont politiques : ils s’ouvrent sur l’espoir d’une démocratie nouvelle, à l’écoute des parcours d’autonomisation et d’émancipation des personnes, libres et dignes, mieux reconnues par elles-mêmes et par les autres. C’est loin actuellement d’être un luxe dans une société qui a largement réduit sa reconnaissance des bienfaits de l’association au profit de la compétition marchande.28
– Le deuxième chantier à expérimenter s’appuiera sur le rapport de madame Shaheed sur le droit à la liberté artistique. Pour le cerner de manière opérationnelle, il conviendrait de s’intéresser, en priorité, aux situations où les personnes ne parviennent pas à exercer leur droit universel à cette liberté, parce qu’elles s’autocensurent.
Sur cette base, en application d’ailleurs, de la loi NOTRe, le chantier interrogerait quelques collectivités territoriales partenaires sur leurs possibilités d’intervenir, au nom de l’intérêt général, pour rendre effectives ces libertés d’expression artistique tant les êtres d’humanité sont des êtres de fiction qui se racontent, ensemble, des histoires, pas seulement pour les vendre ou les acheter. Le chantier sera ciblé sur chaque territoire complice et indiquera les diverses possibilités de déblocage à la disposition des collectivités pour faire émerger le bouillonnement des imaginaires, dans le cadre éthique explicité par madame Shaheed. Il sera donc réserver à des collectivités progressistes qui estiment que leur responsabilité reste de faire progresser l’ancrage des droits humains fondamentaux par la démocratie par la discussion, au quotidien.
– Le chantier de la Convention de Faro s’appuiera, lui, sur les pratiques des acteurs soucieux d’être attentifs aux récits des personnes : les collectivités, associations, chercheurs, impliqués dans les réseaux Faro, européen et francophone, apporteront leurs initiatives concrètes et leur réflexion politique. Toutes ces expériences sont attentives à la diversité des situations locales, notamment en valorisant les mémoires des personnes généralement invisibilisées sur le territoire. C’est le moins que l’utopie des droits culturels puisse faire en ces temps de peur exacerbée des autres.
Les trois chantiers expérimentaux, évoqués ici montreront, en pratique, le chemin escarpé à engager. Certes, l’idéologie de la culture-catalogue continuera de s’opposer aux droits culturels mais l’innovation est inévitable car, après tout, cette idéologie est enfermée dans un secteur culturel qui ne pèse guère que 2% de l’économie alors que l’enjeu de « faire humanité ensemble » est présent partout dans les rouages de la société 29.
La démocratie par la discussion sait remettre la raison au cœur de la vie commune et les droits culturels sont là pour ne pas oublier la prégnance des imaginaires dans nos difficultés à faire Communauté humaine. Je laisse donc à Dante la métaphore conclusive de cette ligne de crête de l’utopie des droits culturels : « La raison volant après le sens à l’aile courte »30.