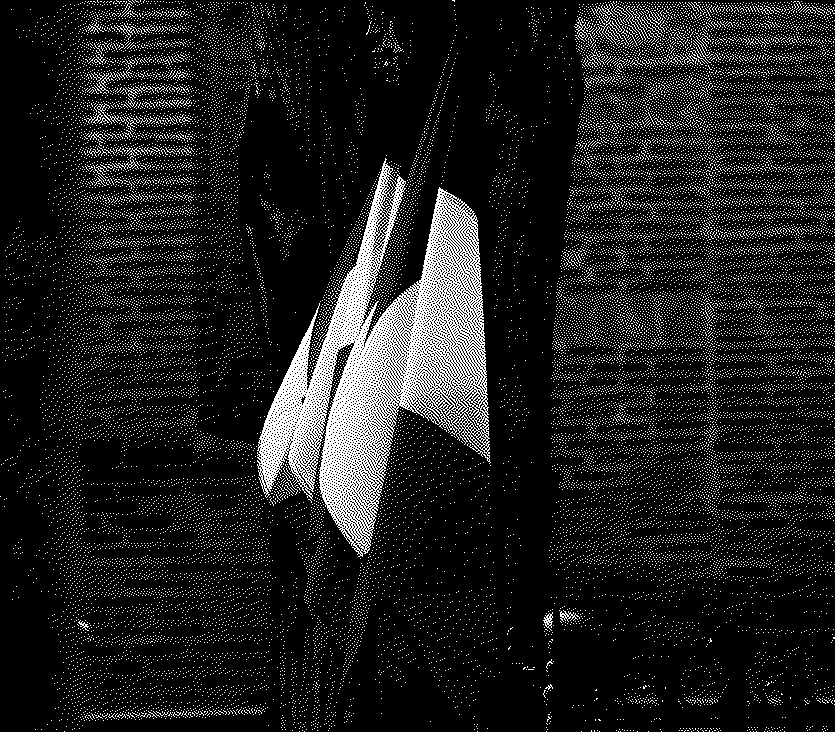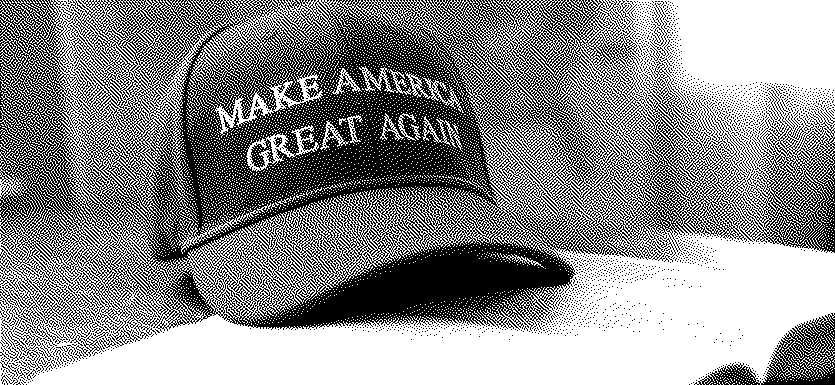Une vidéo inédite de Michel Rocard présentée par Jean-Louis Missika
Michel Rocard est le Premier ministre de François Mitterrand depuis le 10 mai 1988, on voit d’ailleurs un portrait de celui-ci dès les premiers plans de l’entretien. Cette nomination crée une sorte de cohabitation entre les deux sensibilités du parti socialiste : la première et la deuxième gauche qui ne s’apprécient guère. Mitterrand a fait ce choix pour « lever l’hypothèque Rocard », en pensant que celui-ci ne tiendrait pas longtemps à Matignon. Mais Rocard gouverne et gouverne bien, à la satisfaction des Français1, ce qui rend son renvoi compliqué, celui-ci n’aura lieu que le 15 mai 1991, sans autre raison que le caprice du Prince. Rocard dira à cette occasion : « Mitterrand m’a viré ».
L’entretien a lieu en janvier 1990, le mur de Berlin est tombé le 9 novembre 1989, provoquant un tremblement de terre géopolitique. C’est le premier sujet que Rocard aborde dans cette vidéo. Son propos est prudent parce que l’évènement vient de se produire mais aussi parce qu’il s’exprime sur un sujet qui relève du domaine réservé du Président de la République. Il en appelle au « devoir d’imagination politique », une constante de la doctrine rocardienne, et à la coopération multilatérale. Il en profite pour souligner la différence essentielle entre social-démocratie et communisme qui porte sur le respect des valeurs de liberté, et pour définir l’identité socialiste. Vue à la lumière de la situation que nous connaissons aujourd’hui, sa définition d’un conflit central entre capitalisme libéral et socialisme démocratique s’avère à la fois optimiste et fausse. Il n’anticipe pas l’épuisement de la doctrine socialiste confrontée aux limites infranchissables de l’extension de l’Etat-providence.
Il poursuit son propos par une critique subtile et féroce du mitterrandisme en comparant la situation de la gauche en 1983, contrainte et forcée de faire une pause dans les réformes, après deux ans de pouvoir, tant l’économie française a été malmenée, et celle de 1990 où le rythme des réformes peut rester le même parce que celles-ci ont été mieux conçues et menées. Il s’engage alors dans une sorte de bilan de l’action de son gouvernement, dans un contexte marqué par la proximité du congrès du parti socialiste, le fameux congrès de Rennes (15-18 mars 1990), au cours duquel les frères ennemis du mitterrandisme, Fabius et Jospin se déchireront à belles dents, et feront de Michel Rocard, un an plus tard, la victime collatérale et expiatoire de cette rivalité. Les rumeurs d’un départ forcé de Matignon vont aussi bon train, et Rocard s’attache à montrer l’ampleur des réformes qu’il a menées et leur succès. Les accords en Nouvelle Calédonie qui ont arrêté « une guerre civile commencée », Le Revenu Minimum d’Insertion, la création soutenue d’emplois, le financement « stable et durable » de la Sécurité Sociale, la « rénovation » de l’Education nationale et du service public, le « chantier de la ville ». Son analyse de la question urbaine n’a rien perdu de son actualité, bien au contraire, elle montre à quel point il comprenait les problèmes qu’il fallait résoudre et la justesse des solutions qu’il préconisait. En passant, il ironise sur la réception de son discours de politique générale de juin 1988 à l’Assemblée nationale, où il évoquait les escaliers délabrés, les ascenseurs en panne, les boîtes aux lettres cassées. Il fait de la politique de la ville la pierre angulaire de la lutte contre les inégalités sociales.
Le reste de l’entretien est consacré au Parti socialiste, car le Congrès de Rennes qui s’annonce est jugé à la fois incertain et décisif. Il s’avérera explosif et destructeur, sans doute le premier jalon de la descente aux enfers du parti à la rose. Cette vidéo illustre l’importance du rôle politique du parti dans la pensée de Michel Rocard : « Le garant du fait que nous conduirons jusqu’au bout cette transformation de notre pays, ce pas en avant vers plus de justice, moins d’arbitraire, plus de générosité et de rayonnement, la capacité de la France à assumer toutes ses immenses responsabilités à l’international et sur le long terme, c’est le parti qui la porte et d’une certaine façon, lui seul ».
Il souligne la faiblesse du parti français quand on le compare à la taille de ses homologues européens. « Il arrive qu’on s’ennuie dans nos sections » enchaîne-t-il, pour fustiger le manque d’ouverture de son parti à l’action sociale et au monde associatif, et il critique sévèrement le fonctionnement du parti, trop centralisé, en manque de démocratie interne. Cette séquence est fascinante, tant elle nous replonge dans un monde qui n’existe plus, un monde ou le rôle politique des partis était essentiel au fonctionnement de la vie démocratique, comme à l’émergence d’idées nouvelles. Un monde où le leader politique disposait d’une solide culture politique et historique, avait forgé ses convictions au cours de dizaine d’années d’activités d’élu local et national, respectait les militants et s’intéressait à la société civile et à l’économie.
C’était Michel Rocard, un leader politique et un homme d’Etat comme on n’en trouve plus. Il nous manque terriblement.