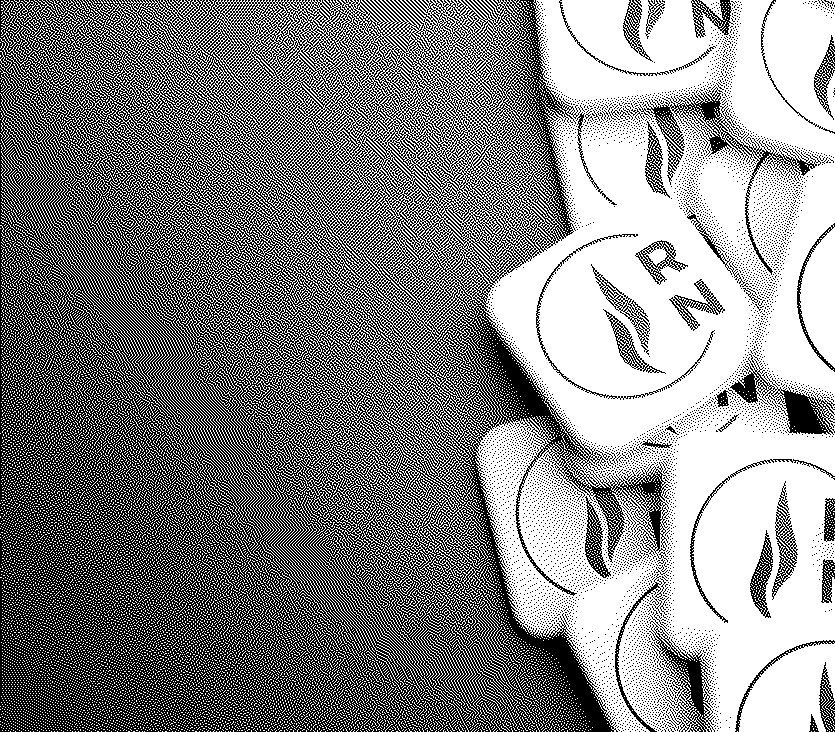Dans un jugement que tous attendaient, Marine Le Pen a donc été déclarée coupable de détournement de fonds publics1. Jusqu’ici, nulle surprise au regard du fond du dossier : l’accablante masse de preuves accumulées par les enquêteurs et rappelées à l’audience ne laissait aucun doute au sujet de la culpabilité des mis en examen et singulièrement de la première d’entre eux. Plus de 4 millions d’euros de fonds publics européens destinés au travail des eurodéputés ont donc été détournés au profit des activités partisanes du Rassemblement national, petite holding familiale qui finança ainsi le garde-du-corps du père (Jean-Marie Le Pen) ou un poste lié à l’événementiel occupé par la sœur (Yann Le Pen). Entre autres bénéfices tirés de ce que les juges ont à juste titre caractérisé comme un « système ».
Toutefois, ce n’est pas tant la reconnaissance de la culpabilité de Marine Le Pen et de ses co-prévenus qui a provoqué la surprise et déclenché la polémique, que les peines prononcées. Pas les peines principales d’ailleurs : on ne s’est guère ému, bizarrement, ni des amendes ni des peines de prison. Celle de Marine Le Pen est pourtant particulièrement lourde : quatre ans dont deux fermes qui pourront être réalisés sous surveillance électronique. Avec Marine Le Pen, 8 eurodéputés, 12 anciens assistants parlementaires et 3 cadres du parti sont condamnés. Malgré la lourdeur de ces sentences, c’est la peine complémentaire d’inéligibilité concernant Marine Le Pen et, plus encore, la décision de son exécution provisoire (c’est-à-dire immédiate) qui ont ému et même « scandalisé » les intéressés.
Marine Le Pen et ses proches, bientôt suivis par le chœur empressé des médias Bolloré en formation de propagande permanente, y ont vu un « attentat contre la démocratie », un « viol de l’état de droit », voire une « exécution de la démocratie » perpétrée par une justice « tyrannique ». Examinons les arguments.
1. Tyrannie des juges ? Gouvernement des juges ? Nulle part dans les quelques 152 pages du jugement, les magistrats du tribunal correctionnel ne produisent de normes nouvelles ou ne s’égarent dans une libre interprétation des textes de loi existants. L’article 432-15 du Code pénal, dans sa version en vigueur depuis le 6 décembre 2013, établit bien que
« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l’infraction. »
La peine principale infligée à Marine Le Pen et ses co-accusés est donc dans les clous de la loi. Et l’article 131-26-1 du même code précise également :
« la peine d’inéligibilité peut être prononcée pour une durée de dix ans au plus à l’encontre d’une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits. »
Là encore, la peine complémentaire fait partie de l’arsenal répressif prévu par les textes quand l’accusé exerce un mandat électif. L’article 374 du Code de procédure pénale précise enfin au sujet de l’exécution provisoire :
« Lorsqu’elle statue en premier ressort, la cour peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision, si celle-ci a été demandée »
Les juges n’ont donc rien inventé. Au terme d’une procédure contradictoire, ils ont suivi certaines des réquisitions du parquet et fondé leur jugement comme il se doit sur des lois adoptées par les représentants élus du peuple exprimant ainsi sa volonté souveraine. Loin de toute forme de tyrannie, ils ont au contraire fait valoir la loi démocratique.
Les désigner aujourd’hui à la vindicte publique comme le font depuis le jugement les élus RN et Marine Le Pen elle-même, ce n’est donc pas défendre la démocratie et l’état de droit, comme ils le prétendent mais les affaiblir gravement. C’est même faire peser sur l’autorité judiciaire une charge d’intimidation qui menace son indépendance et risque de troubler la sérénité de ses décisions en collant une cible dans le dos des magistrats concernés. Les philippiques enragées de Jean-Philippe Tanguy à l’Assemblée nationale lors de la séance de questions au gouvernement du 3 avril ne manqueront pas d’être regardées rétrospectivement comme des appels à la violence si quiconque venait à s’en prendre à l’intégrité des juges dans les jours et semaines qui viennent.
2. Si la légalité de la décision de justice ne fait aucun doute, on peut naturellement discuter du quantum des peines prononcées et de leur modalité d’application. Il est d’ailleurs tout à fait possible qu’en deuxième instance, la Cour d’appel prenne une autre décision. Contrairement à ce qui a pu être dit, les décisions de justice ne sont pas au-dessus de toute critique et aucun juge n’est « hors de contrôle ». Les décisions peuvent être remises en cause en appel, elles peuvent être attaquées par des pourvois en cassation voire devant la Cour européenne des droits de l’homme. Elles peuvent aussi être freinées voire empêchées par des Questions prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui permettent de faire intervenir le juge constitutionnel dans la procédure. C’est d’ailleurs parce que tous ces contrôles et garanties existent que les procédures judiciaires sont souvent si longues, ce dont se plaignent régulièrement les adversaires du « laxisme judiciaire ». En l’occurrence, Marine Le Pen et ses avocats ont activé tous les moyens possibles et imaginables pour retarder l’échéance à défaut de pouvoir la compromettre. Raison pour laquelle la procédure a duré plus de neuf ans. Et elle n’est pas finie puisque l’intéressée a décidé d’interjeter appel…
Les décisions de justice peuvent donc être discutées et elles le sont souvent. Concernant l’exécution provisoire, le juge a-t-il excédé ses pouvoirs ou manqué de « prudence » comme il a été dit ces derniers jours ? Excédé ses pouvoirs, certainement pas. Non seulement cette décision est légale, on l’a vu, mais elle est fréquente. En 2022, selon des données issues du Ministère de la justice et l’exploitation du Casier judiciaire national des personnes physiques, 8 857 peines d’inéligibilité avaient été prononcées en France. Et en 2023, 639 personnes avaient été condamnées à une peine d’inéligibilité avec exécution provisoire, toujours selon le Ministère de la Justice. Le cas de Marine Le Pen est donc loin d’être isolé et la décision des juges la concernant n’a rien d’exotique.
Les partisans de Marine Le Pen expliquent cependant que cette décision annihile les vertus de l’appel et, de facto, risque de conduire à une injustice majeure dans le cas où l’élection présidentielle se jouerait sans elle mais où elle serait ensuite reconnue innocente. Marine Le Pen souhaite ainsi que l’appel la place à nouveau dans une posture de parfaite et pure innocence, comme au jour de sa naissance. Le raisonnement s’entend et il exprime bien le principe du droit à un second jugement. Mais ce principe n’est jamais absolu. Lorsqu’existent des risques de récidive, de fuite ou de trouble majeur à l’ordre publique, les juges y dérogent régulièrement. Il arrive même qu’ils privent de liberté des personnes mises en examen et non encore jugées : c’est le principe de la détention provisoire, par exemple. C’est-à-dire le type de décisions qu’appellent en général de leurs vœux ceux qui se désolent que des « fichés S » ou des récidivistes restent en liberté.
En l’occurrence, les juges ont estimé qu’il existait un double risque de récidive et de trouble à l’ordre public. Le risque de récidive a fait beaucoup parler, certains l’estimant inexistant. Il n’est pourtant pas interdit de s’interroger sur des responsables politiques et un parti déjà condamnés trois ans plus tôt en appel dans l’affaire dite « des kits de campagne » (ou encore « du micro-parti Jeanne »). La question n’est pas réglée du seul fait que Marine Le Pen n’est plus eurodéputée, comme le prétendent certains de ses amis, car ce qui est en cause ici, c’est un « système » de financement du Rassemblement national. On a le droit de ne pas suivre les juges dans leur appréciation sur ce point, mais il est difficile de considérer qu’elle n’est pas fondée sur des justifications sérieuses.
L’exécution immédiate de la peine a été critiquée : elle se présente en effet comme l’application d’une sanction alors que la personne qui fait appel, dont le cas va être examiné de nouveau par un tribunal, n’est pas jugée de manière définitive. C’est d’ailleurs pourquoi l’exécution est dite « provisoire », elle s’applique provisoirement en attendant le jugement définitif. Mais, quelles que soient les réserves qu’on peut avoir sur ce sujet du point de vue des principes, force est de reconnaitre que ce sont les députés et sénateurs eux-mêmes qui ont prévu cette peine pour les cas de détournement de fonds et que le Rassemblement national n’est pas le dernier à exiger des peines toujours plus lourdes et une justice plus sévère. Le risque de « trouble à l’ordre public démocratique » par lequel la juge justifie l’exécution provisoire, enfin, repose sur la possible ineffectivité de la peine. On peut en effet redouter que certains des condamnés dans cette affaire soient demain candidats à d’autres élections et même qu’ils soient élus alors qu’ils ont été condamnés à une peine d’inéligibilité suspendue par l’appel et, le cas échéant, confirmée ultérieurement par la décision de deuxième instance. Une telle situation serait constitutive d’un trouble « à l’ordre public démocratique », disent les juges, au sens où il introduirait une forme de tricherie dans le processus électoral, où des électrices et des électeurs pourraient croire innocents des candidats qui ne le sont pas. Par ailleurs et enfin, la décision de première instance rendue en mars 2025 est distante de plus de vingt années du début des faits reprochés aux prévenus (2004) et l’on est en droit d’exiger une plus grande proximité entre le délit et sa sanction. Là encore, on peut juger la décision trop rigoureuse, mais on ne peut pas la prétendre privée de solides fondements.
Enfin et surtout, l’exécution provisoire n’a pas pour conséquence de priver la personne condamnée de son droit de faire appel. D’ailleurs, MLP a fait appel et, contrairement à ce qu’ont laissé croire ses proches, la décision d’appel va pouvoir être rendue longtemps avant la tenue de l’élection présidentielle. De fait, si la Cour d’appel devait relaxer Marine Le Pen ou si elle prenait une décision d’inéligibilité beaucoup plus courte, la candidate du RN pourrait parfaitement se présenter à l’élection. Où donc est la « tyrannie des juges » ?
3. Le débat a pris un autre tour dans la classe politique où a été mis en cause le principe même de la peine complémentaire d’inéligibilité pour les élus. Le Premier ministre (intéressé au sujet dans une affaire passée) a ouvert la porte à cette discussion au Parlement. Jean-Luc Mélenchon (intéressé dans une affaire présente) a pris soin de dire dès le départ tout le mal qu’il pense de la peine d’inéligibilité prononcée par un tribunal. Comme dans les années 1990 où, pour se débarrasser de juges tatillons et importuns, des lois d’amnistie étaient concoctées entre amis de différents bords à l’Assemblée nationale, on commence à imaginer qu’une Proposition de loi sortie de nulle part (Eric Ciotti semble s’être proposé pour ce noble office) soit déposée pour faire disparaître du Code pénal la peine d’inéligibilité dans ce genre d’affaires, au motif qu’il revient au peuple et à lui seul de décider qui peut légitimement concourir à ses suffrages et qui ne le peut pas.
Il est naturellement tout à fait possible de modifier la législation par les mêmes procédures démocratiques qui ont conduit à légitimer et adopter les lois présentes. Mais l’affaire mérite réflexion. D’une part, l’expérience passée devrait alerter les partisans de cette solution qui les fera apparaître comme un petit club d’élus arrangeant leurs affaires entre copains et se blanchissant mutuellement de leurs turpitudes passées. D’autre part, la peine d’inéligibilité présente des avantages qui méritent d’être rappelés. Plutôt que de laisser au juge les seules peines d’amende et de privation de liberté, elle le dote d’un instrument lui permettant de punir dans le registre du mal commis : la rupture de la confiance inhérente à l’exercice d’un mandat électif. Ce faisant, elle lui permet aussi d’avoir la main moins lourde sur les peines principales. Autrement dit, il n’est pas impossible qu’en supprimant la peine d’inéligibilité, on pousse les juges à durcir les peines privatives de liberté et les amendes. Est-ce intelligent ? Est-ce souhaitable ?
Le procès fait à la décision des juges dans cette affaire est manifestement un mauvais et dangereux procès. S’il est trop tôt pour en mesurer les conséquences politiques, certains effets peuvent néanmoins être d’ores et déjà soulignés.
Le premier concerne le crédit accordé à nos institutions : auprès de celles et ceux qui auront été convaincus par la propagande Bolloré et par les cris d’alarme de Marine Le Pen et de ses proches, il sortira très affaibli de cette séquence et ce n’est une bonne nouvelle pour personne. Pas même pour ceux qui aspirent à exercer la magistrature suprême et de ce fait à être garants des institutions.
Le second effet concerne le Rassemblement national lui-même. Engagé de longue date dans une stratégie de dédiabolisation-normalisation, il a frayé ces derniers jours avec une rhétorique trumpiste aux accents quasi-insurrectionnels qui frisait les registres du déni de réalité et de la vérité alternative. Si cette stratégie a sans doute conforté ses partisans dans une sorte de martyrologe délirant, elle risque de lui avoir aliéné les électorats qui lui manquent pour pouvoir l’emporter demain.