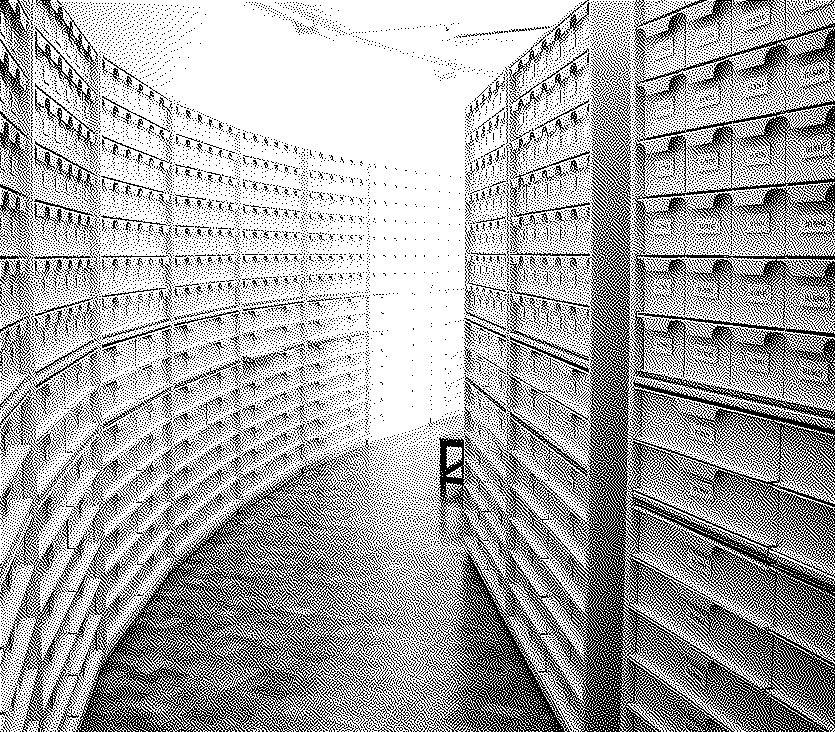La Grande Conversation : Les instructions données par Donald Trump dès son entrée à la Maison Blanche dans une série d’« executive orders » pour bannir une liste de termes des sites officiels américains a notamment conduit le Pentagone à purger ses sites d’archives photographiques qui illustraient entre autres les programmes de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) au sein de l’armée. Par ailleurs, des coupes budgétaires compromettent la continuité de la production de données publiques sur les risques environnementaux, l’état des océan1 ou encore le changement climatique. D’autre part, Trump a très rapidement décidé de renvoyer le directeur des archives nationales américaines2. Ce rapport aux données publiques et aux archives paraît tout à fait inhabituel – pour ne pas dire exceptionnel – dans des États démocratiques. Les États ne prêtent-ils pas plutôt historiquement un grand soin à constituer des archives publiques et à les conserver ?
Philippe Darriulat : Les archives, leur existence et surtout leur ouverture, représentent un enjeu fondamental de l’État de droit et de la démocratie que le président des États-Unis met à mal. Avant même les premières décisions de janvier dernier, Donald Trump avait déjà fait preuve d’une grande désinvolture à l’égard des archives de sa première présidence qu’il s’était appropriées dans sa résidence de Mar-a-Lago. Il montrait ainsi qu’il les considérait comme une archive privée, en contradiction avec les règles établies qui supposent que les archives de l’État appartiennent à la Nation et à l’ensemble de ses citoyens. Cela représentait une négation de l’État de droit par un président qui avait prêté serment, au moment de son investiture, de protéger la Constitution ! Il a d’ailleurs été poursuivi pour ne pas avoir retourné ces documents officiels. S’il n’a pas été condamné c’est uniquement parce qu’une juge fédérale (nommée par Trump en 2020) a classé l’affaire en juillet 2024. Le procureur spécial a fait appel mais a laissé l’enquête en suspens après la victoire de Trump en 20243.
LGC : Tout État souverain porte attention à la conservation de ses archives. Y a-t-il une particularité du rapport des régimes démocratiques, dans le cas de la France par exemple, aux archives ?
Philippe Darriulat : Évidemment, et à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c’est l’ouverture des archives à toutes les citoyennes et à tous les citoyens : la transparence des actes que l’État réalise en notre nom. Il s’agit ici bien sûr des archives publiques. Il ne s’agit pas uniquement de conserver des documents anciens, mais de les rendre accessible à tous et à toutes. En France, la Révolution française constitue de ce point de vue un moment important. La monarchie française conservait déjà ses archives qui étaient essentiellement utilisées pour légitimer son pouvoir. Ce qu’ont voulu faire les législateurs de la Révolution – en deux temps, en 1790, avec les archives nationales puis en 1796 avec les archives départementales – ce n’est pas uniquement de conserver des documents, ce qui se faisait déjà. C’est de faire que ces archives soient publiques et accessibles à toutes et à tous.
Cette publicité a une double portée. Premièrement, elle garantit la transparence, c’est-à-dire que tout citoyen a le droit de consulter les actes du gouvernement et des pouvoirs publics en général. Pour comprendre, par exemple, des décisions qui le concernent, qui ont un impact dans sa vie personnelle, ou même pour comprendre, et juger des choix politiques faits par les gouvernements au nom de la Nation.
Deuxièmement, c’est la capacité pour tout citoyen de faire valoir un droit, une dimension que l’on oublie souvent quand on est historien ou chercheur. Une grande partie des personnes qui consultent les archives publiques le font dans ce but : sur des questions propriété, de libre passage sur un chemin, d’héritage, de continuité familiale, consulter les dossiers d’un procès, etc. Permettre à chacun de trouver les éléments qui lui permettent de faire respecter et de faire valoir son droit, c’est un enjeu proprement démocratique de l’accès aux archives. L’archive n’appartient pas à celui qui l‘a produite, ni même aux seuls historiens, même s‘ils se servent quotidiennement d’elle dans leurs travaux. Mais ces travaux ont d’ailleurs eux aussi vocation à être publics. Le métier d’historien consiste bien à éclairer le passé pour mieux comprendre le présent. Ils ont donc toujours une fonction politique sociale majeure et participent, à leur niveau, de notre compréhension collective du monde dans lequel nous vivons.
LGC : Il existe cependant des restrictions à la consultation des archives. Comment sont-elles justifiées ?
Philippe Darriulat : Oui, il y a à la fois des restrictions légitimes et d’autres, qui ne le sont pas. Ce qu’on voit aux Etats-Unis, c’est une anormalité qui est en train de devenir la règle.
Ce que j’appelle une restriction légitime, c’est tout ce qui concerne la protection des personnes. Mais cela ne peut être que temporaire, pour une période déterminée. Par exemple pour certaines archives judiciaires, celles des hôpitaux psychiatriques. Ou, dans des affaires de terrorisme ou de narcotrafiquants, la protection de témoins ou d’informateurs. Ces préoccupations légitimes justifient que les archives ne soient ouvertes à la consultation publique qu’après un certain nombre d’années, selon des critères transparents.
En France, sur cette question, il y a eu dernièrement un contentieux opposant les historiens aux autorités militaires. Avec la règle des 50 ans, les archives d’avant 1970 devraient en principe être ouvertes au public, même celles qui relèvent du « secret Défense ». Mais, récemment, l’accès a été restreint, y compris aux chercheurs. L’ouverture automatique a été refusée, alors que c’est normalement la règle. Cela veut dire que, pour accéder à certaines archives, il fallait obtenir une dérogation spéciale, une démarche administrative de déclassification des archives, ce qui permet à l’autorité militaire de limiter l’accès. C’est sans doute la guerre d’Algérie qui suscite ces réticences. C’est du moins la suspicion qui s’y est faite4. Le résultat d’un tel refus est d’ailleurs de renforcer la suspicion sur d’éventuelles opérations secrètes, assassinats ciblés ou actes de torture.
LGC : Le maintien du secret peut générer un certain soupçon sur l’idée que « l’État nous cache des choses ». Cela se retrouve aux États-Unis, où le complotisme est très présent désormais dans les cercles mêmes du pouvoir.
Philippe Darriulat : Oui, le conspirationnisme est un vrai sujet de préoccupation, même s’il n’a pas encore pris en Europe la même dimension qu’aux États-Unis. La seule réponse qu’on peut lui opposer, c’est la transparence. Sans avoir de grandes illusions sur l’effet que cela pourrait avoir sur les principales voix du conspirationnisme dont la pensée est totalement irrationnelle. Trump a annoncé l’ouverture des archives sur la mort de Kennedy par exemple mais, n’en doutons pas, ceux qui diffusent les théories conspirationnistes à ce propos, quand ils constateront que les dossiers ne confirment pas leur théorie affirmeront que c’est parce que tout a été détruit ou caché. Ces gens, du moins ceux qui cherchent une visibilité notamment sur les réseaux sociaux, ne changeront pas, parce qu’ils sont guidés en réalité par un agenda politique. On le voit bien dans le cas du groupe conspirationniste d’extrême-droite QAnon aux États-Unis qui a activement participé à la tentative de coup de force contre le Congrès puis à la campagne électorale de Donald Trump. Mais pour la majorité de la population, pour la société, la meilleure réponse reste la transparence, y compris pour des personnes qui pourraient être influencées par la propagande de ces groupes radicaux.
LGC : Mais il peut y avoir une vision un peu naïve de la transparence, comme si les archives parlaient d’elles-mêmes. Il faut de la méthode pour exploiter ou faire parler les archives.
Philippe Darriulat : Évidemment, mais c’est encore une autre question. Et ce ne sont certainement pas des questions dont se préoccupent les personnes dont nous venons de parler. On ne discute pas avec elles des méthodes de la recherche historique.
Concernant le travail sur les archives, l’historien sait que l’archive livre des informations mais ne dit pas, en elle-même, la « vérité ». Confronté à une archive, nous sommes dans une démarche de questionnement. Si l’on consulte des rapports de police, on sait qu’on a affaire à une construction particulière des faits, qui ne sera pas identique, par exemple, dans un journal ou un organe militant. De la même façon, par exemple, j’ai beaucoup travaillé sur des interrogatoires de révolutionnaires inculpés devant des commissions militaires au lendemain des journées révolutionnaires de juin 1848. Il est évident que tout ce qu’ils disent dans ce contexte judiciaire est biaisé. Ils se défendent contre une accusation, ils veulent s’innocenter, éviter la peine de déportation qui les menace. En même temps, ils ne veulent pas dénoncer des voisins, des amis. Alors s’ils sont obligés d’admettre que pendant les événements il y avait énormément d’insurgés dans les rues, ils doivent en même temps affirmer qu’ils ne connaissaient personne et prétendre que, s’ils ont dû descendre dans la rue, c’était uniquement parce qu’on les avait forcés. Il est évidemment exclu de prendre toutes ces déclarations au premier degré. Elles ne prennent sens que dans un rapport au questionnement de l’historien sur cet événement ou sur le profil des personnes mises en accusation et en comparaison avec d’autres traces.
LGC : Parmi les règles qui concernent les archives publiques, certaines portent sur la constitution des archives, sur les modalités de conservation, sur les modalités de consultation, sur le pluralisme des collections mais aussi sur la continuité et la permanence des archives, ce qui allait de soi jusqu’à maintenant. Est-ce qu’il faut une nouvelle sorte de culture autour des archives ou faut-il les protéger à nouveau ?
Philippe Darriulat : En France, pour le moment, les archives sont protégées. Et elles sont de qualité, bien conservées par des professionnels formés. Depuis 1880, une école supérieure de très haut niveau, l’École nationale des chartes, est chargée de former des archivistes dont le professionnalisme est reconnu. Les lois concernant les archives doivent être sanctuarisées. Mais cela reste du domaine de la politique. Si demain, un régime autoritaire s’installait en France, aucune loi ne résisterait durablement, uniquement parce qu’elle a été bien faite, aux attaques de ce régime autoritaire. On le voit aujourd’hui aux États-Unis, l’État de droit peut être remis en cause tous les jours par le président élu. Il s’agit donc aussi – surtout – d’une question politique.
LGC : Si la loi ne suffit pas, il faut une forme d’engagement civique ou militant pour défendre l’État de droit.
Philippe Darriulat : Bien sûr, il faut réagir, c’est la raison pour laquelle j’insiste sur le fait que l’archive est une affaire de citoyens. Si c’est uniquement un bras de fer entre les universitaires spécialistes d’histoire et l’État, la bataille est perdue d’avance face à un régime autoritaire. On ne peut vraiment défendre les archives qu’en rappelant que l’accès aux archives est un droit fondamental pour tous, et pas uniquement un privilège de chercheurs. L’existence des archives ouvertes est un des piliers de l’État de droit.
L’importance n’est pas seulement leur collecte, la qualité de leur classement et de leur conservation mais dans le fait qu’elles soient publiques. Ce n’est pas un débat corporatiste, ce n’est pas une affaire de chercheurs, c’est l’affaire de toute la société. D’ailleurs, il suffit d’aller se promener dans une archive départementale ou même aux archives nationales pour le constater : la majorité des gens qu’on trouve en train de dépouiller des cartons sont des particuliers.
LGC : Voyez-vous des précédents à cette volonté ouvertement affichée et mise en œuvre de destruction d’archives publiques telles qu’on le voit aujourd’hui aux États-Unis ?
Philippe Darriulat : C’est inhabituel. Habituellement plus un régime est autoritaire, plus il produit des archives. Parce que les rapports de police se multiplient, ainsi que ceux des services de renseignement, les enquêtes contre les citoyens, les dénonciations, les procès contre les opposants ou les personnes simplement présumées hostiles au régime. La répression produit des archives mais celles-ci ne sont évidemment pas destinées à devenir publiques. Les régimes autoritaires produisent donc beaucoup d’archives auxquelles ils ne veulent donner aucune publicité et qui ne deviennent consultables qu’à leur chute. D’ailleurs, au moment où ils s’effondrent, les régimes autoritaires cherchent souvent à détruire en catastrophe leurs archives. Ils tentent de brûler toutes les traces de leur passé, ils essaient ainsi de dissimuler leurs crimes. Heureusement, leur chute est souvent trop rapide pour qu’ils puissent totalement y arriver.
C’est d’ailleurs un enjeu parfois complexe des transitions démocratiques, comme on l’a vu avec l’ouverture des archives dans l’ex-RDA ou en Afrique du Sud. Cela peut créer une tension entre un désir de justice et une volonté de réconciliation nationale. Ces pays n’ont pas attendu un délai de 50 ans pour donner accès aux archives. Mais ils ont organisé cette ouverture avec des commissions dédiées chargées d’accompagner un processus de réconciliation nationale, comme l’a fait la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud à la sortie de l’apartheid. Il s’agit là de choix purement politiques, toujours liés aux conditions de l’effondrement de ces régimes dictatoriaux. Plus généralement, les règles d’ouverture des archives doivent être définies mais elles ne doivent en aucun cas être modifiées par l’État au nom de la défense de son intérêt, ou de celle des hommes au pouvoir !
LGC : La décision de détruire des archives révèle-t-elle quelque chose de la nature du projet politique de Donald Trump ?
Philippe Darriulat : On ne peut pas isoler cette action du reste des – nombreuses ! – décisions prises par Donald Trump depuis son investiture. Il s’agit de la remise en cause de la nature des États-Unis comme une grande démocratie. La plus vieille démocratie du monde est en train de basculer dans un autre type de régime.
Mais les archives ne sont qu’une pierre de cet édifice que Trump est en train de bâtir ou, plutôt, une pierre qu’il enlève à un édifice séculaire qu’il est en train de détruire. Il répond aussi à une attente d’une part de son électorat, en montrant qu’il est au-dessus de la loi, qu’il fait ce qu’il veut et qu’il veut être le maître du passé comme du présent. L’absence d’archives l’aide dans la construction de son récit. Elle s’inscrit également dans le mouvement de mise en cause de la science, de remise en cause de la parole scientifique. Remettre en cause la parole scientifique, remettre en cause le travail des chercheurs et détruire les archives, c’est remettre en cause des fondements d’une démocratie moderne.