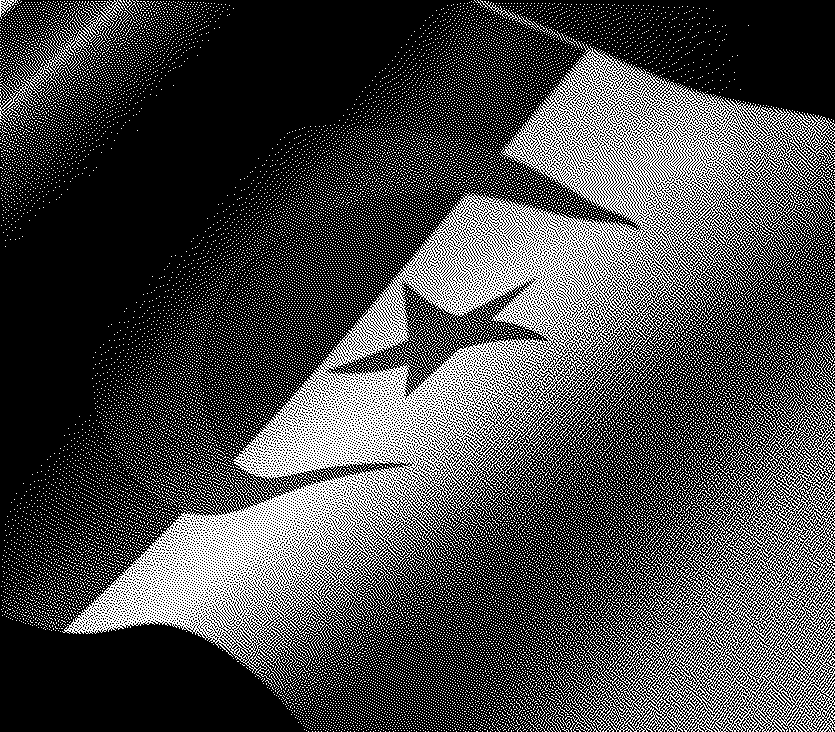Sur fond de tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, la question migratoire a, de nouveau, surgi dans le débat politique et médiatique. Samedi 22 février 2025, un ressortissant algérien sous OQTF (obligation de quitter le territoire français) a tué un homme et en a blessé cinq autres à Mulhouse lors d’une attaque qui a conduit le Parquet national anti-terroriste à s’auto-saisir. Deux jours plus tard, l’activisme offensif du ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, qui n’a cessé d’appeler à établir un “rapport de force” avec les autorités algériennes, a fini par trouver écho dans les déclarations du Premier ministre François Bayrou, jusque-là mutique sur la question, tout comme le président de la République.
Le locataire de l’Hôtel de Matignon a jugé “inacceptable” que le gouvernement algérien n’ait pas accédé aux demandes multiples des autorités françaises qui avaient tenté, à dix reprises, de reconduire à ses frontières l’auteur de l’attaque de Mulhouse. Arrivé illégalement sur le territoire français, en 2014, cet homme de 37 ans avait déjà purgé une peine de prison pour “apologie du terrorisme” indique le ministre de l’Intérieur. Mardi 25 février, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, tenant d’une ligne “diplomatique”, a annoncé, sur France 2, la mise en place de “restrictions d’accès au territoire national” pour un certain nombre de “dignitaires” algériens, une décision qui intervient la veille de la tenue d’un comité interministériel pour le contrôle de l’immigration (CICI), dispositif réactivé, par décret présidentiel, depuis l’arrivée de M. Retailleau place Beauvau. Mercredi 27 février, au sortir de cette réunion, le Premier ministre François Bayrou a annoncé demander au gouvernement algérien le réexamen de l’ensemble des accords bilatéraux tout en menaçant de les remettre en cause si la coopération n’était pas rétablie, notamment sur le sujet de la reconduction des ressortissants algériens sous OQTF.
Les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie sont récurrentes mais d’aucuns estiment que ce nouvel épisode qui ne fait que s’aggraver, semaine après semaine, reste inédit dans l’histoire des relations bilatérales depuis l’indépendance algérienne en 1962. Les dossiers de crispations sont nombreux. Au premier chef, le revirement stratégique de la France, en juillet 2024, sur la question de la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Tout semble être parti, d’ailleurs, de cette décision que la partie algérienne a mal digérée. Par la suite, la question migratoire, et plus spécialement de la reconduction des ressortissants algériens sous OQTF à la frontière, semble, depuis, s’être substituée à l’irritant géopolitique. Cela a conduit un certain nombre de personnalités politiques, au-delà du spectre politique de droite et d’extrême-droite, à se saisir du dossier des accords migratoires de 1968. C’est notamment le cas de Gabriel Attal, secrétaire général du parti présidentiel Renaissance, qui a récemment rejoint la longue liste des personnalités (Edouard Philippe, Manuel Valls, Marine Le Pen, Bruno Retailleau, Éric Ciotti, etc.) ayant appelé à la dénonciation unilatérale de ces accords.
Cette dénonciation a été défendue notamment dans une note publiée par l’ancien ambassadeur de France en Algérie (2008-2012 puis 2017-2020), Xavier Driencourt, pour la Fondapol, dans laquelle il appelle à la remise en cause d’un accord qui “a installé une brèche dans notre ordre juridique” privant, selon lui, “le législateur et le gouvernement français de la possibilité d’agir significativement sur les flux en provenance de l’Algérie”. Depuis, l’idée semble avoir fait son chemin pour devenir, aujourd’hui, un point de ralliement des tenants d’une ligne de fermeté sur l’immigration.
Il convient, dans un premier temps, de rappeler le contexte dans lequel ont vu le jour ces fameux accords de 1968. En effet, les accords d’Évian du 18 mars 1962, ayant entériné un cessez-le-feu en Algérie tout en ouvrant la voie à l’indépendance, avaient instauré un régime de libre circulation entre les deux pays, permettant ainsi aux Algériens, et notamment à la communauté pied-noir, de venir travailler et s’installer en France sans restriction majeure. Cependant, face à l’augmentation des flux migratoires et au contexte économique et social tendu en France, les autorités françaises ont souhaité encadrer davantage cette immigration quelques années plus tard.
C’est dans ce cadre que les accords franco-algériens du 27 décembre 1968 ont été mis en place. Ils visaient à réguler l’entrée, le séjour et l’emploi des Algériens en France, tout en leur accordant un statut dérogatoire au droit commun de l’immigration. L’objectif était alors de trouver un équilibre entre la nécessité pour la France de contrôler les flux migratoires entre les deux pays et la volonté de maintenir une relation privilégiée avec l’Algérie, ancienne colonie avec laquelle les liens humains et économiques restent forts.
A l’origine, ces accords venaient donc restreindre la circulation et les conditions d’établissement en France par rapport à la situation antérieure. Rappelons, par ailleurs, que ces accords ont fait l’objet de trois révisions : la première fois en 1985, puis en 1994 et enfin en 2001. Le point commun de ces trois révisions était le durcissement des conditions d’accès au séjour en France pour les ressortissants algériens. Dès les années 1980, les autorités françaises ont mis en place le système des visas en lieu et place des politiques de quotas jusque-là en vigueur.
Cinquante-cinq ans plus tard, les accords semblent, paradoxalement, avoir le même effet restrictif même si l’on pourrait penser que l’aspect anachronique des dispositions entérinées par ces textes signés de longue date aurait dû produire l’effet inverse : en effet, le nombre de certificats de résident algérien en cours de validité est passé de 545 000 en 2000 à seulement 600 000 en 2023 (+10%). Par comparaison, la population immigrée marocaine avoisinait les 654 000, en 2008, et est passée à 854 000 en 2023 (+30%). Certes, la nationalité algérienne est la première représentée dans le total de la population immigrée établie en France et représente 12,2 % de celle-ci. Toutefois, les Marocains qui, pourtant, ne bénéficient pas d’un accord identique et dont l’immigration est plus tardive se retrouvent en deuxième position, tout juste derrière les Algériens, avec 11,7 % de la population immigrée installée en France. A l’aune de cette première donnée, on est en droit de s’interroger sur le bien-fondé de l’assertion selon laquelle ces accords créeraient un “avantage certain” pour les ressortissants algériens.
D’autre part, il convient de rappeler certaines dispositions discriminatoires à l’égard des ressortissants algériens toujours en vigueur et qui expliquent que l’essor soit aussi bien contenu. En effet, la primauté des traités internationaux sur le droit commun français fait que les immigrés algériens – encadrés par les dispositions des accords de 1968 – n’ont pas pu bénéficier des aménagements récents du droit commun français encadrant le séjour des étrangers en faveur d’une facilitation des conditions d’installation élargies à tous les autres ressortissants de pays européens et extra-européens (passeports Jeunes talents, titre de séjour pluriannuels pour les étudiants, suppression de l’obligation de demander une autorisation provisoire de travail pour être employé, restriction du temps de travail à 60% (50% pour les étudiants algériens) de la durée annuelle légale pour les étudiants).
Il n’en demeure pas moins que s’agissant de l’immigration familiale, les accords du 27 décembre 1968 prévoient des dispositions dérogatoires au droit commun français qui font que, sur le papier, l’immigration familiale algérienne est quelque peu privilégiée. En effet, l’article 4 des accords de 1968 établit que « les membres de la famille du titulaire d’un certificat de résidence peuvent obtenir un certificat de résidence de même durée. » Ainsi, un ressortissant algérien peut faire bénéficier du même droit au séjour (dans la durée) son conjoint mais aussi le faire venir ainsi que ses enfants sans même à avoir à justifier d’une résidence de 18 mois en France, exigence qui est imposée aux autres étrangers régis par le Code d’entrée et de séjour des étrangers et des demandeurs d’asile. De plus, l’accès à l’attribution du certificat de résident algérien (nom spécifique du titre de séjour attribué) de dix ans est théoriquement facilité. Ainsi, un conjoint d’Algérien, détenteur d’un titre de séjour d’une validité d’un an, peut, dès le premier renouvellement, demander à bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de dix ans.
À ces avantages s’ajoutent également des dispositions élargies quant aux membres de la famille concernés, puisque ce régime dérogatoire permet de faire venir, au-delà du conjoint et des enfants mineurs, les ascendants à charge du ressortissant algérien ou de son conjoint, ce qui n’est pas permis dans les mêmes conditions par le droit commun. Par ailleurs, les ressortissants algériens bénéficient d’une certaine stabilité de séjour même en cas de rupture du lien familial, et les jeunes majeurs algériens ayant grandi en France peuvent accéder de plein droit à un certificat de résidence. Néanmoins, il a fallu attendre, les années 1970, pour que la “familialisation” de l’immigration algérienne soit significative du point de vue quantitatif.
Sur le volet de l’expulsion des immigrés illégaux sous le coup d’une obligation de quitter le territoire française (OQTF), une décision administrative délivrée par la préfecture suite au refus et/ou retrait d’un titre de séjour pour un ressortissant étranger quelconque. Sur l’année 2024, une augmentation de 27% du nombre de ces OQTF a été enregistrée par les services du ministère de l’Intérieur. Ainsi, sur 134.000 individus expulsables, 21.601 seulement ont effectivement fait l’objet d’une procédure d’éloignement forcé (c’est-à-dire ont été appréhendés et reconduits par la police française). Dans le détail, près de 2 999 ressortissants algériens ont été remis à leurs autorités (+17% par rapport à 2023), 1 295 aux autorités tunisiennes (+46% par rapport à 2023) et 1 658 pour les autorités marocaines, ce qui représente une évolution de 50% par rapport au taux d’exécution de l’année précédente. Sur les trois pays nord-africains, l’Algérie est manifestement celui qui collabore le moins sur cette question. En effet, sur 33 754 interpellations, seulement 2 999 reconduites effectives ont pu être menées à bien, ce qui représente 9% d’OQTF réellement exécutées pour la population algérienne concernée (13% pour le Maroc et 10% pour la Tunisie). L’opacité de la gouvernance et les informations contradictoires provenant d’Alger font qu’il est difficile de déceler de manière précise les raisons pour lesquelles les autorités algériennes coopèrent moins que leurs voisins. Dernier incident en date, jeudi 6 mars 2025, deux ressortissants algériens, détenteurs d’un passeport en cours de validité, interdits de séjour en France, ont été reconduits, en matinée, par deux agents de police à l’aéroport d’Alger avant… d’être refoulés, à nouveau, par les autorités locales, pour “absence de laissez-passer consulaires”1. Une décision perçue comme “provocatrice” par le ministère de l’Intérieur français qui a rappelé les règles en vigueur lorsqu’un ressortissant algérien était détenteur d’un passeport en cours de validité.
Le manque de coopération des autorités algériennes sur ce volet est aujourd’hui devenu un point de discorde qui pousse le gouvernement français à mettre dans la balance les accords migratoires de 1968 invoquant le “non-respect” de la part de leur homologue de la rive Sud des clauses du contrat. Cependant, le Premier ministre français se trompe lorsqu’il invoque ces mêmes accords pour accuser les autorités algériennes de ne pas respecter leur part du contrat. En effet, aucune disposition concernant les procédures d’expulsion ou de reconduite à la frontière des ressortissants algériens en situation irrégulière n’est incluse dans les accords bilatéraux du 27 décembre 1968. Il aurait été plus judicieux de justifier un tel raidissement par le non-respect des obligations légales du gouvernement algérien (l’Algérie est signataire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, déclaration dans laquelle est prévu à l’article 13, alinéa 2 que « toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays« )2 et du principe de réciprocité devant présider à des relations diplomatiques saines et apaisées. Quelques jours plus tard, alors qu’il se trouvait en déplacement officiel au Portugal, le chef de l’État français avait, d’ailleurs, rappelé qu’il était “absurde” de remettre en question un tel accord et appelait à la reprise du dialogue.
Néanmoins, on voit mal comment les choses pourraient s’améliorer dans le sens d’une reprise de la coopération en sachant que l’imposition du rapport de force risquerait de braquer davantage un gouvernement algérien déjà peu disposé à régler cette problématique. De plus, tous les canaux de communication étant coupés – mis à part celui que tient encore sur un fil les services de renseignements extérieurs des deux pays – la possibilité même d’une reprise du dialogue semble illusoire.
Les solutions restantes sont peu nombreuses. Le ciblage des personnalités issues de la nomenklatura algérienne attend de faire ses effets. Si le rappel aux exigences de la partie algérienne dans les relations diplomatiques ou encore la fermeté sur les principes démocratiques – au moment où l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal est encore emprisonné – doivent être de mise, le gouvernement français gagnerait à sortir de la cacophonie et des rivalités dans les prérogatives ministérielles (entre le Quai d’Orsay et Place Beauvau) et exécutives (entre le président de la République et le Premier ministre). La crise franco-algérienne en cours, de par son acuité et son intensité, pourrait ouvrir la voie à un renversement des rapports existants à ce jour.
Le raidissement autoritaire de l’équipe dirigeante à Alger est une donnée avec laquelle il faut composer sans tomber dans la compromission et le court-termisme. Il est une évidence que le gouvernement français préfère la stabilité et le statu quo politiques actuels au chaos. Par ailleurs, l’absence d’une alternative crédible et fiable pouvant se substituer à la gouvernance actuelle opaque, autoritaire et hostile aux intérêts français contraint à la realpolitik. L’enjeu est alors de maintenir une pression suffisamment forte pour contraindre les autorités algériennes à une meilleure coopération sans précipiter un raidissement plus grand, voire une rupture dans les relations diplomatiques.
Depuis Lisbonne, Emmanuel Macron avait, lui-même, rappelé que ce qui le guidait désormais était le “principe d’efficacité” sur le dossier algérien. Entre l’agitation médiatique du locataire de Beauvau et le mutisme présidentiel, une troisième voie est possible. Celle d’une diplomatie exigeante et discrète, concentrée sur les leviers pouvant sérieusement constituer une pression sur les autorités algériennes (concertation, à l’échelle européenne, de la restriction du droit d’accès au territoire français pour les dirigeants et milieux proches du gouvernement algérien, convocation et protestation auprès des représentants algériens établis en France (consuls généraux), pression médiatique, réouverture des canaux de communication notamment via la coopération sécuritaire et diplomatique) de manière à les amener à la table de la négociation pour la révision des accords bilatéraux ou encore pour coopérer plus efficacement dans la reprise des ressortissants algériens constituant une menace pour l’ordre public.
Mardi 4 mars, un débat sénatorial sur les accords de 1968 avait conduit le ministre délégué rattaché au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Benjamin Haddad, à clarifier les attentes de l’exécutif français sur ce dossier. Après avoir rappelé que l’immigration irrégulière relevait, comme pour les autres nationalités, essentiellement du droit commun français, M. Haddad avait ouvert la voie à une renégociation des accords bilatéraux de manière à restreindre l’immigration familiale en contrepartie d’un amendement des règles encadrant celle de travail et étudiante. Comme pour ménager la chèvre et le chou, le ministre délégué propose de maintenir la spécificité de cet accord, à la charge symbolique forte, contre un nouvel avenant à négocier. Encore faut-il que de l’autre côté de la Méditerranée, des voix mesurées fassent pression pour que des gages de bonne volonté soient donnés. Cela passe par la libération d’un écrivain arbitrairement détenu et une coopération plus grande sur la réadmission des ressortissants sous OQTF.