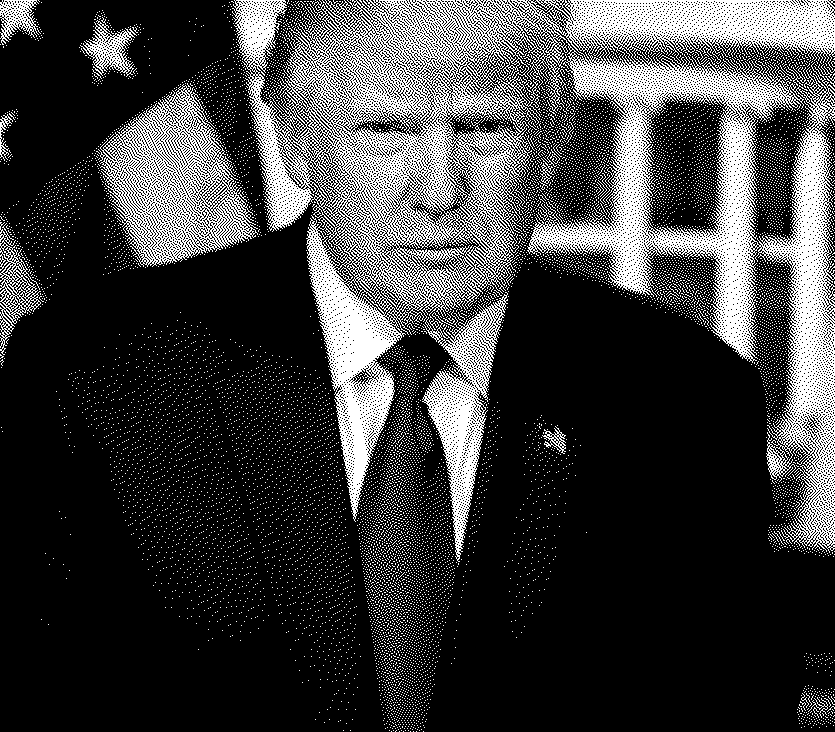Réunion d’une quinzaine de dirigeants d’États concernés à Londres le 2 mars, débat à l’Assemblée nationale, adresse empreinte de gravité du président de la République aux Français, décision du Conseil européen, le lendemain, de renforcer les moyens de défense de l’Union, dans le cadre de l’OTAN… La violence du traitement du président Zelensky, dans le bureau ovale, par Trump et son vice-président le 1er mars a déclenché sinon un véritable branle-bas de combat, du moins une mobilisation sur le Vieux continent pour rechercher une posture commune face à une telle situation de crise.
Ce nouvel accès de brutalité a surpris des alliés pourtant témoins des agissements et de la méthode du président depuis son élection et même depuis son entrée en campagne. La théâtralisation de l’action politique, le choix de la sidération et de la brutalisation verbale, le langage de charretier, l’intimidation, les mensonges, requalifiés en « vérités alternatives » et assénés avec aplomb, l’absence, désormais, des « adultes dans la pièce », remplacés pour ce second mandat par des inconditionnels, quelquefois plus radicaux encore que Trump, un parti républicain soumis sont les instruments et la marque de fabrique de cette administration. La procédure à laquelle les précédentes administrations avaient habitué les alliés était, à chaque mise en jeu de l’intérêt national, celle de délibérations internes précédant l’arbitrage présidentiel. Dans le cas de Trump, c’est lui qui définit l’« intérêt national » sans guère de filtres ni de contrepoids, guidé par un instinct que surplombe l’obsession de la transaction.
Mais, au-delà de la méthode, qui déroute les alliés des États-Unis, le plus grave est le changement de paradigme qu’il constitue et pour eux et pour l’avenir de la relation transatlantique. Si, comme ses prédécesseurs, Trump a une préférence pour une Europe faible et divisée plutôt que forte et capable d’agir, à la différence d’eux, qui poursuivaient cet objectif sans l’afficher ouvertement, le président des Etats-Unis ne s’embarrasse guère de précautions pour atteindre un but qu’il partage avec deux autres puissances, la Russie et la Chine.
Sans même mentionner les ingérences caractérisées dans la vie politique d’Etats du continent1, cette démarche embrasse les trois éléments principaux de la relation transatlantique, les relations commerciales, la diplomatie et la sécurité.
Matraquage douanier ou deal ?
Annoncé pendant la campagne de Trump, le relèvement des droits de douane sur des importations en provenance d’Europe est soit déjà acté – 25 % sur l’aluminium et l’acier, entré en vigueur le 12 mars – soit annoncé. C’est en effet lors de la fameuse réunion du 26 février, où il a employé une expression peu élégante vis-à-vis de l’UE2, qu’il a fait part de son intention de les relever à 25 % sur l’ensemble du commerce transatlantique, mais sans donner ni date ni détails, pour donner à l’administration le temps de définir des tarifs différentiels qui pénaliseraient davantage certains pays que d’autres, en fonction des affinités politiques avec leurs dirigeants ou d’autres considérations. Les arguments relèvent, comme souvent, de la plus parfaite mauvaise foi, tels que l’invocation d’un déficit commercial de l’ordre de 300 milliards de dollars vis-à-vis de l’UE, alors qu’il n’est que de 157 milliards d’euros pour les biens et tombe à 48 milliards seulement si on y inclut les services.
Les conséquences de cette incertitude sont lourdes, à en juger par les remous sur les marchés boursiers, par l’inquiétude du patronat européen3 avec une incitation à délocaliser des projets d’investissement industriel vers les États-Unis, où l’énergie est par ailleurs moins chère. Mais bien que Trump ait écarté d’un revers de main toute tentation européenne de menace de représailles, les Européens disposent d’instruments de rétorsion, parfaitement adaptés à une approche transactionnelle. La Commission a ainsi annoncé le 11 mars une première salve en réponse aux droits sur l’acier – à hauteur de 26 milliards de dollars, à partir du 1er avril, pour laisser un temps à la négociation, avec notamment des droits à hauteur de 50 % sur le whisky Bourbon, ciblé sur deux Etats très largement pro-républicains, le Kentucky et le Tennessee. Cette annonce a provoqué de nouvelles menaces, brandies par le président américain, de relever au taux prohibitif de 200 % les droits sur les vins et spiritueux européens, qui ont eu pour effet d’ébranler la cohésion du continent, avec l’apparition de critiques contre les choix de la Commission, émanant des pays les plus lourdement pénalisés par une telle mesure, comme la France, l’Italie et l’Irlande, à l’origine d’un report à la mi-avril de l’entrée en vigueur des droits de douane.
Mais l’escalade, si elle se poursuit, ne pourra cependant concerner que les importations depuis les Etats-Unis. Le président Trump ayant également relevé les droits de douane sur les importations de Chine, une conséquence probable sera un détournement vers le marché européen de biens chinois ainsi écartés du marché américain.
Diplomatie : entre brutalité et ingérence
L’impact de cette rupture est également sensible sur le terrain de la diplomatie, dont les méthodes sont bousculées. Celle-ci repose traditionnellement sur une discussion à huis clos, précédée d’un travail de préparation où se règlent les divergences et s’aplanissent les différends, dont les résultats sont généralement présentés au cours d’une conférence de presse et/ou d’un communiqué conjoint. L’administration Trump a abandonné ce schéma, au profit d’une préférence pour le registre du reality show devant des caméras, quasiment retransmis en mondovision.
On est également sortis d’un schéma classique d’influence discrète, où le benign hegemon4 faisait connaître par la voie diplomatique ses préférences aux alliés européens, une pratique illustrée par les préventions du président Reagan vis-à-vis de l’entrée de ministres communistes au gouvernement nommé en 1981 par François Mitterrand – que celui-ci avait d’ailleurs écartées – ou encore l’enrôlement de l’Europe centrale dans l’aventure irakienne en 2003…
Ces pratiques ont, là aussi, cédé la place à des méthodes qui relèvent de l’ingérence caractérisée dans les affaires intérieures des États européens, illustrées par l’acte, très politique, du vice-président Vance refusant, à Munich, de rencontrer le chancelier en exercice, pour rencontrer ostensiblement, à une semaine d’une élection législative, la dirigeante d’un parti néo-nazi, l’AfD. Cette démarche s’inscrit dans le sillage d’un Elon Musk, lequel n’est plus vraiment une personne privée, et qui a ouvertement apporté son soutien à ce parti, en mettant à son service toute la puissance de feu de son réseau social X.
Une autre illustration de cette posture est apportée par les pressions exercées par les Etats-Unis sur l’Union européenne pour retirer de sa législation sur les services numériques (DSA) les garde-fous qui encadrent la liberté d’expression, au motif qu’ils feraient porter un risque sur celle-ci. « La censure qui pourrait potentiellement découler du DSA est incompatible à la fois avec notre tradition de liberté d’expression en Amérique et avec les engagements que les entreprises technologiques ont pris sur la diversité d’opinions », a ainsi déclaré, le 3 mars à Barcelone, Brendan Carr, président de l’Agence fédérale américaine des communications (FCC).
Enfin, les États-Unis ont décidé de se retirer de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de l’Accord de Paris sur le climat et envisagent de faire de même vis-à-vis d’autres organisations de la famille des Nations Unies – l’UNESCO, le Conseil des droits humains et l’UNRWA5 – tous forums multilatéraux qui déplaisent à l’administration en place et auxquels les Européens sont profondément attachés. En regard de cette érosion du multilatéralisme, la préférence pour une bilatéralisation des relations avec les Etats du Vieux continent ouvre la voie à une intensification des pressions, des menaces, de l’intimidation, toutes sortes d’agissements qui ne contribueront sans doute pas à la cohésion des Européens.
La crédibilité perdue de la garantie américaine
C’est cependant sur le front de la défense et de la sécurité que le changement de paradigme relève du séisme – dont les répliques continuent de se faire ressentir. Il touche à la nature même de la réassurance américaine, à plusieurs égards, qu’il s’agisse de sa crédibilité, de ses contradictions ou de son articulation avec une démarche de défense proprement européenne.
Alors que le projet européen s’est développé sur un terreau préparé par les États-Unis, avec la création en 1948, de l’Organisation européenne de coopération économique (OECE), pour administrer collectivement le plan Marshall, le rejet français de la ratification du traité instituant la Communauté européenne de défense (CED) en 1954 a renvoyé le développement ultérieur de la fonction de sécurité vers un autre organisation, l’OTAN, gage de l’engagement des Etats-Unis dans la défense de l’Europe de l’ouest. Le marché commun créé dans les années 1950 a ainsi pu se développer et prospérer à l’ombre de la protection américaine contre la menace de l’Union soviétique tout au long de la Guerre froide. Et l’aura d’indéfectibilité de cette réassurance a perduré après la dislocation du camp communiste en 1991, amenant les Etats d’Europe centrale ainsi libérés à rechercher au plus vite leur adhésion à l’OTAN avant une probable résurgence d’une Russie provisoirement affaiblie par la perte de son empire.
Si les dirigeants européens n’ont, pendant plusieurs décennies, pas été effleurés par le doute quant à la pérennité de cette garantie, la campagne de Donald Trump pour son second mandat à semé le trouble dans les esprits. Et les mois consécutifs à son élection les ont véritablement fait tomber des nues. Les rodomontades du début de sa campagne6 pouvaient certes passer pour un bluff ou un chantage qu’atténuerait l’exercice des responsabilités.
Tel n’a cependant pas été le cas, comme on le constate jour après jour. Les accusations de « passager clandestin » alternent avec les épisodes de pression sur les Européens pour exiger d’eux des dépenses de défense de 5 % du PIB, un objectif7 rappelé en janvier à Davos, et assorti d’un renvoi, implicite ou explicite, vers des achats d’armement américain.
Les dirigeants du Vieux continent se retrouvent aujourd’hui face à un doute existentiel sur la crédibilité des garanties américaines de mise en œuvre de l’article 5 du traité de l’Atlantique nord, face au constat que cette dimension transactionnelle fragilise et mine le caractère sacro-saint que la plupart d’entre eux ont associé au couplage de sécurité transatlantique.
Une contradiction flagrante
L’exigence des 5 % s’applique à la défense par les Etats-Unis des Européens contre la seule menace militaire qui pèse sur le continent et qui émane de la Russie, perçue avec acuité par les pays de la « ligne de front », mais aussi par autres Etats membres, aux yeux desquels elle revêt une dimension « existentielle ». Mais cette posture américaine est, dans le même temps, en contradiction flagrante avec la connivence affichée par Trump avec Moscou, l’acceptation implicite des conditions formulées par Poutine vis-à-vis de de l’Ukraine – sur le sort du territoire occupé par la Russie ou le refus de son adhésion à l’OTAN – le rapprochement des États-Unis avec cette même Russie au point d’adopter ses éléments de langage, niant, par la résolution du 24 février de l’assemblée générale des Nations Unies, toute référence à l’agression russe.
Plus grave, alors que la défense de l’Europe incombe depuis trois quarts de siècle à l’OTAN, il n’est pas surprenant que rien ne puisse être entrepris par celle-ci sans acquiescement de Washington, mais cette organisation reste aux mains de la puissance américaine pour continuer de tuer dans l’œuf les tentatives de bâtir une Europe de la défense. Tel a d’ailleurs été le cas pendant des décennies, avec le soutien de quasiment tous les alliés européens, aveuglément confiants dans la garantie de sécurité américaine et tétanisés par le risque de la compromettre. Cette confiance a certes été mise à mal par l’enchaînement des événements depuis le retour de Trump aux affaires, inspirant des stratégies de contournement comme cette « coalition de volontaires » qui s’est dessinée à Londres le 2 mars, au lendemain du piège dressé à Zelensky à la Maison Blanche, et qui s’est développée ensuite en différents formats.
Des armes américaines sous conditions d’emploi
Mais au-delà des manœuvres d’obstruction de Washington, toute initiative pour donner corps à un embryon de défense européenne se heurte à un obstacle majeur, la nature des arsenaux détenus par presque tous les alliés européens, à l’exception de la France. Ces armements, américains ou intégrant des composants américains, sont soumis à des contraintes strictes, à la fois juridiques et techniques, quant à leur emploi. Sur le plan juridique, une législation dite ITAR, qui date de la Guerre froide, place tous les armements, après qu’ils ont été livrés, sous juridiction des États-Unis, ce qui impose une autorisation des États-Unis pour toute cession à une tierce partie8 – à l’Ukraine, par exemple. Chaque armement livré est également assorti d’un « accord d’utilisateur final », qui précise les conditions d’emploi du système9, prohibe toute modification du système sans autorisation et impose une obligation d’entretien et de contrôle.
Sur le plan technique, ces armements, souvent de technologies très avancées, sont tributaires de prestations d’entretien et de formation des personnels, de pièces de rechange, de mises à jour régulières des logiciels. Ils dépendent également, souvent, de services intégrés – de navigation, de communication, de détection, de ciblage de précision ou encore de renseignement – là aussi fournis par la partie américaine. Enfin, dans l’hypothèse où un Etat souhaiterait se servir de son armement à des fins jugées contraires aux intérêts américains, une option de désactivation à distance permet de neutraliser le système d’arme.
Ces régimes s’appliquent à des arsenaux européens dont les éléments les plus sensibles sont largement américains : les avions de combat et hélicoptères d’attaque Apache, les systèmes de défense aérienne (sol-air, mer-air) et les missiles à vocation offensive, qui forment, selon les cas, entre la moitié et 80 % de ces types d’armes dans les arsenaux des pays les plus concernés. Dans certains cas, comme celui de la Pologne, plus de la moitié de l’ensemble de l’arsenal est d’origine américaine. La flotte aérienne de plusieurs pays alliés membres de l’Union européenne est composée de F15 (environ 150) et de F-16 (de l’ordre de 350) en cours de remplacement par des F-35 (120 en service et 200 commandés). Et quand bien même aucune nouvelle acquisition ne serait plus, désormais, faite aux États-Unis, ces équipements resteront dans les arsenaux des alliés concernés pendant plusieurs décennies encore. Mais indépendamment de ce paramètre de durée de vie des inventaires existants, il apparaît souvent difficile de les remplacer par des armements strictement européens, soit parce que ceux-ci ne sont pas disponibles « sur étagère » ou n’existent tout simplement pas. Des années de recherche et développement seraient nécessaires pour combler ces « lacunes capacitaires ».
Au total, on est, sur ce terrain, loin de cette « souveraineté européenne » que le président Macron appelait de ses vœux et dont on ne peut se rapprocher que très progressivement. Mais surtout le paradigme de la confiance dans les États-Unis pour assurer la protection de l’Europe – qui était le pilier de la garantie de sécurité transatlantique – est désormais sérieusement écorné. Le revirement de Trump sur l’Ukraine, que certains voulaient voir comme l’aiguillon d’une prise en charge par les Européens de leur défense, s’avère être le révélateur d’une emprise des États-Unis sur une Europe très dépendante de la protection américaine et qui n’a guère d’atouts pour défendre ses intérêts de sécurité lorsqu’ils divergent de ceux des États-Unis.
Cette dépendance systémique, acceptée et assumée, vis-à-vis des États-Unis, dont l’engagement était tenu pour acquis, était depuis trois quarts de siècle la contrepartie de la protection du Vieux continent. Dès lors que celle-ci se délite, l’Alliance atlantique apparaît comme un instrument de domination de l’Europe et d’extorsion de fonds par une puissance aux mains de ce que le sénateur Claude Malhuret a qualifié d’une véritable « cour de Néron ».
En guise de conclusion, deux questions restent ouvertes.
La forme de Blitzkrieg et d’assauts-surprise infligés par Trump à des alliés pris au dépourvu, avec pour objectif de les sidérer, de les déstabiliser, d’imposer un rapport de forces nouveau et de gérer, dans les conditions continûment redéfinies, la mosaïque des États européens a bien eu cet effet. Ce qui est encore nimbé d’un brouillard épais est le chemin critique ouvert à des Européens – entendus ici au sens large, c’est-à-dire hors UE également – aux intérêts souvent divergents, tenus par des liens de dépendance, affectifs quelquefois, d’armement très souvent, envers les États-Unis et qui ne sont pas nécessairement prêts à couper le cordon ombilical. En tout état de cause, plus les alliés européens auront recours aux achats aux États-Unis, plus ils se mettront dans les mains d’une Amérique imprévisible quant à l’utilisation, à des fins de défense européenne, de ces armements.
Une seconde question encore sans réponse porte sur la signification de ce renversement de polarité dans la relation avec la Russie est encore obscure. S’agit-il d’un simple mouvement pour apparaître comme le « faiseur de paix », fût-ce une paix léonine ? Ambitionne-t-il de libérer les mains de l’Amérique en Europe pour concentrer ses forces sur la rivalité avec la Chine, voire enfoncer un coin entre celle-ci et la Russie ? Ou encore faut-il voir là les prémisses d’une alliance idéologique entre deux régimes autour de mots d’ordre réactionnaires capables de rallier d’autres nations européennes ?