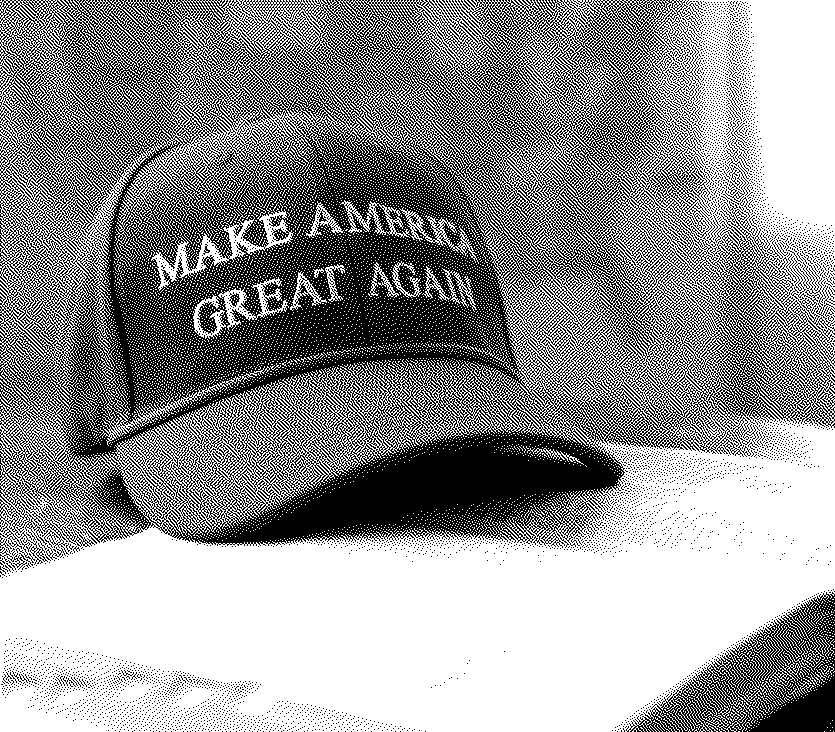« N’oubliez pas que nous avons un pays à sauver », Donald Trump, 22 février 2025
Depuis le 20 janvier dernier, des commentateurs se succèdent sur les plateaux de TV pour expliquer d’un air pénétré qu’il ne faut pas prendre Donald Trump « pour un imbécile », qu’il a « un plan », qu’il est « rationnel ». Si nous ne le comprenons pas, c’est simplement parce qu’il parle une langue qui n’est pas la nôtre, celle d’un deal maker qui ne connaît que la négociation et la transaction. Alors que nous autres, pauvres Européens, nous ne connaîtrions rien de tout cela.
Tout ceci est en réalité une fable. Donald Trump a certainement davantage réfléchi qu’en 2016, mais pas du tout mieux. Il a en effet un plan, mais il est très mauvais. Et il est certes beaucoup plus entouré, mais par des idéologues enragés prêts à s’entre-déchirer.
Trump parle sans cesse de deals et de transactions, mais en pratique il confond discussion et ultimatum, tractation et menace, marchandage et insulte. Dans la plupart des dossiers, il se montre autoritaire, brutal et maladroit. Il s’aliène même ses plus anciens alliés. Il laisse ainsi son vice-président traiter ses partenaires européens comme des vassaux administrant de lointaines provinces aux marches de l’empire. Il a même réussi à faire de son grand voisin canadien un adversaire résolu. Et, surtout, si l’on met de côté quelques succès obtenus sous la menace d’une intervention armée au Panama, il est jusqu’ici presque parfaitement bredouille.
Même des deals aussi asymétriques que celui qui était envisagé avec la pauvre Ukraine sur ses terres rares sont toujours dans les limbes. Pour ne rien dire de la paix promise en 24h entre Kiev et Moscou : les parties se sont bien assises autour de la table, mais elles n’ont abouti à rien. La partie russe en particulier n’a renoncé à aucune de ses prétentions, bombardant de plus belle le territoire ukrainien dont elle ne réclame pas seulement de larges morceaux mais aussi la démilitarisation totale. Devant l’activité continue de l’artillerie russe, Trump s’est déclaré très fâché.
En rétorsion, il a brandi la menace d’une augmentation des droits de douane sur les exportations de Moscou vers les États-Unis, mais celles-ci sont aujourd’hui au niveau où elles se trouvaient en 1992, c’est-à-dire proches du plancher (à peine 3 Mds de dollars). Donald Trump s’est peut-être ici contenté de feintes. Mais le résultat est le même : non seulement la paix mais même un cessez-le-feu partiel semblent à ce jour hors de portée. Poutine qui en a vu d’autres – Trump est le cinquième président des États-Unis auquel il ait affaire – excelle à multiplier les préalables, notamment sur la circulation des marchandises en Mer Noire et les exportations agricoles russes. Résultat, les discussions s’enlisent, la guerre d’attrition se poursuit et ce joueur pressé qu’est Donald Trump, avide de victoires simples et rapides, regarde déjà ailleurs. On ignore encore dans quelle farine les Iraniens rouleront demain Potus mais celle de Poutine a été jusqu’ici très efficace, comme l’avait été en son temps celle de Pyongyang, un autre de ces sujets compliqués qui ont très vite « lassé » Donald Trump, comme le notait récemment Philippe Ricard.
Trump veut par ailleurs imposer sa loi commerciale, s’estimant arnaqué de toutes parts par des partenaires internationaux qui auraient injustement profité de la mansuétude de ses prédécesseurs1. Pour cela, il dégaine son arme favorite : les fameux « tariffs » dont le mode de calcul n’épouse rigoureusement aucune rationalité. Le 2 avril, célébré comme le « jour de la libération » (liberation day), il annonce un taux plancher de 10% pour tout le monde et de 20% pour l’Europe, 34% pour la Chine (en plus des 20% existants), 24% pour le Japon, etc. Il est à noter que la Russie et la Corée du Nord ne reçoivent aucun droit de douane !
Son initiative affole aussitôt les bourses, crée de l’incertitude jusque sur les marchés obligataires et sur la dette américaine, déprime les investisseurs et inspire de sombres prévisions aux conjoncturistes et aux banquiers centraux de la planète qui entrevoient tous un fort ralentissement de la croissance, y compris et d’abord aux États-Unis. Les Américains dont les retraites reposent pour l’essentiel sur de la capitalisation et qui investissent en bourse une partie de leur épargne pour payer les études de leurs fils et de leurs filles voient fondre leur avenir et celui de leurs enfants avec la valeur de leurs placements. Finalement, Trump parvient à cet exploit : rapprocher Pékin, Séoul et Tokyo, et radoucir les relations entre Pékin et Bruxelles.
Au bout du compte, devant les dégâts incommensurables de ses annonces intempestives, le génie de Mar-a-Lago doit se retirer dans l’ordre et la discipline dès le 9 avril, gelant pour 90 jours son « plan » tout en jouant l’escalade avec la Chine. Dans un élan de générosité inattendu, il félicite les Européens pour leur « intelligence » – une qualité dont il se juge le mètre étalon. Mais son attitude vis-à-vis de Pékin risque de le conduire à des déconvenues encore plus coûteuses. Car les conséquences du nouvel équilibre de la politique commerciale américaine (145% pour la Chine et 10% pour le reste du monde) sont en réalité plus élevées en termes de pouvoir d’achat et d’inflation que la situation précédente (20% pour l’Europe, etc.). C’est ce que montrent les économistes du Yale Budget Lab. Cela tient, comme le soulignait récemment Paul Krugman, au poids colossal de la Chine dans les importations américaines. Ce dernier « deal » pourrait se traduire par une augmentation de 2,9% des prix à la consommation, soit environ 10 fois l’impact de la loi Smoot-Hawley sur les droits de douane en 1930, au moment de la Grande Dépression. Résultat, la plupart des électeurs MAGA de l’Ohio ou du Tennessee ne pourront plus s’acheter un iPhone ou un ordinateur. Heureusement, grâce à la dernière géniale reculade de Donald Trump, les smartphones et les ordinateurs sont finalement exclus de l’augmentation des droits de douane sur la Chine…
Le génie trumpien consiste en fin de compte à vouloir en même temps une chose et son contraire. Il veut ainsi des droits de douane transitoirement élevés, le temps de renégocier les termes de l’échange avec ses partenaires. Mais il veut aussi maintenir ces barrières tarifaires dans la durée pour financer durablement ses baisses d’impôts. Car ce ne sont pas les coupes d’Elon Musk dans les dépenses fédérales qui suffiront à régler le problème du déficit public américain. En 2024, le budget fédéral des Etats-Unis s’est élevé à 6 750 milliards de dollars. Environ les deux tiers de cette somme consistent dans des dépenses obligatoires pré-programmées par différentes lois : ce sont pour l’essentiel des dépenses sociales (Medicare, Medicaid, retraites de personnes handicapées, coupons alimentaires, etc.) et il n’est pas prévu que l’administration Trump rogne de ce côté-là. Sur les 40% restants, 10% sont consacrés à payer les intérêts de la dette américaine (dette qui atteint 36 000 milliards de dollars la même année, soit 100% du PIB, plus très loin du record de 1946, au sortir d’une guerre mondiale). Restent donc 30% consacrés aux dépenses dites discrétionnaires dont près de 1000 milliards de dollars de dépenses militaires – là encore, pas question de rogner là-dessus. Au total, le gisement de dépenses « arbitrables » dans lequel Musk peut imaginer des coupes s’élève en théorie à 700 à 800 milliards de dollars (Éducation, Transports, Justice, Recherche…). Or, le déficit américain s’élève, lui, à 1 833 milliards de dollars, soit plus du double. Autrement dit, même si Elon Musk procédait à une coupe rase de toutes les dépenses discrétionnaires hors défense nationale, demeurerait encore un besoin de financement équivalent au volume des économies réalisées. Et, de toutes façons, l’Amérique serait à genoux avant cela.
Les ambitions de Trump ne s’arrêtent pourtant pas là. Il veut aussi que ses droits de douane incitent les investisseurs et industriels étrangers à créer des emplois manufacturiers sur le sol américain. Mais le président américain serait bien en peine de dire qui pourrait occuper ces emplois le moment venu : l’Amérique est en effet au plein emploi. Le taux de chômage y est à 3%, soit un chômage presque essentiellement frictionnel qui cohabite avec d’importantes tensions de recrutement et pénuries de main d’œuvre. Et comme Potus a par ailleurs décidé de raccompagner des millions d’immigrés au sud de la frontière mexicaine (si possible sous l’œil des caméras de TV, avec menottes aux poignets et gifles sur la nuque), il peut de moins en moins compter sur cette armée de réserve bon marché. Au point que le gouverneur de Floride, l’ultra-conservateur Ron DeSantis, se demande si, pour faire face aux pénuries de main d’œuvre liées au départ des immigrés, il ne faudrait pas autoriser le travail de nuit pour les mineurs de 14 ans…2 On passe sur les effets inflationnistes de cette politique migratoire.
Trump a également des idées sur la monnaie. Il veut un dollar plus faible pour doper la compétitivité des exportations américains qui sont, selon lui, directement victimes de la surévaluation du billet vert. Soit, même si le chemin pour y parvenir risque d’être très étroit comme l’a montré ici même François Meunier. Mais, et c’est là que les choses se compliquent à nouveau, Trump veut aussi que tout le monde continue à acheter des dollars et à en conserver par devers soi pour garder le bénéfice de la monnaie de réserve internationale.
Même jeu sur la dette publique américaine (36 000 milliards de dollars à ce jour). Il veut des taux plus bas sur les titres souverains américains. Il est vrai que l’augmentation des taux a porté les intérêts de la dette à des niveaux stratosphériques ces derniers temps (près de 700 milliards de dollars en 2024). Mais le génie de Mar-a-Lago veut aussi que le monde entier continue de se ruer sur les bons du Trésor américain afin de financer les déficits futurs des États-Unis. Malheureusement pour lui, dans la tourmente financière mondiale causée par ses annonces, les primes exigées par les investisseurs sur les titres souverains américains se sont appréciées, renchérissant d’autant le coût de la dette américaine. Les obligations du Trésor à 30 ans ont ainsi atteint un pic à 4,8% au plus fort de la tempête alors qu’elles servent habituellement d’actifs refuge en pareille circonstance. Bref, la politique de Donald Trump a réussi un autre exploit : rendre concevable dans l’esprit des investisseurs l’existence d’un risque-pays sur les États-Unis d’Amérique.
Donald Trump veut également forer à tour de bras (« Drill, baby, drill ») au mépris des impératifs climatiques. Mais la perspective d’un ralentissement économique consécutif à ses multiples erreurs de jugement, conjugué aux décisions de ses amis de l’OPEP, ont fait s’effondrer les cours du brut (-15 US dollars le baril depuis son investiture). Et comme les hydrocarbures américains sont plus chers à extraire (principalement du fait des gisements de schiste qui nécessitent des techniques de fracturation hydraulique), il est probable que cette conjoncture freine finalement l’investissement dans les projets de forage et qu’elle en pousse d’autres à la faillite.
Le Président américain est certes plus entouré que lors de son premier mandat en 2016 et il compte dans sa cour des gens tout à fait cortiqués et articulés. Mais ce sont pour l’essentiel des idéologues enragés et revanchards : Elon Musk en libertarien échevelé qui coupe à la tronçonneuse dans les effectifs de l’administration et des agences fédérales ; Peter Navarro en doctrinaire protectionniste et anti-chinois, co-auteur du récent fiasco sur les droits de douane « réciproques » ; J.-D. Vance en ambassadeur populiste autoproclamé de Main Street contre Wall Street ; etc. Le problème n’est pas seulement ce qu’ils disent ou ce qu’ils pensent, mais les profonds désaccords qui les animent. Le premier ne goûte pas du tout la politique des droits de douane que soutient le second ; le troisième dit détester les milliardaires amis du premier ; le premier ne goûte pas vraiment la politique migratoire défendus peu ou prou par les deux autres, etc. Non seulement il n’y a plus d’adultes dans la salle, mais les enfants semblent prêts à se battre entre eux.
Alors Donald Trump n’est sans doute pas un fou, ce n’est peut-être ni Néron ni Caligula, mais c’est une catastrophe pour le monde et les États-Unis. Il ne rendra pas son pays « great again », mais plus faible et plus dangereux. Plus ignorant aussi : il a condamné au silence les sciences qui n’ont pas l’heur de lui convenir ou de valider ses préférences, à commencer par les sciences du climat. Il a même nommé au cœur de son Administration des hommes comme Robert Kennedy qui professe de dangereuses contre-vérités (par exemple, la responsabilité des vaccins dans la supposée « épidémie d’autisme ») et menace la santé publique aux États-Unis. Dans un élan orwellien assez commun dans les régimes fascistes, Trump a décidé enfin de s’en prendre à la langue elle-même pour que soient bannis du vocabulaire et des actes publics une longue série de mots.
Plus ignorant et plus inhumain : Trump regarde les migrants comme du bétail humain destiné à la déportation. Il ne veut pas seulement pour eux la « remigration » mais sa mise en scène télévisée : pour qu’elle puisse être acclamée, sa politique prend la forme d’humiliations publiques qui excitent la joie mauvaise de ses partisans les plus militants. Il rejoint également Netanyahou dans l’idée que les Gazaouis feraient mieux d’aller vivre ailleurs que dans ce territoire méthodiquement détruit par le gouvernement d’extrême-droite israélien et où une magnifique riviera pourrait demain attirer les touristes fortunés du monde entier (mais naturellement il ne s’est nullement préoccupé du consentement de l’Égypte, de la Jordanie ou de tout autre voisin pour les accueillir).
Il n’est pas exagéré de dire que Donald Trump détruit chaque jour un peu plus ce qui a fait non seulement la puissance mais justement la grandeur de l’Amérique. Où donc se cache l’étincelle de génie qu’on lui prête, la lumineuse vision qu’aveuglés par nos préjugés de vieux Européens pusillanimes, nous serions incapables de reconnaître ? Il est plus probable qu’au contraire, il nous attire dans la nuit. Quelle que soit l’issue de cette aventure, les défenseurs de la démocratie tocquevillienne en sortiront désarmés.
L’Amérique de Trump se prend pour Rome, mais ce n’est ni celle de Cicéron, ni celle d’Auguste. Plutôt celle de Commode (180-192) : cet empereur mégalomane et autoritaire, qui se comparait à Hercule, mit fin à la pax romana et au « siècle d’or » de l’empire en même temps qu’à l’illustre dynastie des Antonins (Hadrien, Marc-Aurèle…). Non seulement le Sénat lui refusa la divinisation, mais il le condamna à l’oubli en lui infligeant la peine posthume de damnatio memoriae.