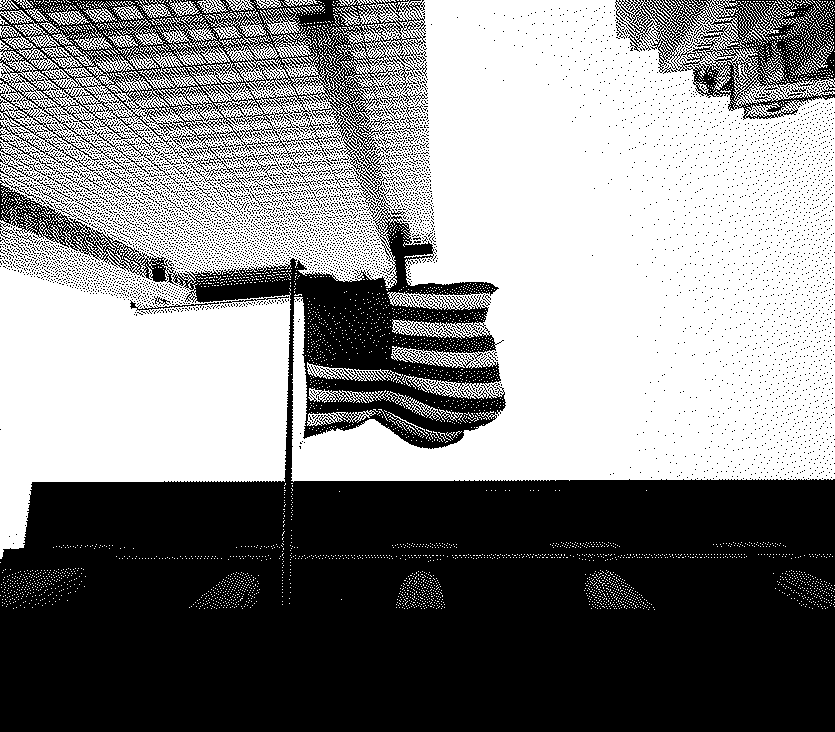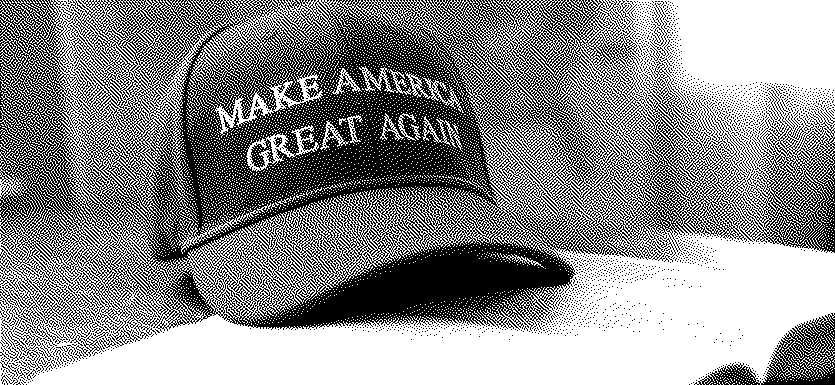Ce devait être l’apothéose du génie trumpien, de son art du deal et de sa capacité à bâtir des rapports de force avec tous ces pays qui « arnaquent » les États-Unis. Ce fut un fiasco financier et politique : chute de la bourse, crise majeure du marché obligataire, affaiblissement du dollar, perte de confiance des investisseurs et des consommateurs, effondrement des réservations touristiques vers le pays. Le chaos était tel qu’une retraite peu glorieuse fut organisée à la hâte dès le 9 avril. Cette semaine délirante n’a pas seulement confirmé ce que beaucoup savaient déjà à propos de Donald Trump, à savoir son ignorance économique, son inconstance, son absence de vision, et sa mégalomanie. Les marchés financiers lui ont cruellement rappelé que le commerce international n’est pas un jeu de cubes qu’on démolit et reconstruit à sa guise. De façon beaucoup plus intéressante, elle a montré qu’un nouvel ordre mondial post-américain était possible et souhaitable, et que l’affaiblissement de l’imperium américain était une réalité. Les décisions désordonnées et absurdes de Donald Trump ont mis en lumière ce déclin, accélérant une prise de conscience du reste du monde qu’un nouvel ordre doit être bâti.
Dans son éditorial du jeudi 10 avril, le Financial Times écrit : « Les efforts désordonnés de Trump pour réorganiser complétement le commerce mondial ont ébranlé tous les piliers qui soutiennent une monnaie de réserve : la stabilité, la fiabilité, une politique économique solide et l’État de droit. Les marchés obligataires ont réagi en lançant un avertissement clair : les systèmes peuvent changer ; un monde post-dollar est possible. Rebâtir la confiance sera difficile… La domination financière des États-Unis ne peut plus être considérée comme acquise. » Cette domination financière repose sur une monnaie qui sert de réserve mondiale (60% des réserves de change mondiales sont détenues en dollars), et sur un marché obligataire des bons du trésor considéré comme le plus profond, le plus sûr et le plus liquide du monde. Mais tout cela exige de la confiance et de la réciprocité. Les pays qui ont des excédents commerciaux avec les États-Unis les investissent en bons du trésor, ce qui permet à ces derniers de financer leur dette à des taux très avantageux. Et ce qui s’est passé cette semaine est un rappel que la dette américaine est entre les mains d’investisseurs étrangers, en particulier japonais, qui en possèdent la part la plus large (1000 milliards de dollars), suivis par les Chinois (760 milliards). La punition infligée au marché obligataire américain est la conséquence directe du « liberation day », elle a exhibé la fragilité américaine et montré la voie d’une réorganisation du marché financier mondial.
Un retour au statu quo ante est absolument impossible, pas seulement parce que les embardées de Trump vont continuer, mais aussi parce que la guerre commerciale déclenchée par les États-Unis contre la Chine est loin d’être terminée, et qu’une victoire de la Chine est l’hypothèse la plus probable. Dans ce genre de bras de fer où les peuples souffrent des décisions de leurs gouvernants, c’est le pouvoir qui peut faire supporter la plus longue souffrance à son peuple qui l’emporte. Et, de ce point de vue, Xi Jinping a plusieurs longueurs d’avance sur Donald Trump, même si celui-ci se rêve en dictateur MAGA. Les Chinois ont encore une mémoire vivace des Traités inégaux, et les armes dont disposent la Chine , la dévaluation du yuan, les créances sur la dette américaine et surtout le contrôle des terres rares, ont de quoi faire plier les États-Unis. Le subtil embargo déclenché sur les terres rares, au motif qu’il faut du temps pour réécrire les licences d’exportation, donne des sueurs froides à tous les industriels américains des industries de défense, de l’électronique ou de l’automobile, leurs lignes de production risquant de s’interrompre à très court terme. Le chaos trumpien est certes mondial, mais c’est aux États-Unis qu’il a déjà le plus d’impact.
De plus, les droits de douane maintenus avec l’Europe et l’Asie (hors Chine) restent prohibitifs, et une récession mondiale se profile à l’horizon. La crise de confiance est durable, elle affecte tous les acteurs économiques et la plupart des pays, à commencer par ceux de l’Union Européenne, élaborent des stratégies de contournement des États-Unis et tentent de nouer des accords commerciaux autonomes. La dépendance à l’égard des États-Unis, qu’il s’agisse de commerce, de défense ou de technologie, est devenu un risque trop important pour que le reste du monde continue à l’accepter. Ce nouvel ordre post-américain prendra du temps à se construire mais le processus est enclenché et l’on ne voit pas ce qui pourrait l’arrêter.