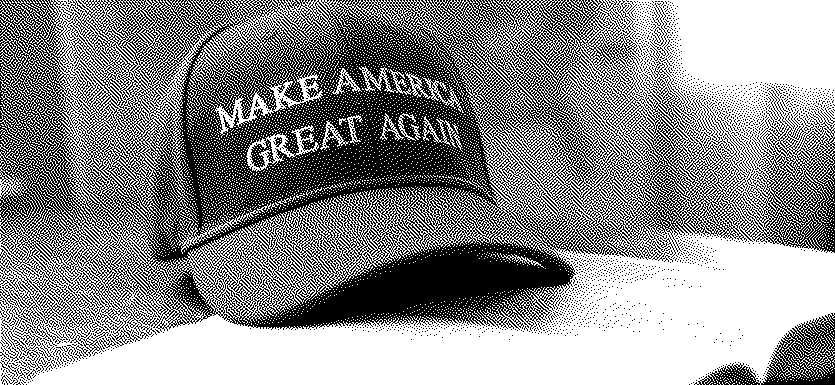Lors des dernières élections européennes, en 2019, le message entendu à Bruxelles par la nouvelle Commission et par le Parlement concernait le défi du réchauffement climatique. Concrètement, au cours de la législature écoulée (2019-2024), un ambitieux et très vaste Plan Vert a décliné les actions pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Cette année, la poursuite de cette ambition est menacée par la montée de mouvements populistes qui, sans contester le réchauffement lui-même, considèrent que l’Europe va trop loin, trop vite. Un tel coup d’arrêt nous ferait dévier de la trajectoire engagée vers une économie décarbonée et nous menacerait du même coup de déclassement dans le déploiement des technologies « net zéro » qui sont au cœur d’une nouvelle révolution industrielle. C’est pourquoi, le choix des électeurs revêt cette année une importance capitale.
Les mouvements populistes, donnés en tête dans plusieurs pays, n’auront probablement pas les moyens de former une majorité au Parlement européen. Divisés, souvent inconsistants et incohérents dans leur programme, ils ne présentent pas une stratégie alternative. Mais leur poids peut inciter les conservateurs réunis dans le Parti populaire européen (PPE) à infléchir leurs votes vers l’extrême droite et à accepter la voie de l’immobilisme environnemental. Celui-ci retarderait l’indispensable adaptation de nos économies et maintiendrait nos dépendances notamment énergétiques vis-à-vis des pays exportateurs de pétrole et de gaz. Ceux-ci ne jouissent pas seulement d’une rente économique, ils savent aussi tirer parti d’une dépendance dont on a vu l’importance géostratégique entre les mains de la Russie. Les partis nationalistes qui se disent volontiers « souverainistes » sont en réalité objectivement opposés à l’autonomie européenne en matière industrielle et énergétique. Ils représentent la voie du renoncement et du déclin de l’Europe.
C’est au contraire dans la voie de la coopération que les Européens doivent poursuivre et amplifier les efforts engagés. Les défis ne manquent pas : décarbonation de nos économies, renforcement de nos capacités de défense militaire, adaptation à la révolution numérique, réindustrialisation, accompagnement de la recherche et de l’innovation, stabilisation de nos voisinages avec le soutien à l’Ukraine et aux autres pays, comme la Géorgie, menacés par l’impérialisme russe. Aucune réponse strictement nationale n’est à la hauteur de ces enjeux. Dans les cinq dernières années, l’Union européenne a montré qu’elle n’était ni paralysée ni naïve. Elle a su se montrer plus solidaire et lutter contre le dumping social. Elle a trouvé les réponses communes à la crise du Covid-19, en particulier grâce à un plan de relance financé par un premier emprunt en commun. Elle a réagi rapidement et avec fermeté contre l’agression russe en Ukraine en votant plusieurs séries de sanctions et en accompagnant l’Ukraine, par des financements et par des livraisons d’armes. Dans un contexte géopolitique devenu plus instable, elle aura à nouveau à surmonter des crises. Pour garder sa capacité à y faire face, elle doit sortir renforcée et non affaiblie du vote du 9 juin.