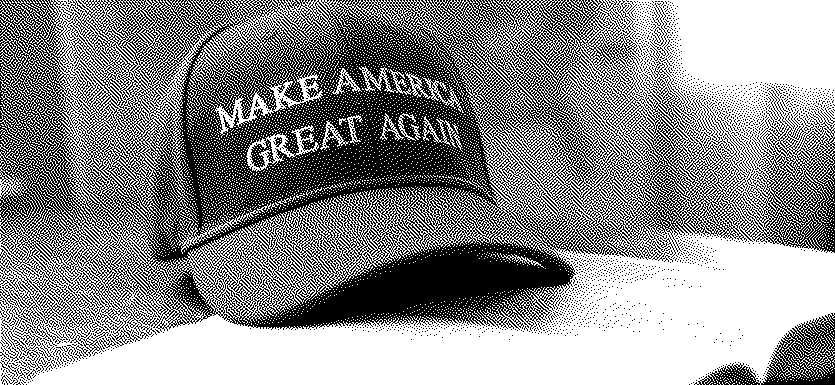La volonté de changer les règles du jeu international fait clairement partie des obsessions de la nouvelle équipe de Washington, appelée au perdurer au-delà de premier round de conflit sur les droits de douane. Comme l’a clairement formulé Marco Rubio, le secrétaire d’État, lors de son audition de confirmation devant le Sénat : « l’ordre international d’après-guerre est désormais une arme tournée vers les Etats-Unis ». C’est particulièrement vrai pour Trump en matière commerciale.
Mais pourquoi revenir sur le libre-échange qui a apporté tant d’avantages aux Etats-Unis ? L’économiste François Meunier reconstitue la thèse qui prévaut aujourd’hui à la Maison Blanche sur la meilleure manière de redonner de la compétitivité à l’économie américaine dans un système international désormais dominé par des rapports de force entre puissances impériales. Un économiste, Stephen Miran, depuis nommé à la tête du Comité des conseillers économiques de la Maison blanche, a formulé la doctrine qui donne un semblant de cohérence aux intuitions du Président. Il est utile de comprendre ce raisonnement visant à remettre les États-Unis au premier plan, bien que les outils mobilisés (le chantage brutal ou les droits de douane), aient peu de chances de permettre d’atteindre ces objectifs.
Poutine partage avec Trump une vision des relations internationales où les rapports de force prédominent sur les règles multilatérales et où l’avenir appartient aux puissances impériales. Mais Poutine a-t-il les moyens économiques de ses ambitions ? L’économie russe peut-elle soutenir l’effort de guerre qui ne cesse de s’affirmer depuis deux ans ? Pour le savoir, il ne suffit pas de s’en tenir aux déclarations officielles du Kremlin, alors que la propagande est devenue le standard de communication des autorités russes. Il est possible, montre l’économiste Artem Kochnev, de décrypter les chiffres officiels russes pour se faire une idée assez précise de la situation économique de la Russie. Dans l’économie de guerre qui s’est mise en place, la dépense publique soutient pour le moment l’activité et les salaires. On comprend, réciproquement, que la sortie de guerre signifierait une transition délicate à gérer d’un point de vue économique, l’atterrissage signifiant une austérité dont la population aurait, une fois de plus, à payer le prix.
L’actualité géopolitique occulte les efforts de la transition climatique. Après de longs mois d’atonie, la politique climatique française a été réaffirmée lors d’un conseil de planification écologique début avril. La forêt joue un rôle dans cette stratégie, non seulement pour protéger la biodiversité mais aussi comme puits carbone. Pour réagir à la note de Frédérik Jobert publiée par Terra Nova, Julie Marsaud présente les priorités identifiées par WWF France pour l’avenir de la forêt française. Constatant une convergence de vues avec l’ancien conseiller du Secrétariat général à la planification écologique (SGPE), l’ONG se demande pourquoi ses propres recommandations ont été jusqu’à présent si peu prises en compte et comment passer véritablement à des décisions salutaires pour la forêt.