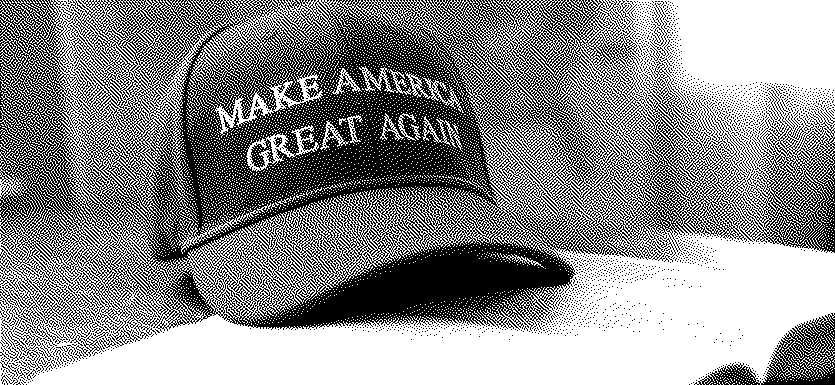Coupes budgétaires, suppressions de poste, intimidations : la mise au pas des services publics, des institutions universitaires et des centres de recherche est au centre du programme idéologique de Donald Trump. Dès les premières semaines de mandat, les sites des institutions fédérales ont été expurgés de termes jugés non conformes — climat, genre, diversité — dans un geste de censure inédit. Cette volonté de contrôle qui s’étend jusqu’aux archives publiques apparaît tout à fait inhabituelle aux yeux de l’historien Philippe Darriulat. La constitution des archives publiques accompagne toujours le renforcement de l’Etat. Ici, c’est l’inverse qui se joue : un affaiblissement délibéré des institutions publiques de la connaissance. La nature du nouveau pouvoir américain se révèle dans cet obscurantisme assumé.
Selon la Maison Blanche, la guerre des droits de douane vise à renforcer l’économie américaine. Mais les effets immédiats du « liberation day » ont été tout autres : chute des marchés, hausse des taux d’intérêt sur les bons du Trésor — donc renchérissement du coût de la dette publique —, et affaiblissement du dollar. Le changement de cap n’a pas tardé à Washington, même si l’escalade avec la Chine s’est encore aggravée. Et la Chine semble mieux armée que les Etats-Unis dans cette guerre « jusqu’au bout ». N’est-ce pas trop tard pour rétablir le crédit des Etats-Unis et leur rôle central dans les échanges mondiaux, se demande Jean-Louis Missika ?
L’image flatteuse du président américain stratège, « faiseur de deal », visionnaire, s’en trouve affaiblie. Des commentateurs impressionnés ou opportunistes entretiennent le mythe du Président « qui a un plan ». Mais à y regarder de plus près, ce plan peine à prendre forme, remarque Thierry Pech. Sur les dossiers internationaux — Ukraine, Gaza — aucune avancée ne se dessine. Seule l’influence de la Russie sur la politique américaine semble avérée. Sur le terrain économique, les décisions se superposent dans une série d’improvisations, où les impulsions se contredisent et s’annulent. Plus encore, c’est le paradoxe d’une puissance qui semble saboter elle-même les fondements de son influence économique mondiale qui surprend. Le trumpisme est-il un art de perdre plutôt qu’un art du deal ?