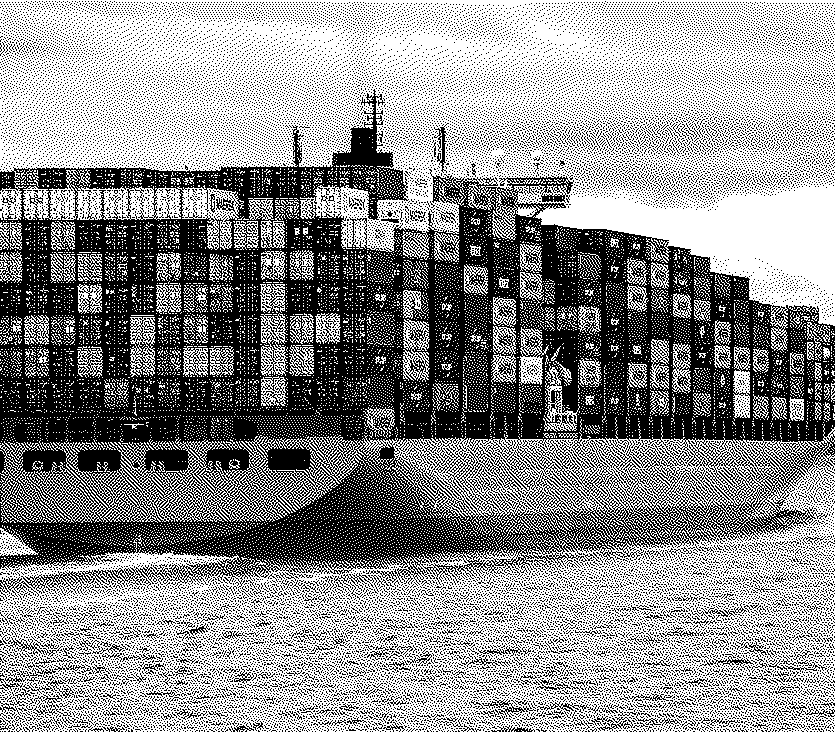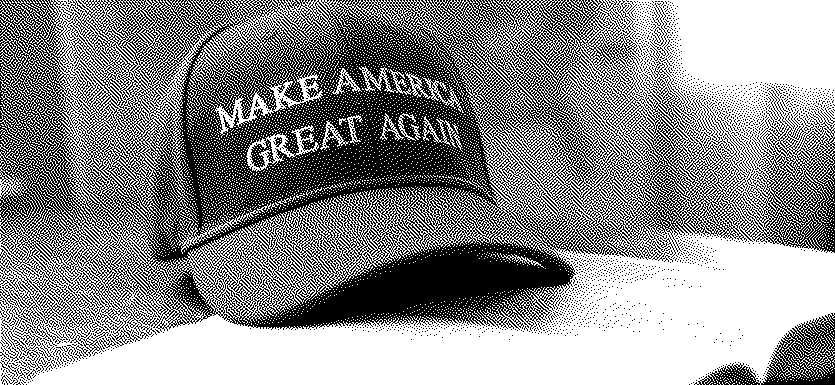Contexte
Ce contexte est marqué par trois éléments. Premièrement, un excédent commercial de l’UE vis-à-vis des États-Unis pour les marchandises. C’est le marqueur principal pour l’administration américaine. En intégrant les échanges de services (y compris les droits de propriété intellectuelle) où l’UE est déficitaire, et les revenus des investissements, la relation est pourtant à l’équilibre. Pour reprendre l’image de l’économiste en chef d’Axa Gilles Moëc pour décrire la relation UE/États-Unis : « les Européens (les Allemands) partent le matin fabriquer des automobiles qui seront vendues aux États-Unis, dans des usines qui utilisent des logiciels américains. Ils rentrent le soir et se divertissent en se branchant sur Netflix ».
Deuxièmement, des protections douanières plutôt plus élevées côté européen. Certes, elles ne le sont pas de manière décisive : d’après le Cepii, le droit moyen américain appliqué aux produits européens est de 2,56% contre 5,57 % en sens inverse1. Mais les droits ne sont pas les seules barrières au commerce.
Troisièmement, des approches différenciées au sein de l’exécutif américain2:
- Des protectionnistes classiques et énervés qui comptent sur les droits de douanes pour rétablir la base industrielle américaine ;
- Des budgétaires à la recherche des ressources permettant de financer les baisses d’impôts ;
- Des tenants d’une vision financière de la relation des États-Unis au reste du monde dans laquelle les droits de douane (tariffs) servent de monnaie d’échanges pour conduire à une dépréciation massive du dollar et un financement à bas coût de la dette américaine. Parmi eux, très commenté dans les medias/think tanks, Stephen Miran, le président du council of economic advisers ;
- Enfin, des idéologues animés par la haine de l’UE.
Tous partagent le même constat : la classe ouvrière américaine a été victime de la mondialisation et il faut redresser cette situation. Mais la plupart ont une deuxième obsession qui peut sembler contradictoire avec ce premier objectif : la promotion des intérêts des grandes entreprises américaines qui, elles, font partie des grandes gagnantes de la mondialisation. Il est possible pour partie de tenir ces objectifs en même temps : les ouvriers sont intéressés (ou plutôt ils auraient été intéressés quand l’industrie existait encore) par des barrières aux frontières ; les grandes entreprises sont surtout dans les services et la tech. Leurs revendications portent sur les contraintes réglementaires ou fiscales là où elles sont implantées, chez les partenaires des États-Unis.
Les questions qui ne dépendent pas de l’UE
Le timing
Certaines mesures sont déjà en vigueur : c’est le cas des droits de 25 % sur l’acier et l’aluminium3.
La date critique est maintenant le 2 avril. Les droits de 25% sur le secteur automobile annoncés par le président américain le 26 mars seront formellement décidés ce jour-là4. Bien plus, les mesures sur les « droits réciproques » consistant à amener les droits américains au niveau de ceux de leurs partenaires devraient être annoncées. Elles pourraient ne concerner dans un premier temps « que » les 15 pays ayant le plus gros excédent commercial vis-à-vis des États-Unis, les « dirty fifteen »5. La France n’est peut-être que le 16e derrière ou le 17e « dirty » mais elle a bien d’autres motifs pour être sanctionnée.
Les contre-mesures européennes devraient entrer en vigueur à la mi-avril, avec la possibilité de réactions américaines immédiates, si elles touchent le bourbon.
Les buts de guerre
Au-delà des divergences sur le niveau des droits de douane, les prétextes à mécontentement américain vis-à-vis de l’UE sont potentiellement nombreux :
- Le numérique sur les sujets de fiscalité et de réglementations, qu’elles portent sur la responsabilité des plateformes ou sur la localisation et la protection des données ;
- L’agriculture avec les restrictions aux échanges résultant des préférences collectives européennes (OGM, hormones, poulets chlorés…) ;
- L’audiovisuel (les réglementations françaises en matière de quotas et de financements) ;
- L’aéronautique (Airbus vs Boeing) même si ce sujet n’est pas évoqué pour l’heure (en raison du piètre état de Boeing ?) ;
- Les réglementations environnementales européennes existantes (règlement déforestation, mesures-miroir) ou à venir (mécanisme d’ajustement carbone aux frontières) ;
- La TVA (sujet nouveau).
La plupart de ces dossiers ont donné lieu à des accords trouvés dans le cadre de l’OMC ou à des trêves mais pas tous, et l’administration américaine ne s’estime pas tenue par les décisions prises par ses prédécesseuses.
La forme
Les mesures seront appliquées certainement de manière différenciée selon les États-membres, à la fois pour récompenser les proches et pour créer de la division au sein de l’UE. Si tel était le cas à grande échelle, cela créerait de vraies difficultés pour les entreprises européennes obligées de prouver l’origine du produit et un risque de fragmentation du marché intérieur.
Les questions qui dépendent de l’UE
Le champ des contre-mesures
L’UE s’est dotée d’un arsenal de dispositifs de défense commerciale susceptibles d’être actionnés en réponse à des mesures américaines pénalisantes.
La question se pose différemment selon que les cibles américaines visent essentiellement du commercial « classique » (droits de douane, restrictions quantitatives) ou portent sur les réglementations internes à l’UE, communautaires ou nationales.
Dans ce cas, le règlement anti-coercition adopté en 2023 pourrait être utilisé. Ce serait une première, alors qu’il a été conçu pour parer aux menaces chinoises. Il permet une large palette de rétorsions au-delà des seuls tarifs douaniers. Les champs suivants peuvent être inclus dans la riposte : marchés publics, propriété intellectuelle, services, fiscalité avec un choix de cibles à la carte. L’UE devra être créative, privilégiant les mesures affectant le camp Trump, tenant compte des intérêts européens aux États-Unis, et procurant un « double dividende » (mesures environnementales). Ce peut être par exemple :
- Des mesures ciblant les entreprises de Musk, Zuckerberg et Bezos (ancienne taxe sur les petits colis Amazon, pénalisation des nouveaux clients AWS…) ;
- Un dispositif douanier distinguant les produits selon l’État fédéré d’origine en exonérant les États non MAGA (si les mesures américaines discriminent entre États-membres) ;
- Des actions bien calibrées en matière d’investissement et de droits de propriété intellectuelle, en visant par exemple les entreprises de la finance qui viennent de renoncer aux politiques ESG (par exemple Blackrock).
La gestion du risque de surenchère
La menace des 200% de droits additionnels sur les vins et spiritueux européens le montre : l’administration américaine ne restera pas les bras croisés face aux rétorsions de ses partenaires. La question de la prise en compte des dommages et des victimes de la guerre commerciale doit être posée (mécanisme assurantiel au niveau européen financé par les droits additionnels6 ?). Il convient également de préparer une nouvelle liste de mesures, tout en l’inscrivant dans une logique de désescalade (pas nécessairement du 1 pour 1).
Dans ce contexte de tensions aggravées entre partenaires aux économies très imbriquées7, il y a naturellement un « éléphant dans la pièce », en l’occurrence la relation de défense et l’utilisation à des fins de politique que pourrait en faire la partie américaine.
Le traitement des pays tiers et la question du multilatéralisme
L’UE va « spontanément » afficher une double orientation :
- Les mesures prises devront être conformes aux règles de l’OMC,
- Elle a d’autres partenaires que les États-Unis et souhaite aller de l’avant avec eux. La question du Mercosur et d’autres accords de libre-échange revient ici sur le tapis.
Sur ce plan, la ligne de crête est étroite : il est important de recréer un système de coopération internationale et de penser une nouvelle gouvernance mondiale. Dans ce contexte, détruire un peu plus, si l’on peut dire, ce qui subsiste du multilatéralisme – l’OMC – n’est pas nécessairement judicieux. Mais il faut dépasser un modèle moribond. Cela suppose d’être à l’initiative et force de propositions, par exemple en appelant à l’intégration de l’OMC dans une organisation mondiale pour le climat et le commerce (OM2C°), ou en signant des accords de partenariats pour le développement durable. La piste bilatérale reposant sur des accords avec les grands partenaires de l’Union européenne sera privilégiée par la Commission. Des discussions sont déjà en achevées (Mercosur) ou en cours (Inde, Mexique, Indonésie ? Australie). Il faudra dépasser les actuels accords de libéralisation commerciale pour aller vers des partenariats élargis aux sujets d’échanges universitaires, culturels de recherche, de projets technologiques.
La France n’en a donc pas fini avec le commerce. Elle aura peut-être découvert à l’occasion du rapport de force brutal que cherche à imposer les États-Unis qu’elle a aussi des positions exportatrices à défendre et intérêt à un monde ouvert