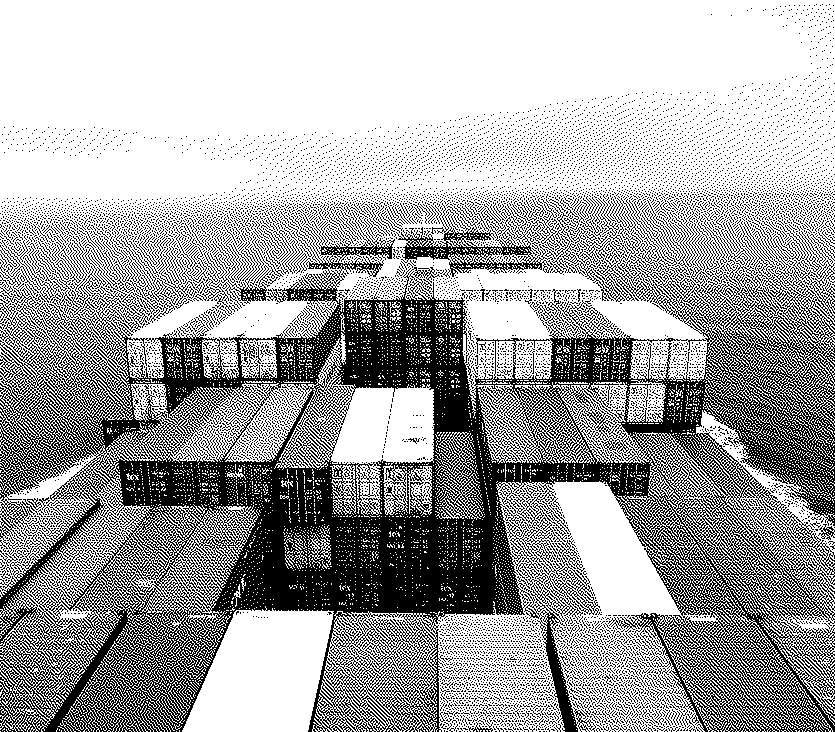Faut-il voir dans la politique commerciale de Donald Trump autre chose que l’expression d’un esprit versatile et dérangé ? Nous reconnaissons bien volontiers que ce président donne l’impression de mettre le feu à tous les étages et qu’il ne semble pas avoir lu les conseils de Machiavel quant aux écueils que le pouvoir doit éviter dans ses velléités de changer le statu quo. Mais il reste utile de distinguer entre la vision qui nous semble obéir à une claire rationalité géopolitique et l’exécution qui semble brouillonne, comme en témoigne encore la décision en date du 22 avril de monter les droits de douane sur les panneaux solaires provenant du Vietnam à près de 400%. Ce n’est pas parce que l’exécution pêche et que l’exécutif américain n’a pas anticipé toutes les conséquences négatives du tournant majeur qu’il impose aux relations commerciales internationales, qu’il n’en espère pas des retombées positives sur certains plans qui restent importants à comprendre.
Les avantages comparatifs liés aux échanges internationaux, tels qu’exposés par David Ricardo il y a plus de deux siècles, font partie des ponts-aux-ânes en économie. Toujours enseignés et toujours contestés. Faut-il incriminer des difficultés d’entendement pour tenter d’interpréter la démarche de Donald Trump ou peut-on trouver un cadre rationnel pour expliquer que le gouvernement américain ait décidé d’imposer des droits de douane sur les échanges avec tous les pays (excepté la Russie qui fait partie des happy few qui ne sont pas sanctionnés) ? Alors même que, depuis des décennies, les institutions internationales comme l’Organisation mondiale du commerce ou le Fonds monétaire international –- dont les États-Unis ont été les parrains dans l’après-guerre — ont tout mis en œuvre pour convaincre les pays, riches ou pauvres, qu’il fallait laisser circuler librement les capitaux et les marchandises.
Un changement stratégique
Si le libre-échange est une doctrine pour temps de paix, sa validité universelle peut être contestée en temps de conflit larvé ou ouvert entre les nations. La stratégie de Donald Trump, même si elle contient une part de bluff, ne correspond pas un changement économique et financier ni à une demande politique et sociale d’origine interne, comme l’est le contrôle de l’immigration, même si elle est abondamment mise en avant par le président des États-Unis.
C’est un changement de paradigme qui n’a pas d’origine économique pour l’essentiel car le libre-échange de biens et services (c’est plus compliqué pour les capitaux et la main d’œuvre) est dans l’intérêt à long terme de tous les pays et donc des États-Unis car il permet d’obtenir un niveau de vie plus élevé qu’en cas de restrictions aux échanges. Beaucoup de pays qui appartenaient au tiers monde ont réussi à décoller et à devenir des émergents grâce au droit de l’OMC et à la libéralisation du commerce. Cela ne veut pas dire que tous les groupes économiques et sociaux dans chaque pays gagnent au libre-échange mais que, dans des conditions normales, le gain global d’un pays est suffisamment fort pour qu’il soit possible, au niveau de chaque pays, de compenser les perdants en reprenant aux gagnants et qu’au bout du compte tout le monde s’y retrouve. Malheureusement, ce transfert n’a pas été réalisé aux États-Unis, pas plus qu’en Angleterre ou en France d’ailleurs, et la résistance au libre-échange s’y est donc renforcée. Ces tendances protectionnistes ont toujours existé aux États-Unis mais elles restaient de nature sectorielle, car de nombreux pans de l’économie américaine bénéficiaient à l’évidence de l’ouverture des échanges.
Le changement de pied aussi radical des États-Unis ne peut correspondre qu’à un changement de lecture géopolitique majeur. Les États-Unis sont le leader mondial d’assez loin depuis 1945 et ils ont envie de le rester parce que c’est une République impériale. C’est le dernier pays occidental qu’anime encore une envie impériale. Les revendications sur le Groenland et le Canada ne peuvent pas être comprises sans cet arrière-plan. Ce désir hégémonique est objectivement menacé par la Chine qui représente aujourd’hui 35% de la production industrielle de la planète et qui progresse à grande vitesse vers la frontière technologique dans tous les domaines. Les États-Unis anticipent un conflit avec la Chine et l’enjeu dépasse de très loin le contrôle de Taiwan : c’est le contrôle de l’océan Pacifique. Les dirigeants américains se disent que là où les japonais ont échoué au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Chinois seraient peut-être en mesure de réussir et, ainsi, de contrôler le Pacifique. A cette analyse largement admise, s’ajoute un élément nouveau, à savoir la lecture que certains experts font de la spécialisation sectorielle des États-Unis comme résultat de la mondialisation. Ceux-ci se sont spécialisés dans les services où ils sont exportateurs nets alors qu’ils importent massivement des biens manufacturés. Il se sont très largement désindustrialisés (l’industrie manufacturière ne pèse que 10,3% du PIB) avec des conséquences sociales comme en France et en Angleterre. Mais ce n’est pas le point majeur de cette réflexion géopolitique. La poursuite d’un conflit sur le long terme suppose de grandes capacités industrielles et les États-Unis peuvent, à raison, penser qu’ils sont en infériorité par rapport à la Chine dans ce domaine. Par conséquent, l’objectif majeur de la politique économique américaine actuelle est de rapatrier la production de biens manufacturés aux États-Unis, quitte à les payer plus cher, afin d’être capable de résister sur le temps long à un conflit avec la Chine et ne pas subir un « échec et mat » dès les premiers coups de la partie. Des barrières non tarifaires pourraient aboutir au même objectif mais les droits de douane sont réputés moins nocifs et, surtout, ils rapportent de l’argent. Or, les États-Unis ont un problème de déficit et de dette publique, comme la France. Ils sont pour cela à la recherche de recettes publiques et de coupes dans les dépenses publiques.
La rivalité Chine – États-Unis
Cette stratégie a évidemment un coût. Les États-Unis ont largement profité depuis plusieurs décennies de l’ouverture mondiale des marchés. Elle leur a permis d’assurer une suprématie planétaire tout en abandonnant la fabrication des biens de consommation à l’usine chinoise. Le retour des droits de douane peut conduire les États-Unis à une régression, à un recul de leur place sur le marché mondial. Tous les pays ont bénéficié de l’ouverture mondiale des marchés. Si les États-Unis représentaient 45% du PIB mondial au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ils n’en représentent plus qu’entre un cinquième et un quart maintenant. L’ouverture mondiale des marchés a permis un rattrapage très rapide de l’Asie et, par sa masse, la Chine peut apparaitre comme un grand gagnant, voire le plus grand gagnant. Si la Chine apparaissait comme un géant débonnaire, qui ne pense qu’à l’enrichissement de sa population, les États-Unis auraient peut-être pu continuer sur le paradigme du libre-échange. Mais, à tort ou à raison, une grande partie des dirigeants américains pensent que la Chine ne fera pas forcément un usage pacifique de sa force et que, le moment venu, elle représentera une menace directe pour leur pays. En tout cas, le fait que la Chine ait adopté une politique commerciale très largement mercantiliste peut à bon droit susciter le doute car le mercantilisme n’a de sens que dans un cadre géopolitique conflictuel. La Chine est à l’évidence la cible principale de cette politique commerciale comme en témoigne la décision de revenir temporairement à un droit de douane de base de 10% sur toutes les importations sauf celles venant de ce pays ou la récente décision d’imposer des frais d’accostage aux navires chinois. On se croirait revenu au XIXe siècle.
Le recul de la place des États-Unis dans le commerce mondial suite à cette stratégie n’est cependant pas automatique. Il aurait certainement lieu si tous les autres pays du monde se coalisaient pour réagir par des mesures de rétorsion aux annonces de relèvement de droits de douane. Il est encore trop tôt pour le savoir, mais il ne semble pas qu’on en prenne le chemin malgré les efforts de la Chine pour entraîner d’autres pays dans un mouvement de résistance. La très grande majorité des pays acceptent de se positionner dans une négociation bilatérale avec les États-Unis, une très grande victoire pour la stratégie trumpiste car, dans la relation bilatérale, les États-Unis seront en position de force. Tous les pays du monde à l’exception de la Russie peuvent se sentir légitiment agressés par ces décisions unilatérales et, en réponse, tous les pays à l’exception de la Chine vont à Canossa. Ce qui est présenté comme une reculade de Trump avec le retour à un tarif de base de 10% agrémenté par des droits de douane à 25% sur l’acier, l’aluminium et les voitures, assorti d’une période de 3 mois pour ouvrir et conclure des négociations bilatérales a permis en tout cas de casser toute velléité de mesures immédiates de rétorsion de la part de tous les autres pays, ce qui peut être vue comme une victoire par cette administration américaine. Tous les autres pays se précipitent à Washington pour négocier une diminution des droits de douane contre des concessions dans l’accès à leur marché intérieur ou dans d’autres domaines. Pourquoi tous les pays courbent-ils l’échine ? Parce qu’ils sont en dette sur un autre point vis-à-vis des États-Unis (par exemple, l’Europe pour sa sécurité), que le marché américain reste le plus important du monde et qu’il représente une part importante des exportations du pays en question, parce que leur économie est simplement de plus petite taille et qu’enfin c’est un marché très rémunérateur car on peut y vendre plus cher ses produits en raison du pouvoir d’achat américain. Dans cette éventualité, les États-Unis auraient gagné un accès plus grand à tous autres marchés à l’exception de celui de la Chine qui serait perdu. La Chine a déjà choisi de ne pas céder, pour ne pas perdre la face bien sûr, mais aussi pour des raisons plus fondamentales. Ses exportations vers les États-Unis ne représentent plus que 2,7% de leur PIB contre 6,7% en 2000. Ils détiennent également deux cartes majeures : un contrôle sur les terres rares, nécessaires comme intrants dans tout le matériel informatique et les batteries, et plus de 750 milliards de bons du trésor américain. Le coût économique d’un découplage brutal des économies chinoise et américaine sera violent pour les deux parties et pour le monde entier, même s’il laisse de l’espace à leurs concurrents dans les deux marchés respectifs, par exemple Airbus en Chine et le sud-est asiatique pour les produits de consommation aux États-Unis. Mais, du point de vue de l’administration américaine actuelle, cette phase peut être vue comme une purge nécessaire : intervenant en temps de paix, elle ne présente pas de conséquences irrémédiables sur le rapport de force à long terme entre les deux économies. Les États-Unis se seraient dépris brutalement d’une dépendance dommageable à moyen terme pour leurs objectifs géopolitiques.
La réaction des électeurs républicains
Mais la question centrale sur le plan politique est évidemment de savoir si les consommateurs et électeurs américains, et en particulier la base électorale MAGA, vont s’y retrouver avec des produits de consommation courante plus chers, avec en ligne de mire une sanction aux élections à mi-mandat en novembre 2026. On leur vantera les traces d’une réindustrialisation qui ne pourra jamais se faire à bas coût et réclamera l’embauche de travailleurs peu qualifiés. En effet, les industriels américains ou étrangers qui vont devoir servir le marché américain à partir des États-Unis vont se poser le problème de savoir comment éviter d’avoir des frais de masse salariale élevés. Une occasion rêvée de construire des usines très robotisées en intégrant des innovations venant de l’IA sera sans doute saisie. Une constante du capitalisme a toujours été de chercher à économiser sur les dépenses salariales et à réaliser ainsi des gains de productivité. Le plan de Trump ou de ses conseillers est grandiose puisqu’il est question d’utiliser l’argent des droits de douane pour proroger des allégements fiscaux qui devaient se terminer en 2026, c’est-à-dire de faire payer une partie du budget de l’Etat fédéral par l’étranger. Pour donner un ordre de grandeur, si l’ensemble des 3300 milliards de dollar d’importations de 2024 étaient taxés à 10%, cela représente déjà 330 milliards de dollar de recettes fiscales supplémentaires à rapporter à un déficit budgétaire de 1800 milliards. Ainsi, certes le consommateur américain paierait plus cher certains biens de consommation mais en parallèle son revenu après impôt pourrait ne pas baisser ou même augmenter. Si en même temps l’homme de la rue voit fleurir les constructions d’usine, cela peut le faire patienter et le décider à ne pas sanctionner les républicains aux élections de mi-mandat en novembre 2026. Pour cela, il est crucial que les investissements se concrétisent au plus vite, d’où toute la publicité faite sur les annonces en ce sens pour venir contrer les tendances de contraction économique.
Trump fait un pari qui comporte de gros risques et le scénario peut dérailler à n’en pas douter, et les erreurs d’exécution peuvent se payer très cher. Cette politique rencontre déjà quatre obstacles majeurs, la défiance des milieux d’affaire, le risque de stagflation, l’hostilité de la Fed au projet trumpiste et la remise en cause du rôle du dollar comme monnaie de réserve. Les marchés boursiers américains sont favorables au libre-échange parce que cela permet de diminuer les coûts en mettant en concurrence la main d’œuvre de tous les pays du monde. Des coûts plus faibles permettent d’atteindre plus de consommateurs et donc d’augmenter les profits. La baisse des cours boursiers affectent le rendement de l’épargne investie dans des fonds de capitalisation ou dans des fonds de pension. Les restrictions brutales aux échanges et l’incertitude qui va durer pendant les trois mois de négociation commerciale, vont peser sur les investissements et la croissance américaine sera en berne en 2025. La Fed sera mise en porte à faux, elle qui a deux missions, le plein emploi et la stabilité des prix. Son président Jerome Powell a déjà annoncé qu’il donnerait priorité au second objectif, ce qui a suscité le courroux de Donald Trump. Une tentative de révocation remettrait en cause de l’indépendance de la Fed qui est garantie depuis un siècle. Les conséquences seraient incalculables avec une défiance accrue des investisseurs envers le dollar, défiance que l’on peut déjà constater puisque son cours baisse contre toutes les principales devises alors que simultanément le taux d’intérêt sur les obligations du trésor américain monte. Ces petits cailloux sous les pas de la politique commerciale américaine peuvent à n’en pas douter augmenter considérablement le coût économique et politique de cette stratégie qui ne survivrait pas à une défaite aux élections de mi-novembre 2026.
La réponse de l’Europe
Dans ces conditions, quelle peut être la stratégie de l’Europe ? Jusqu’ici, elle semble sur la défensive et hésiter sur la politique à suivre et a du mal à cacher ses divisions. Le continent européen peut-il résister à un changement radical des règles du jeu et à un affrontement planétaire entre la Chine et les États-Unis ? l’Union Européenne a un excédent important dans les échanges de biens avec ce dernier pays qui est compensé par un déficit important dans les échanges de services. Au total, les échanges sont proches de l’équilibre (moins de 50 Md€ d’Euros, soit environ 3% de la somme des échanges en 2024). Une baisse coordonnée du dollar et une montée corrélée de l’Euro peut faire converger rapidement la relation commerciale transatlantique vers l’équilibre à peu de frais. Ce genre de mouvement a déjà été réalisé dans le passé. Mais là encore, ce qui est nouveau, c’est l’accent mis par le gouvernement américain sur le rétablissement de l’équilibre dans les échanges de biens et l’incitation des entreprises européennes à produire des biens manufacturés sur le sol américain. La stratégie la plus ambitieuse pour l’Europe serait de prendre la tête de la défense du multilatéralisme dans une coalition avec le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, le Japon, l’Inde, et la Corée, de refonder l’OMC sans les États-Unis, pour éviter le repliement de chaque pays, ou chaque région sur elle-même. Mais incontestablement, une telle stratégie apparaitrait comme très offensive vis-à-vis des États-Unis et comme une possible alliance commerciale, voire politique de fait, avec la Chine. Pour l’instant la Commission Européenne fait le dos rond et adopte une stratégie essentiellement défensive. Elle laisse même la Chine se faire le héraut du multilatéralisme. Ursula von der Leyen ne s’est même pas donnée la peine de rectifier publiquement l’accusation de Donald Trump que l’Union Européenne avait été inventée pour escroquer les États-Unis. Cette politique de profil bas est une erreur car une contre-vérité assénée, répétée et jamais démentie peut finir par convaincre l’opinion américaine. La raison essentielle de cette pusillanimité est à rechercher dans les possibilités de réplique des États-Unis sur le front militaire avec la menace de retirer leurs forces militaires d’Europe et de cesser toute protection, ce qui dans le contexte actuel serait délicat à gérer. D’autre part, une stratégie de riposte ne ferait sans doute pas l’unanimité parmi les 27 pays. L’Irlande et l’Italie qui sont les seconds et troisième pays exportateurs vers les États-Unis sont favorables à une politique d’apaisement. En l’absence d’une réponse claire, une politique mi-chèvre mi-choux entre menace de rétorsion minimaliste et tentative de négociation a été choisie. Le moment de vérité aura lieu au mois de juillet, à la fin de la période de négociation des trois mois. Beaucoup dépendra du résultat des négociations avec les autres partenaires des États-Unis. Mais il faut bien saisir pourquoi les États-Unis vont être un négociateur particulièrement coriace. La hausse des droits de douane sont doublement efficaces dans le cas de l’Europe. D’une part, les industriels européens sont des clients de choix pour entamer le réinvestissement industriel des États-Unis ce qui n’est pas le cas des pays émergents dont le modèle industriel exige des bas salaires. D’autre part, renoncer aux droits de douane dans le cas de l’Union, c’est renoncer à un montant important de recettes pour le budget fédéral, environ 60 Mds $. En fait tant que l’Europe ne se donne pas les moyens de devenir autonome, voire indépendante sur le plan militaire, elle ne peut pas agir aux mieux de ses intérêts sur le plan du commerce international. Les États-Unis sont décidés à faire payer cette dépendance au prix fort. L’Europe est, en quelque sorte, empêchée. Un mouvement spontané de perte d’intérêt des consommateurs et des entreprises européennes pour les produits américains, les services américains, les films ou séries américaines ou le tourisme peut cependant agir comme un révélateur à terme pour les citoyens américains d’un sorte de désamour pour leur pays de la part de populations qui leur étaient proches et reconnaissantes pour les services rendus au cours de la seconde guerre mondiale et faire revenir les États-Unis à terme vers des sentiments plus amicaux vis-à-vis de l’Europe. Mais, au total, si la politique commerciale des États-Unis échoue entre-temps, cela ne sera pas la responsabilité de l’Europe, et les dirigeants américains actuels l’ont compris. Malheureusement, l’Europe ne se comporte pas comme un acteur de responsabilité mondiale dans le seul domaine où elle compte.