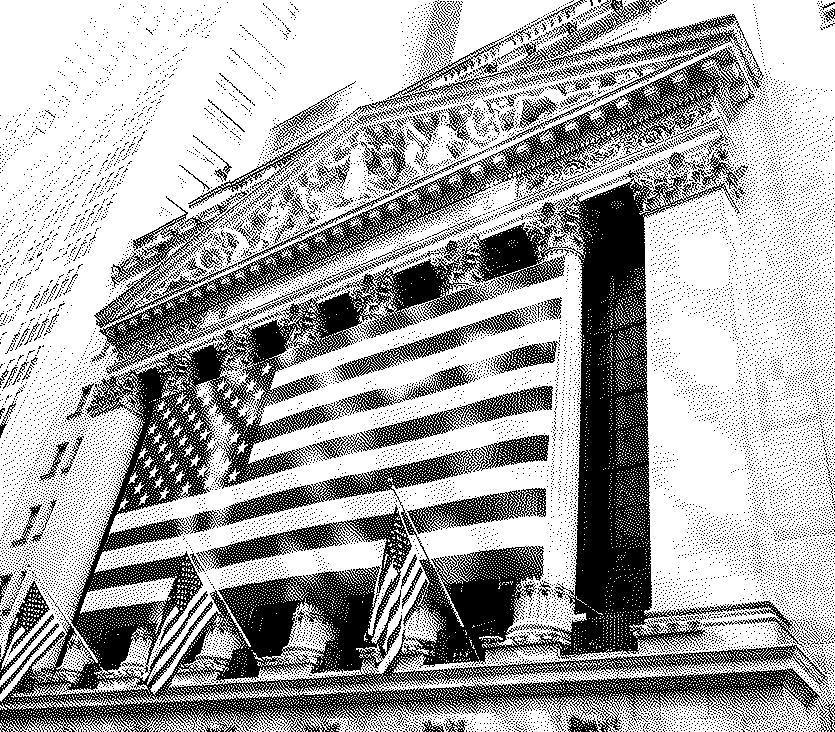On ne répond à l’objectif que fixe le titre de cet article qu’en élargissant d’emblée le propos à la politique intérieure américaine et surtout aux relations internationales. Car les mesures économiques avancées par Trump cherchent autant, sinon plus, à repositionner radicalement les États-Unis dans un ordre politique mondial désormais bouleversé par l’émergence de la Chine et d’autres puissances, qu’à répondre à des thématiques de politique intérieure.
Ces deux objectifs sont rassemblés sous un chapeau culturel, MAGA (Make America Great Again), qui arrive pour l’instant à unifier des intérêts très divergents au sein de l’électorat de Trump. On les regroupe souvent en trois catégories. Les hiérarques du Parti républicain d’abord. Ils se sont ralliés peu ou prou à Trump, voyant en lui l’homme capable de faire avancer encore le programme républicain de réduction du poids de l’État et des impôts. Ils attendent de lui une réédition renforcée de la grande loi fiscale de 2017 venue à échéance (qui avait fait fortement baisser la fiscalité des entreprises et des ménages les plus riches), une loi entièrement élaborée par le Congrès et non par un Trump inexpérimenté à l’époque. Ils sont soucieux de la montée de la Chine mais craignent aussi que les décisions aillent à l’encontre de leur vision néolibérale, qu’il s’agisse de commerce international et, jusqu’à un certain point, d’entrée de travailleurs étrangers.
Moins nombreuse mais importante par son financement électoral et son halo médiatique, la sphère techno-libertarienne, représentée aujourd’hui par Elon Musk mais comprenant désormais un bon nombre de grands de la tech, empreints d’une vision cosmique où leurs entreprises vont permettre d’immenses ouvertures techniques propres à changer les relations sociales, les services publics, l’urbanisme, etc., faisant de l’État une « technologie » désormais obsolète.
Enfin et surtout la base qu’on peut appeler souverainiste populiste, cœur battant du soutien à Trump, sensibilisée au thème de la disparition des emplois et des industries dans leurs régions, farouchement opposée à l’immigration autant pour des raisons culturelles qu’économiques, à l’aise pour dénoncer la Chine qui lui vole ses emplois, et faisant montre d’une attitude ambigüe sur l’État-providence, dont elle rejette et sollicite tout à la fois les services. Une base enfin qui adhère aisément au discours anti-élite jusqu’à en faire un socle culturel réactionnaire, cimenté autour du logo MAGA.
On juge cette coalition fragile et à la merci de tout revers de fortune. De fait, le pan souverainiste-populiste n’a que mépris pour l’élite républicaine et de la haine pour les ultra-riches de la tech, comme l’exprime bien Steve Bannon, le hérault de ce mouvement et un pivot important dans la réélection de Trump1. Bannon va jusqu’à réclamer plus d’impôt sur les riches, ce qui anticipe un front hostile lors du débat sur la loi fiscale. Mais ce serait sous-estimer la faculté de Trump de naviguer entre les obstacles et de soutenir les positions les plus contradictoires. Il a déjà renversé la scène politique étatsunienne et sublimé les différences en les plaçant, comme tout bon populiste, au niveau d’une lutte culturelle dans l’exaltation de MAGA. Les difficultés d’emploi dans les régions industrielles tiennent dans son discours au seul mauvais comportement de la Chine, en y ajoutant même l’argument Fentanyl que la Chine exporterait bien sûr à dessein pour saper, à l’égal du mouvement woke, la force morale de la population. Le fait nouveau apparu depuis sa réélection, mais qu’on pressentait de son narcissisme erratique, est qu’il n’hésite pas à s’engager dans une voie autoritaire dès que les garde-fous institutionnels viennent à faillir. On pense ici, selon le degré de démocratie qui prévaudra, à des exemples historiques allant de Perón à Mussolini.
Le risque qu’il fait désormais peser sur les institutions internationales et son mode d’exercice du pouvoir incitent habituellement à faire le rapprochement avec les années 1930. Mais c’est plutôt la période allant de la fin du XIXe siècle jusqu’à 1914 qu’il faut évoquer, après la grande période libérale qui l’a précédée. L’hégémonie du Royaume-Uni s’affaiblissait, les relations internationales se tendaient et le commerce extérieur reposait davantage sur le rapport de forces et le souverainisme assumé, chaque grande nation du monde occidental cherchant à sécuriser ou voir grandir son territoire. Plus qu’un protectionnisme, il y avait combat pour conquérir les marchés de force. Les États-Unis n’étaient pas les moins agressifs, s’engageant, sous les présidences de William McKinley (hautement loué par Trump) et Théodore Roosevelt, dans des conquêtes coloniales. La contestation de l’ordre britannique venait principalement de l’Allemagne et des États-Unis. Les circonstances historiques ont fait, quelques décennies plus tard, que le passage de témoin entre la Grande-Bretagne et les États-Unis pour l’hégémonie, et notamment le passage de la livre au dollar comme monnaie dominante, s’est passé sans trop d’encombres. Mais on avait pu mesurer les désordres causés en Europe par la tentative avortée venue de l’Allemagne.
On désigne aussi la période actuelle par le qualificatif de mercantiliste. À juste titre. Car le mercantilisme qui a prévalu entre les XVIe et XVIIe siècles n’a pas l’acception restrictive qu’on lui donne habituellement, celle d’une politique économique centrée sur l’exportation et symétriquement sur l’accumulation d’or et d’argent. Davantage que cela, le mercantilisme était l’ossature idéologique des États-nations en cours de formation en Europe. L’enjeu pour le Prince était de s’assurer de son territoire et de ses frontières, de constituer pour cela une force militaire, faisant de l’administration du royaume la priorité au-delà des intérêts des marchands et des aristocraties. Des guerres commerciales sont nées de là et aussi, dérapage inattendu, la guerre de Trente Ans.
En ce sens, la politique de Trump est mercantiliste comme l’est aussi la politique chinoise, et avec les mêmes risques. Ces deux pays ne se replient pas sur eux-mêmes, ils organisent le commerce sous le régime de rapports de force ou, dans le cas de la Chine, d’une course forcée à l’exportation. Les notions traditionnelles de la théorie économique – un monopole est dans une position de force face à des clients dispersés ; un monopsone face à des fournisseurs dispersés – ne suffisent plus. Comme le montrait Albert Hirschman (1945) dans un ouvrage visionnaire, il faut désormais user de mots comme le chantage, la menace, la sanction jusqu’à peut-être l’agression militaire. Là est le bouleversement en cours des relations internationales.
Un point d’inflexion a été la désillusion ressentie aux États-Unis lors la première décennie des années 2000. Inclure la Chine dans le jeu économique international était censée faciliter une mutation souple du régime vers le modèle libéral célébré en Occident, une version moderne du « doux commerce » cher à Montesquieu. La Chine s’est certes renforcée, et violemment, devenant le manufacturier du monde, malmenant l’emploi et le tissu industriel de la plupart des pays, mais pour renaître dans sa splendeur impériale. Dans nombre de secteurs industriels, elle affiche désormais une avance nette sur les pays occidentaux. Il sort chaque année de ses universités 3,5 millions de diplômés dans les seules disciplines scientifiques, autant qu’il en sort aux États-Unis dans toutes disciplines. On retrouve le fait que les jeunes gens des pays autocratiques ne se risquent jamais trop à des études en sciences humaines ou en droit2. Les dirigeants chinois arrivent à faire oublier leur autoritarisme par une véritable galvanisation de leurs élites autour de l’objectif de surpasser les États-Unis dans tous les domaines.
Et la Chine est suivie à présent par des pays comme le Brésil, la Turquie et l’Inde qui ne voient également guère de raison de se mettre dans le sillage des États-Unis. Ils savent que leurs ingénieurs se comparent désormais à ceux de Californie alors qu’ils ne les paient qu’au niveau du salarié non qualifié étatsunien, un avantage dont ils entendent profiter.
Le choc est rude pour les États-Unis, la blessure d’orgueil plus profonde encore. C’est cette inquiétude très réelle à laquelle Trump veut donner une issue politique. On aurait donc tort de lire son succès politique à ce jour avec la seule grille de lecture interne d’un rejet populiste du modèle libéral élitiste. Il exprime prioritairement le mouvement très profond par lequel les États-Unis, presqu’à leur corps défendant, sont conduits à épouser ce moule « post-néolibéral » de relations devenues plus impériales et donc plus menaçantes pour eux. Pour paraphraser Lénine, le néolibéralisme passerait à son stade suprême pour devenir mercantiliste, souverainiste ou impérialiste – on cherche encore les mots. Et en tout cas dangereux. L’ironie est que Trump, ayant fait le constat que la Chine ne converge pas sur le modèle libéral des États-Unis, semble décider d’une convergence dans l’autre sens : des États-Unis vers la Chine, ce qui explique que la mobilisation entreprise soit autant culturelle que politique ou qu’économique. Il fait, jusque dans sa fascination pour Xi Jing Ping, comme si la Chine définissait désormais les règles de l’ordre politique et économique international, une perspective qui n’est pas forcément fausse.
Cette menace pousserait-elle les États-Unis à compter leurs alliés et à les rassembler autour d’eux ? Ce n’est pas le cas. Trump a une vision sommaire de la politique de puissance, consistant à marquer des points là où il peut, et donc prioritairement sur les cibles les plus faciles, peut-être avec l’idée que ces premières victoires le renforceront demain face aux pays hostiles. Ces derniers sont habitués à la confrontation et certains arguments ne jouent pas à leur endroit. Par exemple, ils sont par nature insensibles au chantage au parapluie militaire. Pour cette raison, le bullying de Trump (intimidation et brutalisation), pour reprendre ce mot américain, a commencé par le Mexique et le Canada. Lors de son premier mandat, Trump avait déchiré l’accord commercial dit NAFTA entre les trois pays pour mettre en place un accord dénommé USMCA, occasion de fanfaronner sur son talent à négocier un accord « enfin gagnant » pour les États-Unis. Il en parle à présent comme un pur rançonnage des États-Unis. L’Europe viendra en un second temps. Elle est perçue comme une puissance potentiellement impériale si elle arrive à s’unir, mais témoigne aussi d’un mode de gouvernement par la norme et le consensus que Trump exècre. Le traitement qu’avec sidération les dirigeants européens reçoivent aujourd’hui des États-Unis ne s’écarte guère de celui que reçoivent de longue date les pays latino-américains.
Le démantèlement de l’US Aid est un message clair au monde. Les États-Unis ne renoncent pas à toute aide publique au développement mais veulent en faire un instrument de puissance frontale, hard plutôt que soft, conditionnée à des avantages en retour : acheter américain, s’armer américain, s’éloigner des puissances hostiles aux États-Unis, etc. Il préfigure aussi une centralisation radicalement nouvelle de l’exécutif. Trump souhaite en effet clore un débat qui a toujours été vif aux États-Unis (et ailleurs), à savoir la place à donner aux agences publiques indépendantes. Ce sont des démembrements de l’exécutif, une sorte de quatrième pouvoir, nées lors de la présidence de Roosevelt pour protéger certaines compétences étatiques des aléas de la politique : monnaie, concurrence, santé, statistique, transport aérien, ceci jusqu’à l’intelligence et l’espionnage dans le cas de la CIA (Sunstein, 2025). On s’interroge à dessein sur le contrôle démocratique de telles entités mais aujourd’hui, l’enjeu n’est pas la démocratie, c’est le renfort du pouvoir souverain de Trump, de la part d’un dirigeant qui déclare pouvoir se placer au-dessus des lois s’il s’agit de sauver le pays, lui seul d’ailleurs étant en droit de dire de quoi il faut le sauver.
Du « privilège exorbitant » au « fardeau exorbitant »
Cet arrière-plan doit être posé pour comprendre la stratégie économique de Trump. Elle va essentiellement s’exercer sur le front extérieur. Certains commentateurs choisissent de l’aborder par le sujet des droits de douane qui domine à présent l’actualité. Le débat se déroule en partie sur l’aspect institutionnel, qui n’est cependant pas essentiel. En effet, la décision sur un droit de douane relève du seul ressort de l’exécutif aux États-Unis alors qu’il s’agit d’un impôt comme un autre, qui normalement exigerait un passage compliqué par le Congrès. Trump peut ainsi en jouer comme il veut et s’afficher aux manettes du monde.
Le point principal est celui-ci. L’ordre financier international s’était construit au sortir de la Seconde Guerre mondiale sur une position asymétrique, acceptée de tous à l’époque par les avantages qu’on en tirait. Les États-Unis, puissance financière incontestée, fournissaient le dollar comme instrument d’échange et de liquidité pour le commerce. Ils proposaient leur place financière comme lieu d’accueil, voire de refuge, de l’épargne mondiale, ce qui a été possible suite à la libéralisation financière des années 1980 dans la plupart des pays, dont la France. Cette position particulière du dollar était – et est encore – source de revenus financiers très importants : le produire ne coûte guère plus que l’écriture d’un crédit dans le bilan d’une banque étatsunienne alors que le pays qui l’achète pour ses besoins de liquidité le paie sous bonne et due forme de biens et services qu’il doit exporter aux États-Unis ou bien par cession de ses propres actifs financiers ou industriels. De même, l’hégémonie financière permettait d’emprunter à coût bas – une économie de l’ordre de 50 à 60 points de base selon une étude un peu ancienne de McKinsey (2009) – et, le cas échéant, en replacer une partie en investissements directs à l’étranger, via les grandes multinationales du pays. Il se dégageait une marge financière comme celle que fait un hedge fund qui use du levier de dette (Gourinchas-Rey, 2007). Cet ensemble d’avantages, que Giscard d’Estaing dénonçait comme un « privilège exorbitant », était – et reste à moindre niveau3 – un élément majeur du hard power étatsunien : tenant en mains le système financier, les États-Unis disposent d’un levier redoutable s’ils veulent isoler financièrement un pays, une banque ou une entreprise par blocage des flux bancaires. L’Europe en a fait l’expérience quand elle a voulu traiter commercialement avec Cuba ou l’Iran. Trump voit parfaitement le pivot stratégique que cet avantage lui apporte.
Enfin, la prospérité et le dynamisme de l’économie font que la rentabilité du capital est plus élevée aux États-Unis que dans la plupart des pays, ce qui attire naturellement les capitaux. Nous en avons une indication à partir de ce calcul effectué par l’auteur à partir des données de la balance des paiements des États-Unis. Il montre que les investissements directs étrangers dans les actions de ce pays sont, sur la période 2012-2023, plus rentables que leur équivalent des États-Unis vers l’étranger : respectivement 7,8 % contre 3 % sur la base des dividendes et des bénéfices non rapatriés.
Donc, un afflux structurel de capitaux. Mais la contrepartie, quasiment de nature comptable, doit être bien comprise. Le secteur privé étatsunien a moins besoin d’épargner puisque l’étranger le fait pour lui. Le secteur public a toute capacité à s’endetter à l’étranger plutôt que lever des impôts, puisque celui-ci aime tant investir en emprunts du Trésor étatsunien. Le pays dépense donc plus qu’il n’a de revenu, c’est-à-dire plus qu’il ne produit. La balance commerciale devient structurellement négative. Le chiffre semble modéré, soit 3% du PIB, mais il est énorme en montant, sachant le poids du PIB étatsunien4. Il faut remonter à la moitié des années 1970 pour avoir un compte courant positif, au moment où les marchés financiers commençaient à se libéraliser dans certaines parties du monde et où l’étalon-or avait pris fin. Ce déficit s’est creusé d’autant plus facilement que la domination financière exerçait une pression continue pour un dollar élevé, c’est-à-dire pour des prix bas en dollars pour les importations et hauts en devises étrangères pour les exportations.
Il faut donc lire d’un autre œil la balance commerciale des États-Unis. Ce pays rend en fait un double service au reste du monde : de liquidité en sa qualité d’exportateur de la monnaie d’échange (le dollar) ; et de sécurité ou d’assurance, en produisant et exportant les actifs sûrs (safe assets) que sont les obligations du Trésor étatsunien (auxquelles il fallait ajouter pour la période récente les actions émises par les grands de la tech californienne). Mais ces flux, plutôt que figurer dans la balance commerciale, sont enfouis dans les lignes financières de la balance des paiements. Avec cette correction, la charge que feraient subir aux États-Unis leurs relations commerciales apparaitrait bien plus légère5.
Cet équilibre est aujourd’hui soumis à des tensions extraordinaires. D’abord en interne parce qu’exporter des actifs financiers plutôt que des biens fait vivre davantage Wall Street que le little guy de l’Illinois, selon l’expression de Steve Bannon, surtout si les produits importés se font au détriment des emplois locaux. Les économistes jugent en grande majorité que le bilan d’ensemble des relations commerciales des États-Unis leur est favorable. Ils mettent en avant le taux de chômage très bas, la vitalité de leur secteur des services et un niveau d’innovation et de productivité qui est le plus haut des pays développés. Et ceci malgré ou peut-être grâce aux importations qui permettent au pays de se spécialiser sur les produits à haute valeur ajoutée. Mais une étude récente (voir Autor et alii, 2021) est venue nuancer ce point de vue. Elle montre, à partir d’une analyse très fine des implantations industrielles, l’ampleur de certaines pertes d’emploi quand la loupe est mise à un niveau local. Et ceci en lien direct avec ce qu’on appelle là-bas le China shock. Une usine est ancrée dans une ville qu’on peut pointer sur la carte et si le concurrent chinois balaie ce que produit l’usine, c’est la localité et son marché de l’emploi qui sont atteints. L’étude citée montre de plus que les emplois perdus n’ont pas été suivis d’une montée du chômage ou de départs des populations affectées vers des régions plus dynamiques (contrairement à l’image qu’on se fait de travailleurs étatsuniens très nomades). Ils ont poussé à des sorties du marché du travail et à accroître la part des inactifs dans la population locale, avec les dommages psychologiques et sociaux attachés. S’il est démagogique d’imputer la crise du Fentanyl à l’importation de cette drogue par les Chinois, la responsabilité de la Chine est indirectement engagée de par ses performances à l’exportation. Quant aux outils classiques de l’État-providence pour amortir le choc, ils se révèlent inopérants électoralement : les gens préfèrent toujours un travail et l’inclusion sociale que ce travail apporte à une allocation pour perte d’emploi.
Et surtout, l’exportateur, la Chine ou le Mexique, et même l’Inde qui veut y avoir sa place dans le domaine des services, construit des savoir-faire industriels, des emplois d’ingénieurs, des innovations par le jeu de ses échanges avec les États-Unis. De sorte que le jeu – et le rapport de force – se renversent : disposer du monopole des batteries électriques est pour la Chine un atout de puissance presqu’autant que la domination de Wall Street sur la finance mondiale. On reformule ici le fameux apologue du maître et de l’esclave où, par la maîtrise du travail et de l’industrie, les rôles finissent par s’échanger.
Dans la vision de Trump, le privilège exorbitant est donc devenu un fardeau exorbitant, dont profitent une Chine néo-impériale et, vus sans trop de nuance, tous les autres pays. Et il réussit à ce jour à faire partager cette conception à sa base souverainiste et à la droite républicaine.
La contre-offensive impériale
La voie retenue par Trump pour contrattaquer est à la fois très risquée, brouillonne et contradictoire. Voyons pourquoi elle a peu de chances d’atteindre l’objectif qu’elle se propose, à savoir réindustrialiser l’Amérique par l’intermédiaire d’une suppression des excédents commerciaux que les pays peuvent avoir avec les États-Unis.
Le premier obstacle est que le taux d’épargne bas est un élément pérenne, ancré dans les comportements. On épargne peu et on ne veut pas payer d’impôts (ce qui entraine une épargne publique négative)6. Il en résulte, on l’a dit, un déficit structurel du commerce extérieur. L’inertie est très forte et toute aussi forte l’inertie en miroir chez le partenaire chinois s’il doit rapidement réorienter son outil productif vers le bien-être consommateur de sa population en faisant baisser son taux d’épargne. Pour prendre un exemple, si demain la Chine doublait ses importations de soja ou bien si l’UE doublait ses importations de gaz liquéfié des États-Unis, le revenu national étatsunien s’accroitrait mais, sachant la rigidité du taux d’épargne, les dépenses également, laissant le solde extérieur à peu près inchangé. On en a eu la preuve avec la révolution énergétique du gaz du schiste : les États-Unis d’importateurs sont devenus exportateurs nets d’énergie fossile, ce qui est en soi un choc géopolitique majeur et un atout considérable entre les mains de Trump, d’où son insistance à le renforcer. Pourtant, le déficit extérieur s’est plutôt accru. Au passage, les achats étrangers d’énergie fossile aident davantage le Texas que les régions industrielles aujourd’hui sinistrées.
S’ouvre en second lieu un dilemme difficile à résoudre, lié, comme on l’a vu, au fort appétit des étrangers pour le dollar. Baisser les importations signifie en quelque sorte réduire les exportations de dollars. Or, une grande part du hard power des États-Unis repose sur cette « sur-exportation », sur ce hard power dollar que Trump veut maintenir. La preuve est qu’il menace de ses foudres les pays amis qui viendraient à abandonner le dollar comme monnaie de paiement. C’est vouloir gommer l’effet tout en en préservant la cause.
Un papier très documenté est paru à l’automne 2024 sur la façon d’échapper à ce dilemme. L’auteur, Stephen Miran, un économiste gestionnaire de fonds, est devenu immédiatement une star pour avoir été le seul économiste soutenant MAGA à poser de façon articulée la nouvelle stratégie. Il décrit fidèlement le passage du « privilège » au « fardeau » et les moyens selon lui de s’en sortir (Miran, 2024). Trump l’a désigné, depuis, à la tête du Comité des conseillers économiques de son gouvernement.
Quels moyens voit-il ? Le premier consisterait à pousser la Chine et l’UE, c’est-à-dire les deux partenaires qui connaissent les surplus commerciaux les plus amples, à une réévaluation de leurs monnaies face au dollar, par le moyen d’une forte montée de leurs taux d’intérêt et par la vente de dollars par leurs banques centrales. Cela évoque les accords du Plaza en 1985 où les États-Unis et certains pays européens avaient imposé une violente réévaluation du yen à un Japon dont les exportations triomphaient. (L’argument de la protection militaire et énergétique rendu au Japon avait dû aussi être glissé mezzo voce dans les couloirs du Plaza.) Il faudrait donc un nouveau Plaza, auquel on a déjà donné un nom : l’accord de Mar-a-Lago. Mais on voit difficilement la Chine se plier à l’injonction. Elle juge dangereux de freiner d’un coup le moteur des exportations dans la conjoncture incertaine qu’elle affronte. Elle a constaté aussi à quel point la concession faite par le Japon avait contribué à plonger le pays dans une longue période de déflation et de croissance en berne. L’UE résistera pareillement sachant qu’elle souffre déjà aujourd’hui d’un décalage fort en matière de performance économique. Et l’arrogance de la demande pousse à se rebiffer plutôt qu’à se soumettre.
Il resterait alors à l’administration Trump à jouer de son propre chef la dépréciation du dollar. Cela peut se faire déjà de deux façons : en abaissant fortement les taux d’intérêt et donc l’attrait d’investir dans cette monnaie. Mais c’est une variable qui est du ressort de la FED, la banque centrale du pays, qui garde jusqu’à nouvel ordre son indépendance et qui agira avec une extrême prudence si elle juge que les mesures portent le risque de faire rebondir l’inflation. Mettre au pas la FED, comme on en entend la rumeur dans les milieux proches de la Maison blanche, annoncerait une incertitude juridique et politique accrue (Vittori, 2025)7. On peut aussi, seconde façon mais qui demande l’aval du Congrès, utiliser l’arme fiscale, telle une taxation différenciée des placements de portefeuille aux États-Unis selon qu’ils viennent de l’étranger ou de l’intérieur (Raskolnikov-Steil, 2025) ou même une taxe sur les placements en dollars des banques centrales étrangères. On voudrait à la fois dissuader les investisseurs étrangers de faire des placements de portefeuille en dollars, tout en les incitant à se servir de plus en plus du dollar pour leurs échanges extérieurs. La voie est étroite.
Quid du déficit budgétaire ?
Avec surprise, une troisième façon n’est pas mentionnée par Stephen Miran. Il s’agirait que le Congrès décide d’une forte réduction du déficit budgétaire, ce qui limiterait l’offre d’obligations du Trésor étatsunien, ferait baisser les taux d’intérêt (qui varient en sens inverse du prix des obligations) et donc le coût de financement des entreprises. C’est une critique que fait justement Raghuram Rajan à Stephen Miran (Rajan, 2025). Il lui reproche de faire comme si le déficit public résultait passivement de la volonté des investisseurs d’acheter des bons du Trésor étatsunien plutôt que du laisser-aller ou de la crispation idéologique des membres du Congrès. Baisser le déficit, Trump s’y emploie suivant l’inclinaison naturelle du Parti républicain, à savoir réduire encore et toujours les dépenses. Il a mis pour cela Elon Musk à la manœuvre, peut-être pour briser, impopularité aidant, ses velléités politiques. On doute que cela aille bien loin si l’on doit respecter la promesse électorale de ne pas toucher aux dépenses sociales.
En réalité, il est aisé de réduire le déficit public si l’on agit du côté des impôts. Les États-Unis sont riches et les impôts y restent très faibles (29% du PIB en moyenne contre 43% pour la France) de sorte qu’un relatif effort fiscal peut rétablir les choses. À preuve, Clinton l’a fait lors de son double mandat : le solde public était passé de – 4,5% à +2,3% du PIB entre 1993 et 2000, même si cet effort n’a pas été sans un dommage social qui a coûté cher électoralement au Parti démocrate8. Aujourd’hui, Trump entend le faire par une hausse forte et généralisée des droits de douane.
La saga des droits de douane
De fait, l’annonce faite lors du « Libération Day » du début avril a surpris par son ampleur : 10% de droits de douane de base, sauf mise en place de droits dits « réciproques » au sens où ils frappent de façon spécifique le pays exportateur. Les pays asiatiques sont particulièrement touchés : la Chine avec des droits fixés au total à 54% et même à 65% si certains droits déjà en place ne sont pas supprimés ; plus élevés encore pour le Vietnam et le Cambodge au prétexte qu’ils sont des pays de réexportation de produits chinois. Mais aussi 26% pour l’Inde, 24% pour le Japon et 20% pour l’UE. Mexique et Canada ne semblent épargnés que parce qu’ils subissent déjà des droits de 25% sur de nombreuses exportations.
Les premiers chiffrages indiquent un taux moyen effectif de droits de douane de l’ordre de 24% (The Economist, 3 avril 2025), dépassant le point haut de l’année 1940, après la vague protectionniste que les États-Unis avaient déclenché dans les années 1930, une vague jugée coupable d’avoir aidé à la grande dépression de cette période. Appliqué à des importations qui font 14% du PIB étatsunien, les recettes fiscales atteindraient près de 3%, un niveau propre à effacer la moitié du déficit public actuel.
Il n’en sera jamais ainsi. On évolue en effet entre deux extrêmes, sur lesquels la rhétorique de Trump reste extrêmement floue et oscillante.
Le premier extrême est celui où les importations ne diminuent pas. L’effet budgétaire est alors entier, mais on enregistre une hausse très forte de l’inflation importée, un thème électoral devenu saillant sachant la façon dont Trump a conduit sa campagne. Le bien importé est plus cher et, très vite, le producteur du bien local qui était en concurrence profite de ce bol d’air pour monter ses prix9. Comme, in fine, les biens importés se retrouvent dans la consommation, les droits de douane agissent comme une taxe à la consommation, proche de la TVA si ce n’est qu’ils frappent la totalité du produit et non sa seule valeur ajoutée. L’effet est récessif sur la consommation et l’activité, ce qui efface le gain fiscal initial. De plus, les hausses de prix se diffusant dans toute l’économie, le gain de compétitivité obtenu par la hausse des droits de douane s’efface progressivement, selon un mécanisme qu’on observe souvent lors d’une dévaluation10.
Sachant enfin que toute menace d’inflation entraîne normalement une hausse des taux d’intérêt par initiative de la banque centrale ou par simple réaction des investisseurs obligataires soucieux de protéger leur patrimoine, on observe une pression en retour à la hausse d’un dollar devenu plus attractif et qui, là encore, fait perdre la compétitivité acquise11.
Stephen Miran fait valoir que les mesures protectionnistes prises lors du premier mandat de Trump n’ont pas été inflationnistes. Mais cela n’a été possible que parce que le dollar s’était fortement apprécié entre temps vis-à-vis du renminbi chinois, effaçant l’effet des tarifs douaniers, ceci vraisemblablement suite à des interventions de la Banque de Chine soucieuse de ne pas trop affecter ses exportations. Car tout le développement ci-dessus ne vaut bien sûr que si l’on omet les mesures de rétorsion de la part des partenaires commerciaux. On entre dans un jeu stratégique où chacun finit par disposer des mêmes outils d’attaque et de défense. Il est plus facile d’entamer une guerre commerciale que de l’arrêter.
Le difficile retour d’une production manufacturière locale
Le second extrême est celui que reprend plus volontiers Trump : les importations baissent fortement et une production locale vient les remplacer, y compris de la part d’entreprises étrangères trouvant plus profitable d’investir sur place pour y vendre leurs produits. Mais une telle substitution est dans la meilleure des configurations un processus lent et coûteux. Ce n’est qu’en économie de guerre qu’on peut, recourant à la planification autoritaire, réallouer rapidement les forces productives d’un pays. Ici, on exigerait le détricotage des chaînes de valeur intégrant de multiples pays, dont les États-Unis eux-mêmes12. Cette substitution est le plus souvent anti-économique car elle consomme des ressources que l’économie étatsunienne emploierait à meilleur escient dans d’autres activités, là où elle est déjà puissante et fortement exportatrice. Des emplois seraient créés, mais d’autres, plus vitaux pour l’économie, ne le seraient pas.
La réalité se fixera entre ces deux extrêmes, mais le plus probable est un effet inflationniste important, dont on a vu qu’il conduit largement à une impasse. Le plus curieux dans ce débat est la relation qu’on voudrait établir entre les droits de douane et une balance commerciale. Il n’y en a aucune. C’est l’ensemble des relations commerciales qu’il faut juger. Quand j’achète mon pain chez le boulanger, je lui donne mon argent et j’ai un déficit commercial avec lui. Mais j’ai un excédent commercial auprès de mon employeur à qui je vends contre argent mes services de travail. À supposer même, pour prendre l’exemple du Mexique, que des droits plus élevés sur ce pays aident à réduire l’excédent commercial qu’il a envers les États-Unis, cela voudrait dire moins de dollars achetés, plus de pesos vendus, et donc une dépréciation du peso face au dollar, ce qui effacerait une partie de l’effet des droits de douane sur la compétitivité.
Est-ce si favorable à l’électorat populiste ?
Une dernière difficulté risque d’apparaître, cette fois dans le volet populiste du programme économique. En tant que taxe sur la consommation, les droits de douane pèseront (à l’égal d’une TVA) de façon disproportionnée sur les classes moyennes et pauvres au moment même où l’on fera voter au Congrès une loi fiscale, renouvelant celle de 2017 déjà mentionnée, maintenant ou renforçant les baisses d’impôt sur les riches. Selon ce qui filtre du Congrès à ce sujet, elle représentera une baisse de 1.000$ pour le revenu médian, mais de 70.000$ pour le top 1%. Dans le même temps, les estimations faites pour la perte de pouvoir d’achat induite par les droits de douane annoncés – on ne parlait alors que d’un niveau de 10% – varient de l’ordre de 1.200$ à 2.000$ pour le revenu médian (voir l’interview de l’économiste Kimberly Clausing dans Klein, 2025).
On en est donc à se demander si les droits de douane annoncés n’appartiendraient pas davantage au domaine de la menace et du bluff que d’une mesure stratégique. On en a un indice à considérer qu’il s’agit de droits « réciproques » comme on l’a dit. Le vin exporté du Chili aux États-Unis sera taxé à 10% quand celui venant d’Italie le sera à 20%. C’est contraire à toute régulation stable et durable du commerce international où les droits sont attachés aux produits et non aux fournisseurs. Mais, tactiquement, cela permet une pression spécifique sur chaque pays, en profitant d’ailleurs de leur division (le Chili se satisfait de devenir d’un coup plus compétitif que l’Italie).
Un activisme vexatoire dangereux et des atouts négligés
Les États-Unis ne se reconnaissent plus dans un monde où ont émergé des puissances économiques et politiques nouvelles, autocratiques de surcroît, et qui, dans le cas de la Chine, les ont rattrapés dans beaucoup de domaines industriels et demain militaires. Il leur suffit d’un simple regard historique pour voir la façon dont, à partir de là, les choses peuvent dégénérer.
Le phénomène Trump est né de cette angoisse, mais il date de bien avant. Barack Obama avait déjà réorienté la politique étrangère du pays vers un containment de la Chine, après la désastreuse présidence Bush qui avait dispersé les forces et le crédit du pays dans des guerres coûteuses et désastreuses pour les régions concernées.
Mais l’option que retient Trump est à la fois brutale et dangereuse. Elle repose d’abord sur une surestimation de la capacité de coercition des États-Unis. Le pays ne peut plus jouer seul contre tous, alors que les puissances auxquelles il s’oppose disposent désormais d’un poids économique, démographique et d’innovation qui les mettent, dans certains domaines, à parité avec lui.
Il est très risqué aussi de ne pas prioriser les cibles, en rassemblant d’abord ses ouailles et en les enrôlant pour la cause. L’agressivité désordonnée qui prévaut à la Maison Blanche conduit au contraire aujourd’hui à rapprocher des puissances – Europe, Chine ou Inde – qui sont loin d’avoir les mêmes intérêts.
De plus, on néglige un fait historique important. La domination étatsunienne a eu sa part de violence mais a également su user du soft power pour rester attirante. Les élites du monde entier restent encore fascinées par la culture et la vitalité de ce pays. « US go home, but take me with you », telle était la blague courante quand l’armée américaine quittait un pays. Voici que l’offensive unilatérale de Trump révulse les opinions publiques des pays amis. Le Canada s’apprêtait à faire venir au pouvoir un parti conservateur favorable à Trump. Le sans-gêne dont celui-ci a fait preuve va selon toute chance confirmer au pouvoir le Parti libéral lors des élections prochaines, avec un Mark Carney qui lui est franchement hostile comme Premier ministre. L’Europe convient à présent qu’elle doit fournir un effort financier beaucoup plus important pour sa défense nationale. C’était l’opportunité rêvée pour que les États-Unis développent plus encore leur industrie d’armement à l’exportation. Mais voir son grand pays allié devenu si agressif et imprévisible commande à l’Europe une prudence stratégique et donc de bâtir une industrie locale puissante. Dans ce qui s’annonce être une fragmentation par bloc de l’espace politique mondial, l’Europe peut prendre conscience qu’à la différence de la Chine, elle ne dispose que d’une autonomie très faible s’agissant d’industries aussi stratégiques que celle des moyens de paiement (Visa, Mastercard) ou des réseaux sociaux. Les mesures de rétorsion pourraient utilement cibler ces industries de service. Loin de s’ouvrir aux Américains, certains marchés vont donc se fermer.
Tant la méthode que l’instrument retenu, les droits de douane, sont contreproductifs. On doit reconnaître au libre-échange – et le mérite en revient largement à l’ordre économique que les États-Unis ont mis en place au sortir de la guerre – d’avoir réussi à sortir de la pauvreté une fraction importante de la population mondiale, particulièrement en Asie. Cela n’avait pas été sans pressions sur les pays pour qu’ils adoptent des politiques pro-marché et d’ouverture de leurs frontières. Certaines institutions internationales, comme le FMI, l’OMC, l’OCDE ou la Banque mondiale, en avaient été les instruments. Mais on a tardé à prendre conscience que le processus était trop rapide, limitant la capacité des pays occidentaux de s’adapter à ce changement et à éviter un coût social important.
On retrouve ici le débat habituel sur le libre-échange mais qui, dans le cas d’espèce, doit prendre en compte que, d’une certaine façon, le mal est déjà fait, les emplois manufacturiers peu qualifiés ont largement disparu et il sera extrêmement difficile qu’ils reviennent tant qu’il subsiste des différences de salaire entre les États-Unis et certains pays étrangers d’un ordre de grandeur qui dépasse de loin un droit de douane à 24%. Et de toute façon, les technologies ne sont plus mêmes et leur niveau de productivité ne permettent plus de créer le volume de travail antérieur. Il est par ailleurs incompréhensible pour les pays dits non-alignés de voir l’Occident, après qu’il a usé tant et plus des arguments libre-échangistes et parfois les avoir imposées de force, s’en détourner au moment où le jeu ne lui est plus si favorable.
Une approche plus féconde est d’investir fortement dans les secteurs économiques de demain. Cela avait été le choix politique fait par l’administration Biden avec sa loi dite IRA, supprimée par Trump. Ce choix n’était pas exempt de critiques quant à son exécution (Furman, 2025) et n’évitait pas complètement le reproche de protectionnisme dès lors qu’il usait de subventions importantes – ce qu’on reproche à la Chine. Mais il s’agit d’un pas obligé si le pays juge avoir pris du retard dans certains domaines industriels. Il n’exclurait pas pour les États-Unis, tout orgueil mis de côté, de demander à la Chine ce que la Chine leur avait demandé il y a trente ans, à savoir souhaiter la bienvenue aux entreprises chinoises pour qu’elles vendent leurs produits sur le marché étatsunien, à la condition qu’elles produisent sur place et que leur technologie soit rendue disponible. Biden n’allait bien sûr pas jusque-là.
Les États-Unis choisissent malheureusement une autre route. Ils rendent inopérantes et discréditent les institutions internationales citées plus haut au moment où celles-ci élargissaient utilement leur champ de vision et abandonnaient ce qu’on appelait le « consensus de Washington », programme d’ajustement pour les pays en difficulté reposant sur des concepts vieillis de la macroéconomie. Si imparfaites qu’elles soient encore, notamment en raison d’une gouvernance trop monopolisée par les pays occidentaux, elles restent les seuls lieux où des accommodements et des compromis peuvent être trouvés. C’est l’ordre politique international qui est menacé. Il faut très peu d’énergie pour créer le désordre, nous dit la thermodynamique, il en faut beaucoup pour reconstruire un ordre nouveau. Le changement d’époque est périlleux.
Références
Autor, David, David Dorn and Gordon Hanson, 2021, On the persistence of the China shock, Brookings Papers on Economic Activity.
Douthat, Roos, “Steve Bannon on ‘Broligarchs’ vs. Populism”, New York Times, January 31, 2025.
Friedberg, Aaron L., 2024, Stopping the Next China Shock. A Collective Strategy for Countering Beijing’s Mercantilism, Foreign Affairs, September/October.
Furman, Jason, The Post-Neoliberal Delusion and the Tragedy of Bidenomics, Foreign Affairs, March/April 2025.
Gourinchas, Pierre-Olivier and Hélène Rey, 2007, International Financial Adjustment, Journal of Political Economy, 2007, 115 (4), 665–703.
Hirschman, Albert O., 1945, National Power and the Structure of Foreign Trade, University of California Press.
Klein, Ezra, Why Trump’s Tariffs Won’t Work. Entretien avec Kimberly Clausing, New York Times, March 12, 2025.
McKinsey Global Institute, 2009, An exorbitant privilege? Implications of reserve currencies for competitiveness, Discussion paper, December.
Miran, Stephen, 2024, A User’s Guide to Restructuring the Global Trading System, Hudson Bay Capital, November.
Rajan, Raghuram G., « Un dollar attractif est-il vraiment un fardeau pour les Américains ? », Le Monde, 20 mars 2025.
Raskolnikov, Alex and Benn Steil, 2025, A Better Tool to Counter China’s Unfair Trade Practices. End the Tax Advantage for Chinese Investors in U.S. Markets, Foreign Affairs, 19 février.
Sunstein, Cass R., 2025, This Theory Is Behind Trump’s Power Grab, The New York Times, Fév. 26.
The Economist, « Trump takes America’s trade policies back to the 19th century », April 3, 2025.
Vittori, Jean-Marc, « Le match Trump-Powell », Les Echos, 18 mars 2025.