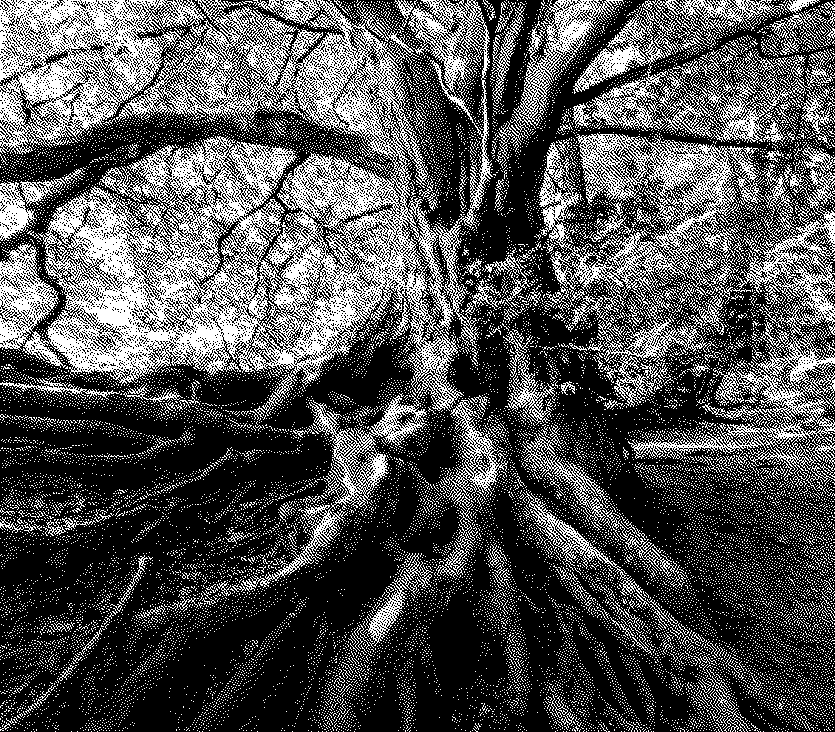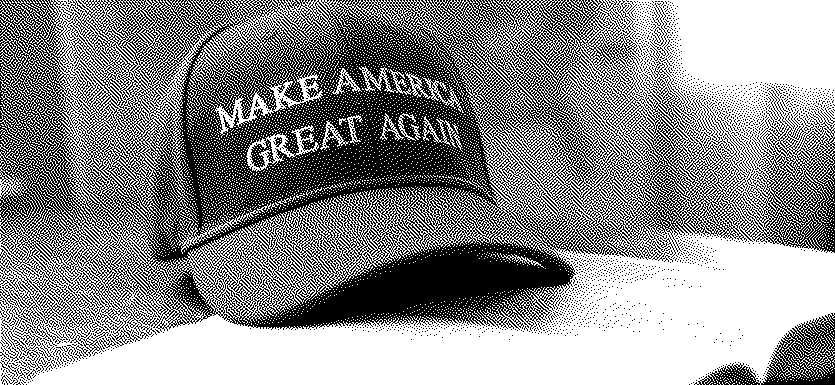Comportant 130 articles, ce texte, à la fois ambitieux et précurseur, représente un tournant dans la transformation de notre économie et dans la gestion des déchets. Il repose sur cinq axes stratégiques : mieux produire, mieux informer les consommateurs, réduire les plastiques à usage unique, lutter contre le gaspillage et l’obsolescence programmée. Par son ampleur, cette loi touche à de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Son ambition est de réaliser la transition entre le monde du tout-jetable et celui du tout-réutilisable. Concrètement, l’objectif est de réduire significativement notre production de déchets, notamment de plastiques, tout en créant des filières économiques nouvelles. Le cadre législatif français a donc été révisé pour instaurer une économie circulaire, où les déchets sont considérés comme des ressources réutilisables et où les priorités de traitement sont définies : la prévention des déchets, le réemploi, le recyclage, la valorisation énergétique, l’incinération et enfin le stockage en décharge. Cette loi s’accompagne de moyens de suivi et d’objectifs fixés sur des horizons de 5, 10, 15 et 20 ans. Ces objectifs doivent être suivis par des instruments de mesure et des dispositifs de régulation.
1. Les ambitions de la loi AGEC
a) Responsabilisation des acteurs économiques
La loi AGEC a imposé de nouvelles exigences réglementaires aux producteurs (entreprises qui mettent des produits sur le marché). Elle renforce leurs responsabilités sur le principe du pollueur-payeur, selon lequel ceux qui fabriquent, distribuent ou importent un produit doivent financer et organiser sa gestion en fin de vie (collecte, réutilisation, recyclage, etc.). Pour mettre en œuvre ce principe, la loi s’appuie sur les filières à responsabilité élargie du producteur (REP). Une douzaine de filières REP existaient déjà en France (emballages ménagers et papiers graphiques ; textiles, linges et chaussures ; piles et accumulateurs), mais la loi AGEC a prévu de créer, de 2021 à 2025, une dizaine de filières supplémentaires, comme les déchets du secteur du bâtiment, et a élargi certaines filières existantes.
Ces filières obligent les producteurs à assumer la gestion de leurs déchets, soit en mettant en place un système individuel de collecte et de traitement, soit via des éco-organismes financés par une écocontribution. Les entreprises qui adhèrent à ces éco-organismes paient une contribution qui finance la collecte, le tri et le recyclage des déchets générés par leurs produits. L’objectif est d’inciter les producteurs à réduire leur production de déchets et à concevoir des produits plus facilement recyclables ou réutilisables.
Parallèlement, la loi a imposé aux producteurs1 d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de prévention et d’éco conception dans l’objectif d’accroître l’utilisation de matières recyclées et la recyclabilité des produits. Ce plan, qui doit être révisé tous les 5 ans, peut être individuel ou commun à plusieurs producteurs.
Enfin, au sein de certaines filières2, des fonds dédiés à la réparation et au réemploi3 ont été créés. Les entreprises concernées contribuent à ces fonds à hauteur de 5% de leur contribution à la filière REP4. Ces fonds permettent de soutenir les acteurs de l’ESS qui œuvrent dans le domaine du reconditionnement et la réparation de biens électroniques (téléphones, ordinateurs) ou d’électroménagers (lave-linge, petits appareils…).
b) Information et sensibilisation des consommateurs
La transition vers une économie circulaire implique également un profond changement des modes de consommation. Cela nécessite de sensibiliser les consommateurs afin qu’ils trient davantage leurs déchets, gaspillent moins et achètent des produits plus durables.
L’objectif de la loi est de réduire de 15% des déchets ménagers entre 2010 et 2030 (502 kg/habitant en 2030 contre 611 kg en 2021) notamment en réduisant le gaspillage et améliorant le tri. Pour cela, plusieurs leviers sont mis en place pour améliorer le tri des déchets par les consommateurs, tels que l’affichage des règles de tri sur les produits ou encore l’amélioration de l’accessibilité aux infrastructures de tri, facilitée par une harmonisation des pratiques de tri et de collecte à l’échelle nationale.
Enfin, depuis le 1er janvier 2024, le tri des biodéchets a été généralisé, touchant à la fois les professionnels et les particuliers.
Une autre priorité de la loi est la réduction du gaspillage alimentaire. L’objectif est de diminuer de 50% le gaspillage dans les secteurs de la distribution alimentaire et de la restauration collective d’ici 2025, par rapport à 2015. Dans la restauration commerciale, un label « anti-gaspillage alimentaire » a été créé pour valoriser les initiatives vertueuses et soutenir la réalisation de ces objectifs. Des programmes spécifiques, comme le don de denrées non vendues aux associations caritatives, sont soutenus par la loi
L’affichage environnemental, en cours d’expérimentation dans quelques filières REP, doit permettre de communiquer une information claire aux consommateurs sur les impacts environnementaux des produits. D’autres indicateurs ont également été mis en place sur des critères spécifiques de réparabilité et de durabilité pour orienter les choix des consommateurs vers des produits plus respectueux de l’environnement.
A partir de 2025, l’indice de durabilité remplacera l’indice de réparabilité5 pour certaines catégories de produits. Il comprend de nouveaux critères, notamment relatifs à la fiabilité du produit.
c) Sortir des emballages en plastique à usage unique d’ici 2040
Le décret d’application 3R (Réduction, Réemploi et Recyclage), publié en avril 2021 est une feuille de route 2021- 2025 qui fixe des objectifs précis pour tendre vers la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040.
Les objectifs sont extrêmement ambitieux : réduire de 20% les emballages plastiques à usage unique d’ici 2025 ; recycler 100% des emballages plastiques à usage unique d’ici janvier 2025 et augmenter la proportion d’emballages réemployés (5% des emballages réemployés en 2023 et 10% en 2027). Néanmoins, ce décret est non contraignant et ne fixe aucune interdiction.
d) Lutter contre le gaspillage et l’obsolescence programmée
La lutte contre l’obsolescence programmée contribue également à allonger la durée de vie des produits en améliorant leur réparabilité, notamment grâce à la disponibilité des pièces détachées et à la possibilité de mises à jour logicielles.
2. Un bilan contrasté : une mise en œuvre insuffisante et des défis à surmonter
Cinq ans après sa promulgation, il apparait que la mise en œuvre de la loi AGEC reste insuffisante 6 et que la France peine à atteindre ses objectifs. Bien que des progrès indéniables aient été réalisés, il reste encore beaucoup à faire pour que cette transition soit véritablement efficace.
De nombreux acteurs soulignent le manque d’application des mesures visant à encourager la prévention des déchets, le réemploi et la réparation. Bien que la loi mette en avant la réduction des déchets à la source, son application s’est principalement concentrée sur la collecte, le tri et le recyclage, négligeant parfois les leviers préventifs. Ainsi, dans son rapport annuel de 2023, l’ADEME pointe un retard en matière de réduction et de réemploi des emballages ménagers, encore trop éloignés des objectifs nationaux et internationaux3. Certaines mesures, telle la réutilisation de la vaisselle réutilisable, sont inégalement appliquées. Certains objectifs comme celui des 5% d’emballages réemployés l’an dernier ne sont pas atteints, d’autres ont été complétement abandonnés, comme la trajectoire de réduction de mise en marché des bouteilles plastique.
Plusieurs obstacles freinent la transition vers une économie circulaire pleinement fonctionnelle, notamment le retard dans la collecte de données fiables, des difficultés d’application de certaines mesures, la lenteur du déploiement des nouvelles filières REP et le manque de contrôle sur les objectifs qualitatifs. Un rapport parlementaire d’évaluation de la Loi AGEC publié en mai 2024 recommande de renforcer les contrôles pour mieux suivre l’application de la loi. Les mesures de prévention et de réemploi, deux axes essentiels de la loi AGEC, rencontrent des résistances et des lenteurs. Les objectifs ne sont pas toujours suivis avec la rigueur nécessaire pour provoquer un changement durable dans les comportements de consommation. Les députés préconisent d’augmenter des moyens alloués aux services de l’État en charge de ces contrôles, notamment pour la répression des fraudes, et proposent d’introduire des pénalités financières systématiques en cas de non-respect des obligations légales.
a) Les résultats de la loi Agec : des avancées notables, mais une mise en œuvre encore partielle
La création de nouvelles filières REP et l’extension des filières existantes était un axe majeur de la loi. Cependant, leur déploiement a été retardé de manière significative, ce qui a compromis leur capacité à atteindre les objectifs fixés. La mise en place de ces nouvelles filières et la révision des cahiers des charges des filières existantes ont entraîné une surcharge de travail pour les parties prenantes, retardant ainsi leur mise en œuvre effective.
Les mécanismes de gouvernance des filières REP se révèlent insuffisants. Leur capacité à atteindre les objectifs environnementaux reste problématique, en raison notamment de l’absence de contrôles stricts et de sanctions en cas de non-respect des engagements. L’un des enjeux majeurs de la mise en œuvre de la loi réside dans l’efficacité du contrôle des performances des REP. La montée en puissance de ces filières dans les années à venir, avec des contributions financières de plus en plus importantes, soulève la question de leur capacité à atteindre les objectifs environnementaux, notamment en termes de réduction des déchets. L’introduction d’une autorité indépendante dédiée à l’évaluation de l’application des cahiers des charges des éco-organismes proposée par la mission parlementaire pourrait être une solution pour garantir la transparence et l’efficacité du système.
b) Le retard de la collecte des données : un frein à l’évaluation des impacts
Une évaluation précise des effets de la loi Agec est entravée par le retard dans la collecte et la mise à disposition des données nécessaires. En dépit des efforts entrepris pour améliorer la surveillance des flux de déchets et la performance des filières REP, les premières données disponibles7 remontent à 2020 et 2021. Ce décalage temporel empêche d’avoir un recul suffisant pour mesurer les impacts réels de la loi sur l’environnement, l’économie et la société. Les objectifs qualitatifs et quantitatifs, bien qu’ambitieux, peinent à être suivis et mesurés de manière cohérente. De plus, l’absence de certains indicateurs spécifiques et l’imprécision des objectifs qualitatifs compliquent le travail de suivi et d’évaluation. La majorité des objectifs qualitatifs, bien que clairs en termes de direction, ne sont pas toujours assortis de critères de mesure ou de contrôles. Ce manque d’outils de suivi limite l’efficience du dispositif législatif.
c) Des mesures concrètes mais des objectifs à affiner
L’application effective de certaines mesures reste timide. Des actions plus coercitives doivent être envisagées pour renforcer l’obligation de réutilisation et de recyclage des produits, et en particulier la prise en compte de la fin de vie des produits dès leur conception.
d) Une législation pionnière, mais des défis européens à surmonter
La loi AGEC a inspiré de nombreux pays européens et a nourri la réflexion de la Commission européenne qui, en novembre 2022, proposait une révision de son règlement Emballages et déchets d’emballages. Cependant, elle fait encore face à de nombreuses résistances. Le droit européen, qui garantit la libre circulation des marchandises, a restreint l’impact de la loi. En février 2023, la Commission européenne a ouvert une procédure d’infraction contre la France pour non-respect des règles de concurrence européennes. Elle considère que l’obligation d’afficher les consignes de tri en France contrevient au principe de libre circulation des biens. La Commission estime que cette mesure pourrait avoir des effets contreproductifs sur l’environnement, notamment en entraînant une hausse de la demande en matériaux pour l’étiquetage8. Certaines de ses dispositions les plus innovantes, comme l’indice de durabilité pour les smartphones ont été bloqués dans leur mise en œuvre. La Commission européenne a rendu un avis défavorable en octobre dernier. Elle considère que ce dispositif va à l’encontre du droit communautaire puisque l’étiquette énergie des smartphones va contenir prochainement un « indice » de réparabilité européen, mais établi sur des critères différents.
e) Des enjeux économiques
Les enjeux économiques sont nombreux et divers comme par exemple l’utilisation des matières recyclées. La baisse du prix du pétrole brut ces dernières années n’incite pas les producteurs à atteindre les objectifs fixés par la loi, dans la mesure où il est aujourd’hui moins coûteux d’acquérir une matière première primaire qu’une matière première recyclée. Dans un marché tendu et hyper concurrentiel, cela pèse sur toute l’industrie du recyclage et de la réutilisation.
Conclusion : Un bilan positif mais un chemin semé d’embûches
En conclusion, bien que la loi ait posé les bases d’une transition vers l’économie circulaire, son efficacité reste limitée par une mise en œuvre partielle, un manque de contrôle et des objectifs encore flous ou insuffisamment mesurés. Pour que cette législation devienne réellement transformative, il est nécessaire d’intensifier les efforts en matière de prévention des déchets, de réemploi et de réparation, de renforcer les mécanismes de gouvernance et de suivi des filières REP, et d’œuvrer pour une harmonisation des règles au niveau européen. La France doit ainsi faire preuve de leadership pour mener cette transition avec succès, dans un cadre législatif solide et cohérent.