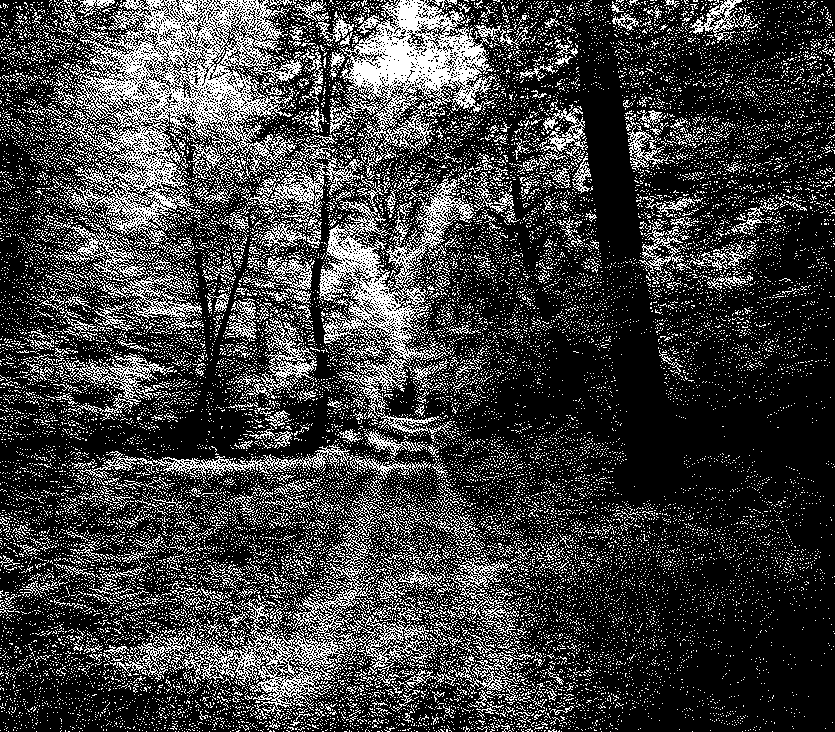Ne faisons pas durer le suspense : nous partageons pleinement les constats et le diagnostic posé, sans détour, par Frédérik Jobert dans son appel à changer de paradigme en matière de politique forestière.
Mais l’heure n’est pas à la célébration, et encore moins au triomphalisme.
Que l’analyse portée par les ONG environnementales depuis 4 ans sur le dispositif de soutien aux plantations ou, depuis encore plus longtemps, sur la nécessité de mieux encadrer les usages du bois énergie, soit partagée par un acteur au cœur du processus décisionnel est, en réalité, loin d’être réjouissant. Que les blocages institutionnels et l’absence de considération des arguments que nous avons déployés sans relâche, mais sans grand succès, soient ainsi reconnus, est encore davantage désolant. Expression rare à ce niveau de responsabilité, l’auteur évoque en effet une “défaite de la pensée” (sic) en décrivant une prise de décision tronquée par la proximité entre décideurs publics et acteurs économiques, au détriment d’évolutions nécessaires pour faire face aux défis qui sont devant nous (affaiblissement du puits de carbone forestier, effondrement de la biodiversité, aspirations à plus de nature, etc.).
Savoir reconnaître quand on ne prend pas la bonne direction n’est pas à la portée de toutes les institutions, et nous devons ici saluer l’évaluation factuelle et argumentée détaillée par le haut fonctionnaire.
Celle-ci résonne particulièrement pour le WWF France, puisque c’est à la lumière de la politique forestière menée actuellement (ou devrait-on dire en réalité, inchangée depuis les années 1960), et particulièrement de l’injonction faite par le président de la république et 2022 de “planter 1 milliard d’arbres en dix ans”, que nous avons décidé de nous interroger sur le futur des forêts. En élaborant l’étude “Enchantées ou désenchantées : quelles forêts françaises en 2100 ?”, nous avons souhaité mettre au jour les conséquences des décisions prises, et imaginer deux visions alternatives. L’une, grossissant le trait de la “rationalisation économique” à l’œuvre, est marquée par une spécialisation accrue des forêts, le développement de l’usage du bois énergie (notamment pour l’aviation), et un délitement de la relation entre la forêt et la société. L’autre, de “planification territoriale”, met en avant le renforcement du dialogue autour de la gestion forestière, une intervention accrue de la puissance publique et une politique forestière réellement intégrée.
Sans s’être concertés avec Frédérik Jobert, nous parvenons donc à une conclusion analogue : il est urgent de repenser notre manière de conduire la politique forestière.
Alors, comment avancer… Et trouver les voies de passage ?
Frédérik Jobert formule des recommandations qui ne sont pas nouvelles. A titre d’exemple, en 2021, Barbara Pompili avait déjà appelé, dans une contribution à Terra Nova, à rénover la politique forestière en formulant des propositions en amont des Assises de la Forêt et du Bois.
En 2025, pour la première fois, les forêts et le secteur forestier relèvent du ministère en charge de la nature, qui est aussi celui qui pilote l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, les politiques de prévention et de gestion des déchets, ou encore la prévention des risques naturels. Nous pensons qu’il ne s’agit là que d’une mise en cohérence, tant les conditions de l’environnement (climat, régime hydrique, sols…) sont le fondement de ce que produisent les forêts, et donc de ce que la société pourra récolter en forêt. Mais c’est également une opportunité de reconnaître la contribution des forêts à la préservation de l’environnement, que cette contribution soit héritée de la gestion passée, actuelle ou à venir. Diversification et hétérogénéité des forêts doivent être, non seulement respectées, mais plus encore, recherchées, comme y appelle Frédérik Jobert en plaidant pour un soutien renforcé des sylvicultures plus douces et respectueuses du fonctionnement naturel des forêts.
Nous ne rejoignons pas Frédérik Jobert sur tout : en particulier, nous pensons que les coupes rases peuvent, et doivent, être encadrées. Discutons-en, inspirons-nous des expériences menées sur ce point, par exemple dans le cadre du référentiel de certification forestière FSC, qui a abouti à un consensus entre les chambres environnementale, sociale et économique sur la nécessité d’imposer aux coupes rases une limitation forte, tout en étant progressive pour les modes de sylviculture les plus intensifs.
En revanche, nous souscrivons à la demande de transparence et d’évaluation des effets des politiques publiques sur les forêts, ainsi qu’à celle du déploiement de nouveaux espaces de dialogue. Nous pensons qu’il est nécessaire de rénover en profondeur le “dialogue institutionnel local” sur les forêts, aujourd’hui quasi inexistant tant les Commissions régionales de la forêt et du bois ne permettent pas de renforcer la compréhension mutuelle ni de croiser les expertises.
Sur la base du scénario de “planification territoriale” de l’étude “Enchantées ou désenchantées: quelles forêts françaises en 2100 ?”, nous plaidons pour une politique forestière au plus près des territoires, mais plus inclusive : développer au sein d’une même instance des temps d’échange techniques, par exemple sur l’équilibre sylvo-cynégétique comme y appelle Frédérik Jobert, mais aussi sur les espèces protégées, sur les peuplements d’avenir, sur l’anticipation des crises, sur la médiation de conflits locaux, sur la gestion concertée à l’échelle de massifs ou de groupements de propriétés, sur la prévention des incendies, sur l’optimisation du transport et de la logistique, etc. Tous ces sujets sont susceptibles d’intéresser, mais surtout d’enrichir la vision de chaque porteur d’intérêt, et le saucissonnage des sujets ne peut plus continuer à prévaloir aujourd’hui.
Des stratégies sans regret sont possibles d’un point de vue technique : nous parlons de “solutions fondées sur la nature”, Frédérik Jobert fait référence à la “maximisation des valeurs d’options”. Mais, plus important encore, nous pensons que le fait d’obtenir un consensus sur une gestion plus intégrée et plus inclusive des forêts constituerait une stratégie sans regret collective. Face au changement climatique, des erreurs de gestion sont inévitables, mais nous pensons qu’une décision partagée emporte la co-responsabilité des succès comme des échecs. Ainsi, nous pourrons dire que nous nous sommes trompés, que certaines données nous manquaient pour prendre des décisions plus avisées, etc. Mais c’est toujours plus satisfaisant que de constater que “celles et ceux qui avaient raison n’ont pas été écoutés”.