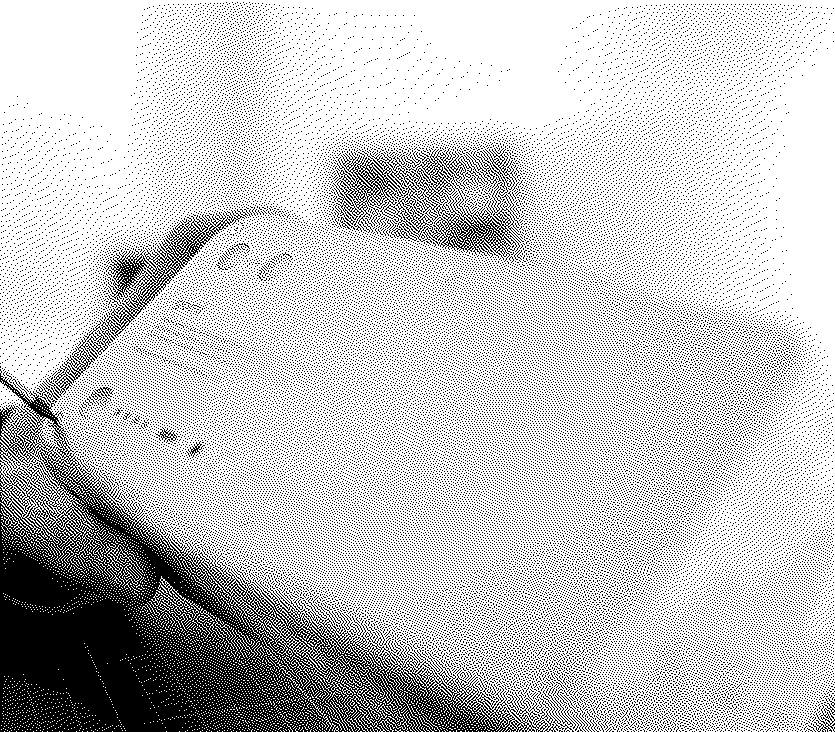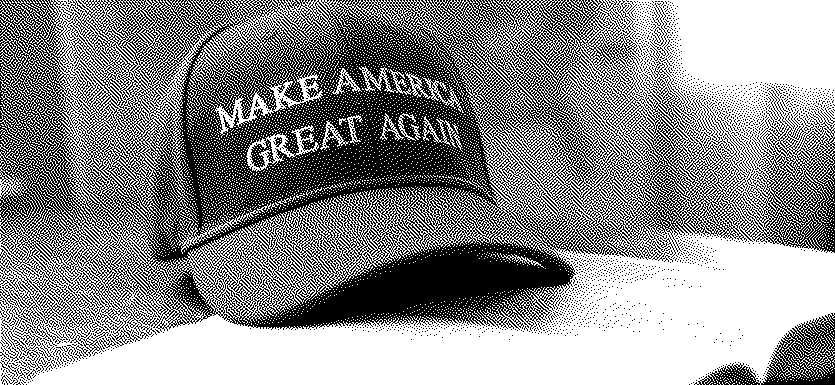La loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire (AGEC), adoptée en 2020, a marqué une étape cruciale dans la lutte pour la préservation des ressources et donc pour la transition écologique. Il est encore peu connu que 45% des émissions de CO2 à l’échelle de la planète proviennent de l’extraction des ressources naturelles1. Ainsi le sujet de la maximisation de l’utilisation des ressources déjà extraites et celui de la lutte contre le dérèglement climatique sont intrinsèquement liés.
Cependant, malgré les avancées de cette loi pionnière portée par la volonté de la secrétaire d’État Brune Poirson (son contenu ne figurait pas dans le programme du candidat Macron en 2017), des ajustements sont nécessaires pour atteindre pleinement ses objectifs ambitieux. L’audition de la mission d’évaluation de la loi AGEC réalisée par les députés Véronique Riotton et Stéphane Delautrette a mis en lumière les succès et les défis rencontrés, tout en proposant des pistes d’amélioration pour une transition plus efficace vers une économie capable de supplanter progressivement l’économie linéaire.
La loi AGEC a d’abord permis de sensibiliser les politiques, les citoyens et les acteurs économiques à l’importance de la transition vers une économie circulaire. Elle a mis le curseur sur le problème pour mieux le régler. Elle a amorcé la mise en place de financements essentiels tels que le fonds réparation, le fonds réemploi dédié ou encore l’écomodulation pour inciter les entreprises à lancer des stratégies circulaires.
Des initiatives entrepreneuriales ont d’ailleurs émergé directement dans la foulée de la loi. Par exemple, dans le secteur des pneus rechapés, l’article 60 a poussé l’entreprise de taille intermédiaire Mobivia a monté au capital de l’entreprise Black Star, sur le point de fermer faute de commandes et de financement, et d’ouvrir une usine à Béthune, territoire victime de plans sociaux sanglants ces dernières années avec la désindustrialisation rampante. Dans le domaine du gros électroménager, des entreprises comme Murfy ou Underdog suivent des trajectoires économiques ambitieuses avec des modèles durables qui créent de nouveaux emplois sur le territoire français. L’interdiction du plastique à usage unique, stipulée par l’article 77, a permis à Gobi de tripler son chiffre d’affaires entre 2018 et 2020. L’usine de Compans de Vesto se spécialise dans le réemploi de matériel de restauration, offrant une seconde vie aux équipements tout en réduisant l’empreinte carbone associée à la production de nouveaux articles. Le centre de réemploi de Manutan, lancé en mars 2024, se concentre sur le reconditionnement du mobilier de bureau, dont 93% aujourd’hui n’est pas réemployé en France ! Dans le secteur du textile et de la mode, les synergies entre grands groupes, start-ups circulaires et associations ont permis de valoriser de plus en plus les stocks dormants et d’augmenter le taux d’incorporation de matières recyclées. Enfin, les très grands groupes aussi montrent de plus en plus l’exemple : l’usine de Primas de Schneider Electric se consacre au reconditionnement de matériel électrique, permettant ainsi de prolonger la durée de vie des produits et de réduire les déchets avec un très haut niveau de performance technologique et opérationnelle digne de l’industrie classique.
Malgré ces succès, la loi AGEC présente des lacunes qui freinent la transition vers une économie circulaire complète. La hiérarchie des 3R (Réduire, Réutiliser, Recycler) est déséquilibrée, avec un focus excessif sur le recyclage au détriment du réemploi. Les objectifs de réemploi sont encore trop bas comparés à ceux de collecte et de recyclage, avec seulement 2 % pour les équipements électriques et électroniques2 et les déchets d’équipements électriques et électroniques ou 3% pour le mobilier à fin 2023. L’absence de tri généralisé en amont et de procédés de collecte adaptés réduit les chances de réemploi des produits. De plus, les produits réemployés reçoivent peu de financements comparés aux produits neufs et au recyclage. La modulation de l’écocontribution, par exemple, prévoit un bonus de 10 euros pour les smartphones neufs ayant une bonne note à l’indice de réparabilité, mais rien pour les produits réemployés ou les services de l’économie circulaire pourtant plus vertueux pour l’environnement. Pire, ceux qui ne sont pas collectés en France, alors que le gisement de produits réemployés est insuffisant, doivent payer une écocontribution de plus en plus élevée pour notamment financer ces bonus sur le neuf…
Pour corriger ces lacunes, la hiérarchie des 3R doit être revue en favorisant le réemploi pour en faire un levier majeur de compétitivité et de réindustrialisation.
Les pistes activables par la puissance publique incluent l’intégration de la transition vers l’économie circulaire dans les critères d’investissement, le passage d’une fiscalité sur la valeur ajoutée à une fiscalité sur la valeur environnementale, l’imposition de sanctions plus strictes en cas de non-respect des objectifs et de manière générale une vraie politique industrielle nationale de réemploi.
Cet essor doit se faire avec et au profit des acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) qui jouent ont toujours joué en pionniers un rôle crucial dans cette transition. Les organisations de l’ESS, comme les ressources et les recycleries, le mouvement Emmaüs ou le réseau Envie, non seulement réduisent les déchets, mais remplissent une mission sociale cruciale. Cependant, ces acteurs rencontrent des difficultés à obtenir des financements suffisants et à maintenir des modèles économiques pérennes. Il est donc essentiel de penser des synergies avec les investissements des acteurs économiques classiques pour que l’essor de l’économie circulaire profite à tous.
La mise en place d’une consigne mixte pour le réemploi et le recyclage apparaît enfin comme une solution indispensable pour atteindre les objectifs réglementaires européens et stopper l’incinération, l’enfouissement et le dépôt sauvage de millions de tonnes d’emballages. Chaque heure, un million de bouteilles plastiques et canettes finissent dans l’environnement3 car non collectées par le système actuel, soit 8 milliards par an, alors qu’elles le seraient avec une consigne. Et la France a dû encore s’acquitter en 2024 de la taxe plastique de l’UE à hauteur de 1,5 milliards d’euros4 pour manquement à ses objectifs de collecte et de recyclage ! Inadmissible à l’heure où le déficit de l’État se creuse et où chaque euro compte.
En conclusion, la loi AGEC a permis de poser les bases d’une économie circulaire en France, mais une politique volontariste de déploiement concrète et d’incarnation est nécessaire pour qu’elle devienne une réalité et porte tous ses fruits écologiques, sociaux et environnementaux : c’est pour cette raison que notre association EC2027 a appelé à travers une tribune5 dans le Monde à l’été 2024 à la nomination d’une ou d’un ministre dédié à l’économie circulaire.