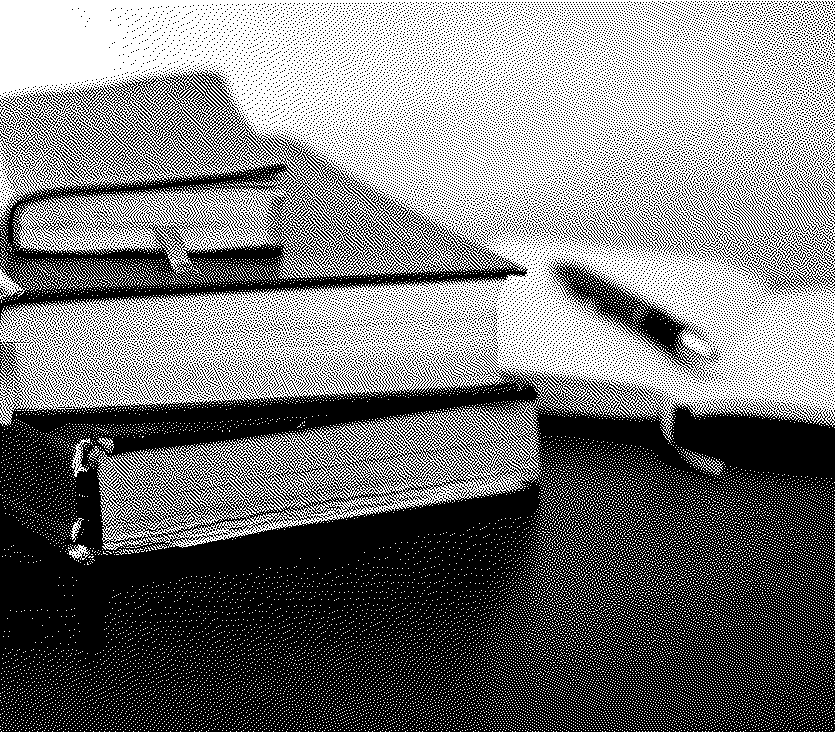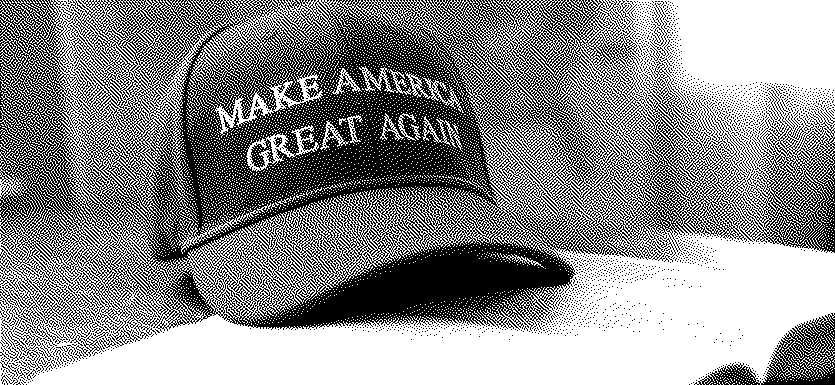La genèse et le contexte de la loi Agec
La Loi AGEC était l’un des volets d’une démarche globale qui s’appuyait sur plusieurs dimensions : la construction d’une feuille de route pour l’économie circulaire, un volet fiscal avec la hausse de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), et le volet législatif avec la loi AGEC. Comment l’avez-vous pensée ?
La Grande Conversation
Dès ma prise de fonction ministérielle à la transition écologique, j’avais élaboré une vision précise de la politique environnementale que je souhaitais mettre en œuvre, à une période où les questions écologiques n’occupaient pas encore le devant de la scène. C’est dans cette optique, et avec le soutien du Président de la République et Premier Ministre Edouard Philippe, que nous avons initié plusieurs actions majeures et complémentaires : l’élaboration de la feuille de route pour l’économie circulaire, la revalorisation de la TGAP, une suite d’engagements volontaires des entreprises, l’organisation d’une centaine de concertations avec les parties prenantes, dans l’optique de préparer le terrain législatif, et enfin, l’intégration de l’économie circulaire dans le plan de relance. La loi AGEC constituait l’aboutissement de cette démarche, fruit d’une réflexion approfondie nourrie par cette démarche de co-construction.
La transition d’une économie linéaire vers une économie circulaire implique des mutations systémiques profondes. L’efficacité de la loi nécessitait un travail préparatoire considérable. La crise des gilets jaunes créait des attentes très fortes. Il était crucial de fédérer l’ensemble des acteurs du système pour opérer cette transformation. J’ai donc amorcé cette démarche dès mon entrée en fonction, avec le soutien d’une équipe très compétente et convaincue, et maintenu cette ligne directrice tout au long de mon mandat. J’ai délibérément choisi de ne pas associer mon nom à cette loi, privilégiant une appellation explicite pour les citoyens. C’est ainsi que j’ai proposé l’intitulé « loi anti-gaspillage », dans un souci de clarté. Toutefois, j’ai rencontré des résistances car, pour certains, c’était un terme qui faisait écho de la crise pétrolière de la fin des années 1970. J’ai complété par « pour une économie circulaire ».
La réussite de cette transformation économique exigeait une impulsion et un engagement politique soutenus. Cette vision nous a permis de rassembler divers acteurs. Un élan politique était nécessaire pour impulser des changements structurels profonds. C’est dans cette perspective que nous avons entrepris l’élaboration de la feuille de route pour une économie circulaire, en commençant par réunir l’ensemble des parties prenantes, particulièrement les acteurs économiques.
Brune Poirson
Cette vision faisait-elle l’unanimité au sein de l’exécutif ? Comment êtes-vous parvenue à remporter des arbitrages aux implications économiques majeures, notamment auprès du ministère de l’Économie et des Finances ?
La Grande Conversation
Il faut se souvenir du contexte. Pour le ministère de l’Économie cette initiative représentait davantage une menace pour les entreprises qu’une opportunité. Néanmoins, nous sommes parvenus à initier une dynamique. Je me suis attachée à fédérer les diverses initiatives émergentes que j’observais dans la société, qu’il s’agisse du secteur textile avec l’essor du « made in France », ou du domaine du réemploi. Bien que la consigne ne fût pas encore un sujet central, on percevait déjà une certaine réceptivité en France. Le marché de la seconde main, les ressourceries constituaient autant de mouvements embryonnaires. Ces éléments, qui paraissent aujourd’hui évidents, étaient alors balbutiants. Cela s’est accentué avec l’inflation et la montée en puissance des questions liées au pouvoir d’achat. Je me souviens avoir dû expliquer le concept d’économie circulaire auprès d’autres ministères.
Mon expérience de près de sept années en Asie m’a permis d’identifier trois enjeux majeurs : premièrement, la sous-optimisation de l’utilisation des ressources en Europe, alors même que celles-ci allaient devenir stratégiques sur les plans industriel et économique, soulevant ainsi un véritable enjeu de compétitivité pour l’économie française. Deuxièmement, la question de la souveraineté, particulièrement prégnante en Asie concernant les métaux rares, où se développait un discours quasi nationaliste sur la maîtrise des ressources. Troisièmement, ayant grandi dans le Vaucluse, territoire assez pauvre, j’ai rapidement compris que l’écologie ne pourrait prospérer sans création d’emplois. L’économie circulaire représentait la réponse à ces trois défis : souveraineté, industrialisation et emploi. En charge des négociations internationales sur l’environnement, cette perspective mondiale m’a convaincue de la nécessité de définir une voie médiane entre croissance et décroissance, précisément permise par l’économie circulaire.
La complexité intrinsèque du sujet explique en partie son délaissement antérieur. Il s’agissait d’opérer une transformation systémique globale et de créer des filières entières presque ex nihilo. Cette ampleur, conjuguée aux contraintes temporelles inhérentes à la fonction politique et à la nécessité d’une réforme fiscale – traditionnellement source de réticence politique – constituait un frein considérable.
Brune Poirson
L’économie circulaire propose un modèle économique en rupture avec le paradigme dominant actuel. Au-delà de la création de nouveaux mécanismes, elle implique une remise en question fondamentale du modèle existant. N’est-ce pas là que réside la principale difficulté ?
La Grande Conversation
C’est précisément pour cette raison qu’une vision stratégique affirmée s’imposait. L’interdiction de la destruction des invendus non alimentaires illustre parfaitement cette dimension structurante. Si cette pratique heurtait la sensibilité collective, particulièrement dans un contexte de précarité économique, elle appelait également une réponse systémique. La réorientation des produits invendus vers la redistribution ou le don s’inscrit dans une logique d’équité sociale. C’était une aspiration forte en France à l’issue de la crise des gilets jaunes. Ces mesures constituent les fondements d’un nouveau paradigme économique plus équitable. Il est à noter qu’à l’époque, la destruction des invendus demeurait une pratique méconnue du grand public. Notre démarche a consisté à appréhender l’ensemble des dimensions économiques, fiscales et politiques pour les intégrer dans un cadre législatif qui a d’ailleurs, fait remarquable, recueilli un consensus quasi unanime.
Brune Poirson
Vous avez mobilisé des soutiens externes, issus de la société civile, d’associations et d’organisations déjà investies dans ces problématiques. Avez-vous également recherché des appuis auprès d’autres formations politiques à l’Assemblée Nationale ? Quel a été l’apport du corps législatif dans l’élaboration de cette loi ?
La Grande Conversation
L’Assemblée Nationale a joué un rôle déterminant, d’autant plus crucial que le gouvernement soutenait peu ce projet de loi à l’époque. La programmation de la première lecture au Sénat, à la veille des élections sénatoriales, constituait une difficulté majeure. En effet, l’institution sénatoriale nourrissait l’ambition d’affaiblir le projet. Les sénateurs pensaient ménager ainsi les collectivités locales, au-delà de la seule question de la consigne. En réalité, les sénateurs n’avaient pas pris la mesure du fait que le projet de loi organisait un grand transfert des metteurs en marché vers les collectivités à travers les nouvelles REP. Les collectivités avaient beaucoup à y gagner ! Le Sénat se vivait dans l’opposition à l’époque. Et surtout, l’opposition des Sénateurs s’est cristallisée sur un malentendu, orchestré et alimenté par certains lobbies du recyclage qui n’ont pas hésité à utiliser des procédés particulièrement malhonnêtes.
Cette configuration a rendu impératif l’établissement d’alliances avec des députés partageant notre vision sociétale. Notre démarche s’est voulue résolument inclusive : toute contribution constructive était la bienvenue, indépendamment de son origine politique. Cette approche transpartisane a permis l’émergence d’un texte fédérateur. Si certains parlementaires, malgré leur adhésion sur le fond, se sont abstenus de voter le texte pour des considérations politiques, nous avons néanmoins pu établir un dialogue constructif et élaborer des propositions communes.
Brune Poirson
La promulgation d’une loi acquise, les véritables défis ne résident-ils pas dans son application concrète ?
La Grande Conversation
J’avais pleinement conscience qu’une loi, à l’instar d’une stratégie, ne prend son sens que dans sa mise en œuvre effective et sa capacité à transformer le réel. C’est dans cette optique que nous avions constitué en amont des groupes de travail par thématique (plastique, textile, alimentation…), afin de créer une dynamique porteuse. La situation actuelle est d’autant plus regrettable que nous observons un engagement croissant des Français en faveur de l’économie circulaire et l’émergence de nombreuses start-ups qui se trouvent aujourd’hui dans l’impasse, faute d’un accompagnement politique continu.
Cette situation illustre les limites de notre modèle politique, où la valorisation des actions des ministres précédent fait souvent défaut. On ne souhaite pas promouvoir le bilan de son prédécesseur ! Certaines mesures emblématiques ont néanmoins été reprises : Olivia Grégoire s’est saisie de l’interdiction de destruction des invendus, tandis que Bérangère Couillard s’est intéressée à la consigne. Toutefois, ces initiatives ponctuelles ne sauraient se substituer à un travail de fond englobant la réforme fiscale, l’élaboration des décrets d’application, l’animation des filières et le partage de la vision. Le travail post-législatif, moins visible mais essentiel, n’a pas bénéficié d’un portage politique suffisant. Cette vacance politique a créé un espace d’incertitude dont certains acteurs économiques ont pu tirer parti, au détriment d’une compréhension claire des enjeux tant par les acteurs économiques que par les citoyens.
Brune Poirson
La mise en œuvre de la loi et son suivi
Quel regard portez-vous aujourd’hui sur l’application de cette loi ?
La Grande Conversation
L’établissement d’un bilan objectif s’avère complexe en raison du caractère parcellaire et limité des données disponibles. Par ailleurs, nous n’avons que cinq ans de recul. Certaines dispositions demeurent inappliquées ou ont vu leur mise en œuvre différée. En outre, le recul temporel et les données empiriques font défaut. Si la loi établit un cadre général, elle ne s’accompagne pas systématiquement d’indicateurs de suivi ni d’objectifs quantifiables. Il convient de distinguer une loi d’un décret d’application. La réflexion approfondie sur les modalités de mise en œuvre, le séquençage et les méthodes d’évaluation n’ayant pas été menée à son terme, l’administration s’est trouvée dans l’impossibilité d’appréhender l’ensemble des aspects, a fortiori de les contrôler. De surcroît, nombre d’objectifs qualitatifs échappent à toute quantification.
Brune Poirson
La promulgation de la loi remontant à cinq ans, ce délai pourrait sembler insuffisant pour évaluer l’atteinte des objectifs. La question de l’échelle temporelle n’est-elle pas primordiale ?
La Grande Conversation
Un quinquennat constitue une période relativement brève pour ce type de problématique, d’autant plus dans des domaines où les données sont parfois lacunaires. La dimension culturelle, dont l’évolution s’inscrit nécessairement dans la durée, revêt une importance considérable. Néanmoins, la réitération et l’incarnation des principes demeurent essentielles. Les conditions politiques étaient réunies pour poursuivre la promotion de la transition d’une économie linéaire vers une économie circulaire, du tout-jetable vers le tout-réutilisable. Cette vision n’a pas bénéficié d’une promotion suffisante, à l’exception d’Elisabeth Borne, qui s’est attachée à promouvoir la loi, et qui avait un vrai engagement environnemental, malgré les contraintes inhérentes à sa fonction de Premier ministre.
La loi anti-gaspillage, axée sur l’amont, la réduction, le réemploi, la réparation et l’écoconception, ne peut être réduite à une série de mesures disparates. Il s’agit d’une narration continue qui n’a pas bénéficié d’un soutien suffisant, probablement en raison d’une vision transformative profonde de la société qui n’était pas unanimement partagée. Par ailleurs, les filières à responsabilité élargie des producteurs (REP), composante majeure de l’économie circulaire, nécessitent aujourd’hui une réforme substantielle de leur gouvernance. En l’absence d’un portage politique résolu à ce niveau, l’efficacité de la loi s’en trouve compromise, d’autant que la charge administrative induite est considérable.
Brune Poirson
L’argument principal avancé par Bercy concernait-il la perte de compétitivité pour certaines entreprises françaises, en raison du principe pollueur-payeur ?
La Grande Conversation
Cet argument figure effectivement parmi les plus significatifs. Cette problématique souligne l’importance d’exercer une influence au niveau européen, domaine dans lequel la France devrait maintenir son engagement. Je me suis impliquée autant que possible au niveau européen, en amont de l’élaboration des textes. Plus récemment, la légitimité de la France sur ces questions nous aurait permis d’exercer une influence plus importante encore, malgré des divergences de vision avec certains partenaires européens. Néanmoins, cela présuppose un investissement politique substantiel à l’échelon européen, investissement que la France ne consent pas toujours à la hauteur de ses capacités, notamment parce que l’engagement européen est parfois perçu comme politiquement peu rentable sur le plan national, éloigné des préoccupations médiatiques immédiates, sans compter la nécessité d’une pratique assidue de l’anglais !
Brune Poirson
Pourriez-vous nous éclairer sur votre démarche auprès de nos partenaires européens et sur la promotion de la vision française ?
La Grande Conversation
Mon action visait à mobiliser nos partenaires européens et à faire prévaloir la perspective française. Je ne suis pas certaine cette démarche a été menée à son terme. Il est donc impératif de poursuivre nos efforts pour préserver les avancées obtenues en France, lesquelles méritent d’être adoptées à l’échelon européen. Je pense notamment aux méthodologies élaborées par l’ADEME, fruit d’un travail de plus d’une décennie sur certains indices d’affichage environnemental. Cela doit être reconnu. Néanmoins, force est de constater que même porté politiquement au niveau européen, ce travail ne trouve pas toujours l’écho escompté.
Brune Poirson
On observe actuellement un phénomène de régression écologique en Europe, particulièrement manifeste dans les possibles reculs sur la mise en œuvre de la CSRD. Comment analysez-vous ce déclin généralisé des ambitions écologiques en Europe ?
La Grande Conversation
Il est vrai qu’un très mauvais vent souffle actuellement sur les questions environnementales en Europe. C’est aussi parce que nous rentrons dans le dur de la transition écologique. De nombreux objectifs qui paraissaient lointains, doivent devenir réalité. Il n’est pas toujours facile de l’expliquer aux citoyens, ni de résoudre certaines questions majeures, comme celles du financement de la transition écologique. Nous n’avons pas suffisamment anticipé collectivement, ni profité de crises, comme celles des gilets jaunes, pour repenser en profondeur certains systèmes, comme notre système fiscal par exemple. Se pose également la question plus vaste de l’instrumentalisation politique : s’opposer aux mesures environnementales, parfois en en exagérant les impacts négatifs, s’avère aujourd’hui politiquement rentable pour certains partis. Mais je pense qu’il est important de rappeler que les travaux sur l’économie circulaire s’inscrivent dans une temporalité longue.
Brune Poirson
Les collectivités territoriales et les acteurs ayant investi dans la valorisation des matières recyclées se trouvent désormais confrontés à une absence de débouchés. Aviez-vous anticipé une telle situation ? Quels ajustements préconisez-vous ?
La Grande Conversation
L’économie circulaire constitue, par essence, un nouveau paradigme économique, ce qui complexifiait l’anticipation de tous les effets collatéraux. Même en multipliant les évaluations et les scénarios, certains facteurs demeuraient imprévisibles, qu’il s’agisse des conditions économiques, des fluctuations des prix des matières premières ou des crises géopolitiques. Nous l’avions anticipé, avec des mesures qui visaient à lisser ces fluctuations et compenser de potentielles pertes pour soutenir la création de filières de recyclages viables. Mais il reste des défis importants. Cette complexité souligne l’importance capitale de maintenir l’économie circulaire comme priorité politique, permettant ainsi un dialogue constant avec les parties prenantes et des ajustements appropriés. Il s’agit, en quelque sorte, d’un engagement tacite : en promouvant l’économie circulaire et ses transformations profondes, il nous incombe d’accompagner les entreprises vertueuses, soit pour soutenir les acteurs fragilisés par cette transition, soit pour atténuer des effets secondaires préjudiciables.
Brune Poirson
Abordons la question du consommateur. Cette législation touche à des aspects très quotidiens de notre existence, tant comme citoyens que comme consommateurs. Quelle place avez-vous accordée aux consommateurs dans la conception, l’élaboration et les dispositions de cette loi ?
La Grande Conversation
Notre démarche s’est voulue délibérément éloignée de tout paternalisme ou moralisme. Nous avons évité le discours simpliste consistant à dire : « Il est vertueux de consommer de manière écologique ». Notre ambition était d’objectiver les enjeux et de fournir aux consommateurs une information pertinente, leur permettant ensuite de faire leurs choix et de prendre leurs responsabilités. L’accès à une information juste, transparente et fiable constituait un prérequis fondamental. Cela impliquait naturellement la possibilité de faire des choix éclairés en tant qu’individu responsable et informé.
Toutefois, cette dimension informative sur l’impact environnemental des produits ne suffit pas à elle seule. La compétitivité tarifaire demeure un enjeu crucial. C’est précisément pour cette raison que nous avons institué de nouvelles filières REP, avec pour objectif de rendre les produits les moins polluants plus compétitifs et abordables par rapport à leur équivalent moins vertueux. Il s’agissait de rééquilibrer la disparité avec les produits ou les entreprises commercialisant des biens plus respectueux de l’environnement ou obtenant un meilleur score en termes d’affichage environnemental.
Brune Poirson
L’inflation et les préoccupations liées au pouvoir d’achat semblent avoir réorienté les priorités des consommateurs.
La Grande Conversation
Il est impératif de maintenir une vigilance constante sur cet écosystème. Je me permets d’insister : il faut cultiver inlassablement ce terrain de l’économie circulaire. L’économie du XXe siècle tend à reprendre rapidement ses droits, comme nous l’avons constaté durant la crise sanitaire, où un mouvement d’opposition au vrac s’est manifesté dans les grandes surfaces, s’appuyant sur des études scientifiquement contestables. Cet exemple illustre parfaitement comment le moindre relâchement permet aux pratiques obsolètes de se réinstaller, soutenues par des actions de lobbying intensives.
Certains secteurs, comme celui de la mode, ont initialement manifesté une forte résistance avant de comprendre l’évolution des mentalités. Lorsque nous avons entamé les discussions sur la conception de chaînes de production de vêtements plus durables et recyclables, nous avons été accusés de menacer l’économie de la mode française. Le luxe, notamment, arguait que l’économie circulaire compromettrait leur modèle économique en favorisant le marché noir et en sapant le principe de rareté sur lequel repose leur industrie. Ces oppositions ont été particulièrement virulentes. Aujourd’hui, ces acteurs font partie des soutiens forts à l’économie circulaire, qu’ils mettent en place concrètement.
Brune Poirson
Comment situez-vous la France par rapport à ses voisins européens ? Existe-t-il des pays particulièrement performants dont nous pourrions nous inspirer ?
La Grande Conversation
De manière générale, notre performance reste perfectible. La comparaison entre pays européens s’avère délicate en l’absence d’indicateurs harmonisés. La définition même du recyclage varie selon les pays, certains incluant avant entrée en centre de tri donc comprenant des flux ensuite envoyés vers l’incinération dans leurs statistiques. Cette hétérogénéité rend difficile tout positionnement précis de la France, sujet à contestation permanente. Néanmoins, un constat s’impose : notre production de déchets ne diminue pas, phénomène également observable à l’échelle européenne. Nous accusons un retard significatif sur plusieurs objectifs, notamment le tri des biodéchets à la source, la gestion des déchets en entreprise, et la mise en place de la consigne.
Brune Poirson
La loi portait la promesse d’une réduction de la production de biens de consommation. Les résultats sont-ils au rendez-vous ?
La Grande Conversation
Force est de constater que non. C’est précisément pour cette raison que nombre de solutions doivent être envisagées à l’échelle européenne, d’où l’importance cruciale de promouvoir activement la loi au niveau communautaire. La France a indéniablement inspiré l’Europe, comme en témoignent diverses mesures comme l’indice de durabilité qui n’auraient pas vu le jour sans la loi anti-gaspillage. Néanmoins, une volonté européenne plus affirmée s’impose pour réduire la production et repenser notre système productif. La transition vers un nouveau pacte productif s’avère inéluctable, ne serait-ce que pour la récupération des métaux rares. Il est impératif de développer de véritables filières de recyclage au-delà du seul plastique.
Brune Poirson
Quel regard portez-vous sur l’adoption définitive du règlement européen sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR), dont l’entrée en vigueur est prévue en 2026 ?
La Grande Conversation
Dans ses grandes lignes, cette législation s’oriente dans la bonne direction. Toutefois, une analyse détaillée, mesure par mesure, s’impose, particulièrement concernant les aspects méthodologiques. Prenons l’exemple de l’indice de réparabilité des smartphones : les exigences européennes s’avèrent nettement moins ambitieuses que celles développées en France. C’est précisément sur ces points que l’engagement français doit se manifester, tant au niveau politique que technique. Je crains que la France ne soit pas suffisamment offensive sur ces questions. Nous risquons d’aboutir à une réglementation apparemment ambitieuse sur le papier mais qui, dans les faits, pourrait pénaliser la France malgré notre avance initiale.
Brune Poirson
C’est un phénomène similaire à celui observé avec le Nutri-score et l’influence des lobbies. Les avancées significatives demeurent complexes.
La Grande Conversation
Il ne faut en aucun cas sous-estimer la puissance des lobbies, particulièrement à l’échelon européen, émanant d’entreprises en situation de rente, peu enclines au changement. Nous nous heurtons à des systèmes établis de longue date qui, bien qu’inefficients globalement, servent parfaitement les intérêts particuliers de leurs acteurs. Les filières de tri pour recyclage, par exemple, constituent parfois un frein au changement car elles reposent sur les volumes de déchets qu’elles collectent, au détriment des logique de prévention. Une volonté politique forte s’impose, accompagnée d’une détermination à mener les réformes jusqu’à leur terme.
Brune Poirson
La multiplicité des acteurs concernés et les effets en cascade engendrent inévitablement des oppositions qui peuvent s’unifier.
La Grande Conversation
Exactement. C’est la raison pour laquelle j’insiste depuis le début de notre entretien sur l’importance du portage politique et de la vision. Cette loi représentait, et représente toujours, un véritable combat. Notre ambition était de faire entrer l’économie dans le XXIe siècle, avec des implications dans tous les secteurs. Les ramifications de la loi sont considérables. C’est pourquoi nous avons mené ce travail durant plus de trois ans, et engagé de longue date par certains pans de l’administration publique, organisant plus d’une centaine de réunions de concertation sur un même sujet. Nous avons réuni tous les secteurs, individuellement puis collectivement. Nous avons mobilisé les députés dans une démarche totalement dédiée. Il s’agit véritablement d’un combat, d’une vision à porter. La création de coalitions d’entreprises et d’organisations de la société civile s’est révélée nécessaire pour contrebalancer les acteurs attachés à leurs rentes.
Brune Poirson
Certains objectifs ont néanmoins été atteints, notamment celui fixé par Ségolène Royal de réduire de moitié le taux d’enfouissement d’ici 2025.
La Grande Conversation
Effectivement, cet objectif est issu de la LTECV. La difficulté était justement qu’il se limitait aux déchets envoyés en élimination et ne portait alors pas de vision plus globale sur les dynamiques d’économie circulaire. La loi anti-gaspillage dépassait cette simple limite, historique d’une économie linéaire. Nous avons créé un nouvel écosystème économique autour de l’économie circulaire, notamment avec l’émergence de nombreuses start-ups. Certaines d’entre elles déplorent aujourd’hui la lenteur de la mise en œuvre législative, et malheureusement, quelques-unes ne survivent pas, ce qui est particulièrement regrettable.
Brune Poirson
Certaines start-ups spécialisées dans la récupération de matière entrent en concurrence directe avec les acteurs historiques, créant des tensions imprévues.
La Grande Conversation
J’avais identifié et assumé cette problématique. Un des objectifs de la loi était de transformer l’économie au-delà du seul secteur de l’économie sociale et solidaire. Idéalement, toute l’économie devrait devenir sociale et solidaire. Cependant, la création d’entreprises économiquement rentables s’avère également nécessaire. C’est ainsi que nous démontrons la viabilité d’un secteur et que nous sortons l’économie circulaire d’un cercle restreint. Je précise cela que la dimension d’insertion sociale doit demeurer absolument cruciale en France, peut-être plus encore aujourd’hui qu’à l’époque de la loi, compte tenu du pouvoir d’achat, de l’inflation et de la pauvreté suite au covid. L’enjeu est de créer un espace pour tous les acteurs. Cette dimension a été pleinement assumée : il ne s’agit pas d’une loi sur l’économie sociale et solidaire, mais d’une loi sur l’économie circulaire. L’émergence d’entreprises importantes fondées sur la réutilisation ou le recyclage, développant de véritables filières économiques, constitue également un gage de succès. C’est une orientation assumée.
Brune Poirson