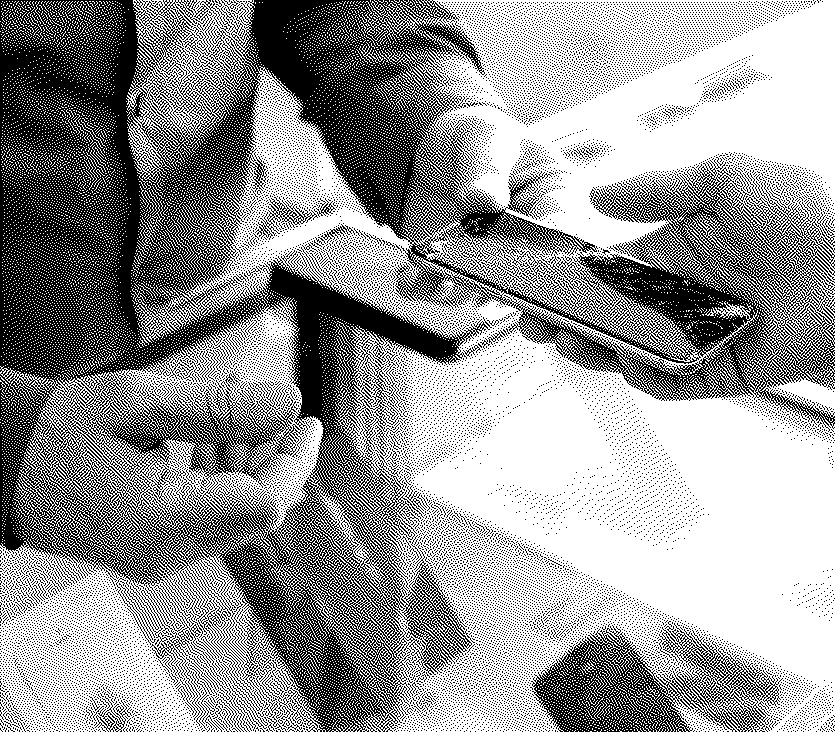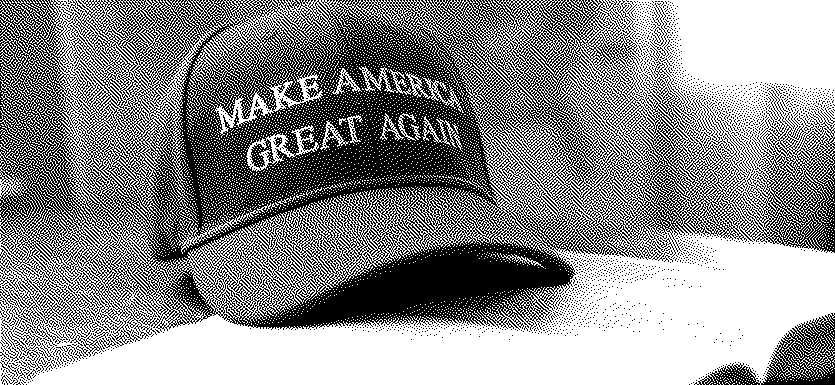Introduction : L’effondrement de la culture de la réparation en France
Selon la dernière publication des chiffres du CGDD, la part de la réparation dans la consommation de biens domestiques a dramatiquement chuté ces dernières décennies : de 1990 à 2022, on passe de 33% à 19% pour le matériel IT, de 5% à 3% pour les vêtements et chaussures, de 9.2% à 6.9% pour les meubles, et encore pire de 20% à 8% pour les appareils ménagers, et de 33% à 17% pour les biens culturels. Seuls les véhicules tirent leur épingle du jeu avec une légère augmentation de 44% à 52%.
Cela signifie que la consommation en biens domestiques des ménages français se caractérise par des achats toujours plus importants de nouveaux biens qui consomment des ressources et génèrent des émissions de CO2 pour leur fabrication, leur transport et leur distribution.
Or privilégier l’entretien et la réparation au renouvellement permet de prolonger la durée d’usage des produits et donc de limiter leur remplacement, consommateur de ressources.
Si l’ADEME estime que 36 % des Français réparent ou font réparer leurs produits quand ils tombent en panne, le Gouvernement a pour objectif, via la loi AGEC, de faire passer ce taux à 60 % d’ici cette année.
Comment ? Essentiellement via le bonus réparation. Zoom sur un dispositif pertinent mais qui doit être mis en œuvre de manière beaucoup plus ambitieuse si l’on souhaite qu’il tienne toutes ses promesses !
Le bonus réparation : une très bonne idée pour tirer la demande, mais qui peine à tenir toutes ses promesses pour rebooster la réparation en France
Le Fonds réparation, mis en place dans le cadre de la loi AGEC en février 2020, souffre d’un déploiement trop lent et d’une complexité dans sa mise en œuvre qui décourage beaucoup de réparateurs à entrer dans le dispositif.
5 ans après le vote de la loi AGEC, le bonus n’est effectif que depuis 2 ans (3 ans ayant été consacrés à sa préfiguration !), et moins de 20% de l’enveloppe prévue à date n’a été effectivement décaissée. Cela s’explique par deux raisons principales :
- Le « bonus réparation » souffre encore d’un manque de notoriété. Malgré plusieurs campagnes de communication lancées à la radio en 2024, les retours de terrain montrent que cette initiative a eu peu d’impact sur la demande de réparations. Plusieurs professionnels de la réparation proposent de mettre en place une campagne collective mutualisée, à l’image des campagnes pour les produits laitiers, pour sensibiliser efficacement le public et promouvoir le bonus. Ils appellent également à une simplification du message et à une meilleure communication, notamment en utilisant des canaux à large portée comme la télévision.
- Malgré quelques simplifications récentes, un dispositif encore trop complexe et coûteux pour la profession, qui hésite à entrer ou rester dans le dispositif : le processus de labellisation QualiRepar pour les professionnels (nécessaire pour proposer le bonus réparation aux clients) est souvent décourageant, comme le souligne une étude de l’ONG HOP, qui pointe que 80% des réparateurs non labellisés ne souhaitent pas le devenir. L’alourdissement de la charge administrative pour gérer les demandes de remboursement (parfois auprès de 2 organismes distincts !) est souvent rédhibitoire, comparé à la hausse espérée de la clientèle.
En résumé, il est urgent de simplifier le bonus réparation : à la fois pour inciter les professionnels à entrer (ou rester) dans le dispositif, mais également à simplifier les montants incitatifs des bonus proposés aux Français (montant unique pour toute une catégorie de produits – ex : tous les produits IT à 60€, tous les produits électroménagers à 50€). Il est également primordial de communiquer très largement et de manière répétée à la TV sur l’existence de ces bonus pour convaincre toujours plus de Français à faire réparer, plutôt que d’acheter neuf. Et il reste encore beaucoup d’argent dans le Fonds réparation pour financer cela, pourquoi s’en priver ?
Sans mesure complémentaire pour structurer l’offre, le bonus à lui seul ne pourra pas généraliser la culture de la réparation en France
Point de réparations sans réparateur !
L’impact du Fonds réparation sera nécessairement limité si la structuration de l’offre de réparation ne va pas de pair avec l’essor de la demande en réparation des Français.
Or aujourd’hui, la profession est en crise pour deux principales raisons qui grèvent son attractivité :
- Manque de recrutements/formations face à l’augmentation anticipée de la demande des français
- Manque de rentabilité
Sur le manque de formations – exemple des réparateurs de gros électroménagers :
Le GIFAM estime que tous besoins cumulés, ce sont près de 3000 techniciens qui doivent être formés d’ici 2027, soit 1000 / an, pour répondre à la demande croissante (et qui va continuer de croître) des Français pour la réparation et pour renouveler les départs en retraite.
Pour soutenir l’objectif, le gouvernement a décidé en 2023 de consacrer une partie du Fonds réparation au soutien aux formations de réparateurs, à hauteur de 5 millions € / an sur 3 ans. Or, le coût de formation pour un réparateur de gros électroménager est considérable : environ 47 000€ / formé diplômé.
Si l’enveloppe d’amorçage vient alléger la moitié du reste à charge employeur (soit 23.5k€), les 5 millions € viendraient financer la formation de 212 techniciens supplémentaires / an, soit 636 techniciens sur les 3 ans, soit 4 à 5 fois moins que les 3000 techniciens que le GIFAM estime nécessaire pour relever le défi de la réparation sur notre seule filière du gros électroménager !
Pour relever le défi des 3000 nouveaux réparateurs, l’enveloppe doit donc être multipliée par 5, passant de 5 à 25 millions d’euros par an (soit 75M€ au bout des 3 ans).
Encore une fois, compte tenu du fait que l’enveloppe du Fonds réparation n’est décaissée qu’à hauteur de 20% de ce qui est budgété, pourquoi priver la formation de soutien accru, puisqu’il s’agit de la clé de la réussite du dispositif !
Sur le manque de rentabilité – l’épineuse question de la TVA réduite dans un contexte budgétaire plus que tendu
Les comptes des entreprises sont publics1. Tout un chacun qui irait vérifier la rentabilité des entreprises de réparation, pourrait s’apercevoir des équilibres financiers de plus en plus précaires de la profession. Les marges sont faibles (et parfois inexistantes). Le secteur de la réparation est confronté à un problème de modèle économique qui peine à être compétitif au regard de la baisse des prix des produits neufs d’une part, du coût important et grandissant de la main d’œuvre et d’une absence de gain de productivité d’autre part (compte tenu de produits de plus en plus complexes, encore très peu éco-conçus).
Le rapport TVA circulaire d’Emmanuelle Ledoux2 et Emery Jacquillat remis au Ministre C. Béchu, et le guide de HOP sur la fiscalité circulaire3 plaident tous les deux pour une TVA réduite à 5.5% pour les réparations.
“Sans cette fondation solide que constitue la TVA circulaire, les autres mesures mises en œuvre comme le bonus réparation et l’indice de réparabilité n’auront qu’un impact superficiel sur l’activité économique des réparateurs. Pire encore, leurs effets pervers accélèreraient la disparition des réparateurs de proximité.”
Loin de promettre des effets de baisse sur les prix, le secteur de la réparation affiche son objectif : la TVA circulaire abaissée à 5.5% sur les services de réparation permettrait de structurer des offres compétitives dans le secteur de la réparation en agissant surtout sur l’offre. Notamment en améliorant la rentabilité de modèles économiques des réparateurs.
De manière simple et immédiate, les marges dégagées iront pour partie dans la soutenabilité du modèle économique des activités de réparation et dans la revalorisation des salaires renforçant ainsi l’attractivité du métier.
L’Institut National de l’Économie Circulaire et le député Stéphane Delautrette sont aujourd’hui même à la manœuvre pour défendre un amendement au Projet de Loi de Finances pour faire accepter cette baisse de TVA, qui a peu de chances de passer, compte tenu de la doctrine politique actuelle, souvent jusqu’au-boutiste et irrationnelle sur les baisses de recettes de l’Etat. Le rapport d’Emmanuelle Ledoux démontre pourtant très clairement qu’après une baisse à court terme des recettes liée à cette TVA réduite, l’augmentation de volume de l’activité viendrait compenser ces pertes à moyen terme, voire générer des recettes supplémentaires à long terme pour l’Etat.
Pour conclure, il convient de souligner la nécessité de considérer le bonus réparation dans une approche systémique, intégrant la réparation comme un élément central d’une nouvelle culture de consommation responsable et durable. Au-delà de l’incitation financière, il s’agit de repenser un modèle où la réparation devient un réflexe aussi naturel que l’achat de neuf. Cela ne se fera pas sans un véritable écosystème de soutiens structurels, en particulier une TVA réduite, la formation des professionnels et une simplification du dispositif “bonus” en lui-même. À l’heure où le dérèglement climatique et la gestion des ressources deviennent des priorités mondiales, l’urgence est là : transformer le secteur de la réparation n’est pas seulement une question de choix économique, mais de responsabilité collective. Cette transition ne sera possible que si l’ensemble des acteurs, des consommateurs aux pouvoirs publics, s’engagent pleinement à reconstruire cette culture de la réparation. Et si la France parvient à relever ce défi, elle pourrait devenir un modèle à suivre dans la réinvention d’un mode de consommation plus respectueux de la planète et des générations futures.