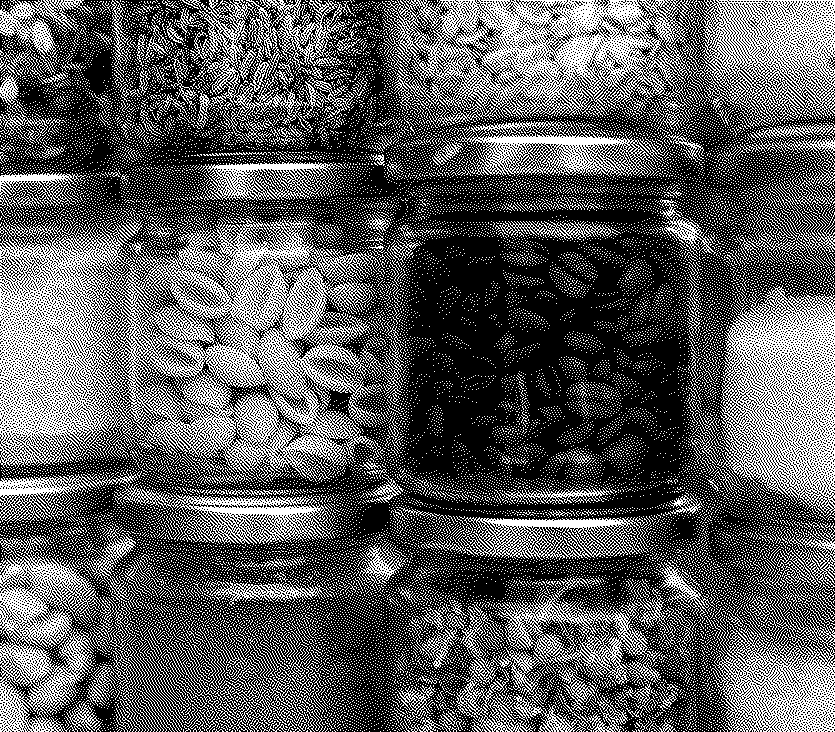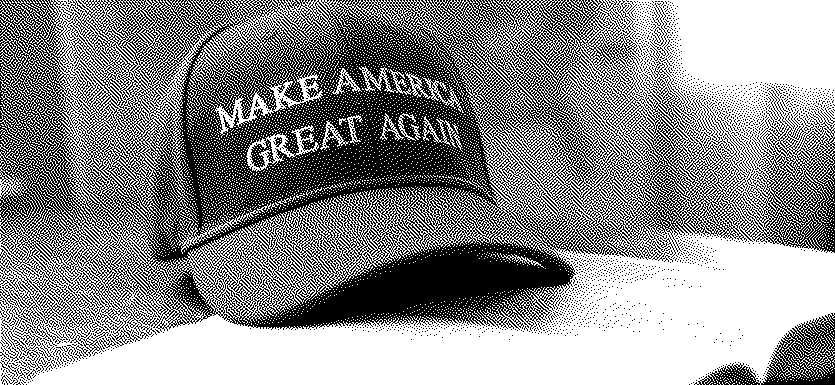Introduction
Votée en 2020, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) est un texte précurseur, ambitieux et fondamentalement nécessaire pour enclencher un changement collectif et profond des modèles de production et de consommation vers une économie vertueuse. Elle accorde d’ailleurs une place de choix au réemploi, atout fort et incontournable de cette transformation.
5 ans après sa promulgation, la loi AGEC reste un outil particulièrement structurant. Elle est à l’origine d’un véritable bouleversement des mentalités, qui a permis de mettre la France sur la voie d’un changement de paradigme en faveur de l’économie circulaire. Pour autant, plusieurs dispositions de la loi restent peu, voire pas, appliquées, et dans de nombreux secteurs, les objectifs quantitatifs sont loin d’être atteints.
Plusieurs raisons conjoncturelles et structurelles peuvent expliquer ce retard à l’allumage : un contexte politique instable, un système économique encore trop favorable aux modèles linéaires et un cadre légal encore imparfait.
Un apport nécessaire pour enclencher le changement
L’ambition de la loi AGEC est de transformer notre modèle de production et de consommation en un modèle circulaire, efficient et respectueux de l’environnement. Elle contient ainsi de nombreuses mesures permettant d’engager cette transition.
Avant tout, elle renforce la responsabilité des producteurs avec :
- la mise en place de nouvelles filières Responsabilité Élargie du Producteur (REP) pour plusieurs produits, notamment les déchets du secteur du bâtiment ou encore les déchets d’emballages professionnels ;
- la création d’un système de bonus-malus pour encourager l’utilisation de produits plus vertueux sur le plan environnemental et faciliter leur réemploi ;
- le lancement de fonds dédiés à la réparation (« bonus réparation ») et au réemploi et à la réutilisation, au sein des filières REP ou en fléchant pour les filières REP Emballages au moins 5% du budget des éco-organismes vers le développement de solution de réemploi ;
- la lutte contre l’obsolescence programmée grâce à la disponibilité des pièces détachées et à l’affichage environnemental.
Ensuite, la loi renforce la lutte contre la pollution des plastiques en instaurant un objectif ambitieux de fin de mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique d’ici 2040. Parallèlement à cela, elle prévoit une réduction de l’utilisation du plastique au quotidien, par un certain nombre de mesures d’interdiction des plastiques à usage unique imposées aux secteurs de la restauration ou de la commande publique, mais aussi via le déploiement de la vente de produits en vrac auxquels la loi donne pour la première fois une définition officielle.
Enfin, concernant le secteur spécifique des emballages, la loi AGEC introduit, de façon inédite, une obligation pour les producteurs de mettre en marché au moins 10% d’emballages réemployés d’ici 2027.
Si en 5 ans, la loi AGEC reste structurante et a permis de mettre la France sur la voie d’un changement de paradigme en faveur de l’économie circulaire, plusieurs dispositions restent peu, voire pas, appliquées, et ne font pas l’objet de mesures de suivi ou de contrôle. Il ressort, par exemple, des premiers chiffres du réemploi publiés par l’Observatoire du Réemploi pour l’année 2023, que le taux global de réemploi des emballages est de 2,2% et qu’il chute à 1,1% pour les seuls emballages ménagers. Le niveau légal de 5% de réemploi pour chaque catégorie d’emballages imposé d’ici 2027 est donc loin d’être atteint. Un autre exemple concernant l’interdiction de la vaisselle jetable dans la restauration depuis le 1er janvier 2023 : d’après le plan de suivi de la DGPR, à mi-novembre 2023, 38 % des établissements contrôlés ne respectaient pas la règlementation.
Deux écueils à souligner : l’application de la loi AGEC reste encore trop focalisée sur l’économie linéaire, au détriment d’une approche globale de l’économie circulaire, et se heurte également à l’absence de contrôle de la performance environnementale des filières REP, dont la gouvernance doit être repensée.
Changer de focale : du court terme au long terme
Les changements imposés par la loi AGEC doivent reposer sur le temps long. Ils imposent d’engager des actions de transformations profondes, structurelles et inédites des systèmes de production et de consommation. Et celles-ci sont rendues possible par la reconnaissance et la consécration d’un cadre légal propice au développement du réemploi dans différents secteurs : on parle de Reuse Economy.
La Reuse Economy consiste à maximiser la durée de vie des produits en favorisant leur usage multiple, plutôt que leur usage unique, leur réemploi plutôt que leur destruction ou leur recyclage immédiat.
Elle repose sur un triptyque de bon sens : conception d’un produit pour l’usage multiple, action de retour ou de collecte, remise en état (lavage, reconditionnement ou réparation). En cela, elle bouleverse les systèmes actuellement mis en place, et inscrit leur fonctionnement dans le temps long. Or depuis plusieurs années, notre société s’est accélérée et a basculé dans le temps court. De telles conditions rendent difficile voire impossible le pivotement des modèles, malgré des bases légales solides jetées tant au niveau national qu’européen.
Une instabilité politique chronique
Les changements multiples à la tête de l’État depuis 5 ans ont plongé les entreprises dans l’immobilisme plutôt que dans l’action collective. Si dans le monde du réemploi des emballages, des expérimentations ont tout même réussi à démarrer, aucun déploiement massif n’a suivi. C’est le cas du secteur des fast-food : en 2023 et 2024, des amendes et des rappels à la loi ont été délivrés aux restaurants qui n’étaient pas en conformité. Ces retards ont contribué à pénaliser tout un écosystème de start-up, qui se sont lancées pour accompagner la transition des restaurants vers la vaisselle réemployable. Ainsi en 2024 la société Pyxo, spécialisée dans la location-gestion d’emballages alimentaires et de vaisselle réemployable a été placée en redressement judiciaire. Elle dit avoir fait « les frais des lenteurs de la mise en application de la loi Agec » faute de volonté politique pour obliger les restaurants à appliquer la loi 1.
Pour investir dans la transition écologique, le monde économique a besoin de gouvernants engagés pour le changement, de visibilité et de stabilité politique. Or, basculer vers des modèles de réemploi implique de modifier de manière conséquente les outils de production et les chaînes logistiques actuels, et donc d’investir. À titre d’exemple, lorsqu’une entreprise installe une nouvelle ligne de conditionnement, celle-ci coûte plusieurs millions d’euros et son investissement est planifié pour près de 20 an environ. En période d’instabilité politique, les promesses lancées par un gouvernement peuvent ne jamais voir le jour comme ce fut le cas en juin 2023. Bérangère Couillard, alors Secrétaire d’État, avait ainsi annoncé, après 6 mois de concertation dans le cadre de la loi AGEC, la généralisation de la consigne pour réemploi des emballages en verre. Quelques semaines après sa déclaration, le gouvernement fut remanié. Les professionnels du secteur attendent encore la mise en œuvre effective de son annonce.
Si aucun indice ne nous permet à ce jour de conjecturer quant à la stabilité du gouvernement en place, il nous faut espérer que la nouvelle équipe reprenne rapidement en main le chantier de l’économie circulaire. Il est nécessaire que les ministères de la Transition écologique et de l’Économie portent conjointement, avec courage, ambition et sans relâche, ces sujets cruciaux pour relancer le marché.
Fast-consommation
L’accélération de la vie marchande a modifié les comportements d’achat désormais focalisés sur le renouvellement permanent et rapide des produits, plutôt que sur l’investissement dans des biens et produits conçus pour durer.
L’augmentation de la performance des outils industriels, l’innovation, le marketing et l’internationalisation des échanges commerciaux notamment ont accéléré et généralisé l’obsolescence de style des biens manufacturés mis sur le marché. L’obsolescence de style permet d’accroître la rotation des produits en augmentant leur fréquence d’achat. Elle vise à rendre obsolète un produit que l’on vient tout juste de vendre pour attirer le regard du client vers la prochaine collection 2. Les biens sont désormais produits en grande quantité, faisant baisser leur coût mais aussi leur qualité de manière à être remplacés plus fréquemment.
Un phénomène qui a modifié les comportements d’achat à deux niveaux :
- Les consommateurs n’achètent plus en pensant au prix étalé sur toute la durée d’utilisation du bien, mais au prix le plus bas possible à l’instant T ;
- Les consommateurs ne sont plus habitués à rapporter les produits pour les remettre en état (lavage des emballages, réparation d’un vêtement ou d’un appareil électrique …)
Autrefois on achetait un bien pour qu’il dure. On pensait à son coût total, sur toute la durée d’utilisation, réparation comprise. On était donc prêt à consacrer « un peu plus au départ », pour acheter un bien robuste et de qualité, car on savait qu’il allait durer. Aujourd’hui, en ne se fondant que sur le prix comme déterminant du choix au moment de l’acte d’achat, le consommateur opte pour des produits moins chers, et, bien souvent, de moins bonne qualité. Des produits qui ne peuvent être réemployés ou réparés. Deux années après la promulgation de la loi AGEC, une étude Kantar le révélait déjà : plus des deux tiers des vêtements neufs vendus sont des produits d’entrée de gamme ce qui représente un défi pour la recyclabilité et la réparabilité. « Les prix toujours plus attractifs séduisent une majorité des Français, qui reviennent acheter fréquemment. Cette tendance a pour conséquence une perte de repères sur la valeur des produits et des référentiels de prix très (trop) bas, non sans un impact économique, social et environnemental. »3
Autre effet collatéral de l’obsolescence de style : la perte du geste « retour » par le consommateur. Il n’y a pas si longtemps, les bouteilles de lait ou de vin étaient consignées et une fois vides, rapportées auprès des commerçants. On récupérait alors l’argent de la consigne. Les bouteilles étaient ensuite nettoyées pour être réemployées, et de nombreuses fois. De même, nous avions l’habitude de confier nos chaussures à un cordonnier, nos vêtements à un couturier ou nos appareils électriques à un réparateur, qui les remettaient en état. Ce geste s’est perdu au fil du temps. Et pour preuve, on comptait 45 000 cordonniers dans les années 50, il y en a 3 500 aujourd’hui alors que quelques 250 000 000 de paires de chaussures sont vendues tous les ans ! 4
Réinscrire dans notre quotidien et nos habitudes cette mutation fondamentale des comportements de consommation va nécessiter du temps et le déploiement de véritables politiques de consommation. Le consommateur, seul, ne changera pas son comportement ; ses pratiques dépendent de décisions, bien souvent prises en amont, sur lesquels il a peu de prise 5.
Changer les règles du jeu pour installer durablement une Reuse Economy
La France, comme l’Union européenne, se sont dotés de textes législatifs structurants qui posent un cadre et des objectifs favorables au développement de l’économie circulaire : régime des REP, loi AGEC, loi Climat et Résilience en France ; Green Deal, PPWR, Règlement européen sur l’Écoconception des Produits Durables, Directive Droit à la Réparation au niveau européen. Malgré ces textes, les conditions ne sont toujours pas réunies pour accélérer le changement vers des modèles de production et des habitudes de consommation qui permettent de réduire les déchets et de préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat.
En 2024, les députés Véronique Riotton (Renaissance, Haute-Savoie) et Stéphane Delautrette (Groupe Socialiste, Haute-Vienne) ont travaillé sur l’évaluation de l’impact de la Loi AGEC. Le 29 mai 2024, leur rapport d’information de la mission a été publié. Il comporte 100 propositions, orientées autour de 14 axes de travail. Dans le cas du réemploi, on note 4 axes clés :
Axe n° 2 : Réduire les emballages en plastique à usage unique
Axe n° 3 : Faire du réemploi une priorité
Axe n° 7 : Revoir la gouvernance des filières REP
Axe n° 8 : Renforcer le suivi et le contrôle des filières REP
Les propositions balaient toutes les composantes structurelles du système actuel qui doivent évoluer et complète les articles actuels de la loi pour atteindre le but initial de la loi AGEC : transformer, en profondeur, nos modèles de production et de consommation.
Le rapport insiste sur la nécessité d’accompagner la transformation des modèles opérationnels des entreprises pour permettre le déploiement à grande échelle du réemploi.
Proposition n° 22 : Adapter les modes de production et la logistique des entreprises du secteur des emballages afin de permettre le déploiement massif du réemploi dans tous les territoires :
– en poursuivant la réflexion autour de la définition de standards d’emballages réemployables ou de spécifications techniques communes ;
– en adaptant les lignes de production au conditionnement et au reconditionnement de ces emballages standardisés ;
– en mettant en place des lieux de collecte, des centres de tri, de lavage et de stockage des emballages.
Le rapport constate l’impératif attaché à l’augmentation des moyens financiers alloués aux nouveaux modèles de réemploi.
Proposition n° 30 : Doubler les ressources du fonds dédié́ au financement du réemploi et de la réutilisation pour les porter au minimum à 10 % du montant des contributions reçues
Le rapport identifie aussi des pistes relatives à la promotion des nouveaux acteurs impliqués dans l’accompagnement au changement des comportements de consommation.
Proposition n° 19 : Au titre de leur action de prévention et de réduction des déchets d’emballages, prévoir un soutien dédié des éco-organismes de la filière REP des emballages ménagers à la promotion de la vente en vrac, indépendamment des actions de soutien au réemploi.
Le rapport pointe également la nécessité de mettre en place des contrôles et des sanctions dissuasives en cas de non-respect des obligations de réemploi, qu’elles soient imposées directement aux producteurs, ou indirectement par l’intermédiaire de leur éco-organisme. On les retrouve par exemple dans les propositions 59 et 60 :
Proposition n° 59 : Mettre en place une instance indépendante de contrôle et de régulation des filières REP en charge notamment :
– de contrôler l’atteinte des objectifs par les éco-organismes et les systèmes individuels, définis dans les cahiers des charges des filières REP ;
– de prononcer les sanctions en cas de manquement d’un éco- organisme ou d’un système individuel aux obligations prévues par son cahier des charges ;
– d’accompagner les éco-organismes dans la lutte contre les « passagers clandestins », et prononcer les sanctions associées ;
– d’accompagner les parties prenantes des filières REP vers la résolution d’éventuels litiges.
Proposition n° 60 : Renforcer les effectifs pour le suivi, le contrôle et la régulation des filières REP au sein des services des ministères compétents (DGPR, DGE et DGCCRF) et de leurs services déconcentrés.
À chacune des 100 propositions, les députés ont associé des véhicules législatifs ou règlementaires mobilisables pour les faire aboutir (décrets, arrêtés, lois françaises ou européennes, cahiers des charges des filières REP).
La même année, le 18 juillet 2024 est paru un autre rapport, celui de la mission d’inspection sur les filières REP, dont l’objectif était d’analyser le fonctionnement et la régulation des filières REP, ainsi que le fonctionnement des éco-organismes en eux-mêmes6. Le rapport part du constat que les conditions ne sont aujourd’hui pas réunies pour garantir l’atteinte des objectifs : le pilotage des filières REP par les pouvoirs publics présente des défaillances qui ne peuvent être rectifiées à cadre institutionnel constant et le système d’incitations destiné aux différentes parties prenantes des REP est en partie mal orienté. Forts de ces constats, le rapport conjoint de l’inspection générale des finances (IGF), de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) et du Conseil général de l’économie (CGE) relatif aux performances et à la gouvernance des filières REP formule dix propositions articulées autour des trois piliers suivants :
- la création d’une instance indépendante de pilotage et de régulation des filières REP, en charge de gérer notamment les équilibres concurrentiels, les différends et le dispositif de contrôle et de sanction ;
- le renforcement des outils de pilotage à la main de l’instance de régulation et de l’administration centrale ;
- l’amélioration du système d’incitations, notamment en direction des metteurs en marché, des éco-organismes et des collectivités locales.
Ce rapport renforce certaines propositions de la mission conduite par les députés Delautrette et Riotton et fait clairement état des changements structurels nécessaires à apporter au cadre actuel pour permettre d’atteindre les objectifs fixés par la loi.
Ces changements contribueront en partie à résoudre un autre défi majeur : rendre les nouveaux modèles économiques de la Reuse Economy compétitifs et rentables.
En ruptureavec les modèles de l’économie linéaire – extraire, produire, consommer, jeter – les modèles circulaires de la Reuse Economy reposent sur un triptyque de bon sens : conception d’un produit pour l’usage multiple, action de retour ou de collecte, remise en état (lavage, reconditionnement ou réparation). Ils impliquent des modifications profondes des chaînes de valeurs (outils de production, de conditionnement, logistique…) et ajoutent des maillons à la chaîne, impactant la structure de coûts.
Si certaines industries ont depuis longtemps su intégrer le réemploi dans leurs modèles en B2B (business to business) : industrie automobile, palettes, cagettes en plastique de fruits et légumes, ou boissons consignées dans l’hôtellerie-restauration ; l‘implémentation du réemploi dans les activités des entreprises qui n’en font pas encore ne relève pas de l’évidence.
Tout d’abord, le réemploi entraine des coûts supplémentaires d’investissement : achat de nouveaux outils et de nouvelles machines, modification de lignes industrielles… À ces coûts s’ajoutent la masse salariale ou encore le paiement des sous-traitants nécessaires à l’accomplissement des tâches spécifiques aux boucles de réemploi (collecter, trier, réparer).
Par voie de conséquence, l’ensemble de ces coûts sont répercutés sur le prix de vente des marchandises. À date, ces prix sont en moyenne plus élevés que ceux des produits non réemployables ou réparables. Et c’est bien là tout le problème.
« C’est donc un autre impératif : la réparabilité des produits. Sauf que réparer un produit d’entrée de gamme coûte plus cher qu’en acheter un neuf. Pour un vêtement, un produit neuf coûte en moyenne 12,50 euros … et le coût moyen d’une réparation est de 20 euros, avancent Kantar et Refashion. Avec 70% de produits d’entrée de gamme dans les ventes, comment développer la réparabilité ? 7 »
Et ce déséquilibre de prix n’incite pas, entre autres, le consommateur à faire le choix du réemploi. Du textile, à l’emballage, en passant par l’électroménager : il est urgent de trouver les clés qui rendront les modèles économiques du réemploi compétitifs et attractifs.
Au niveau européen, un « EU Circular Economy Act » est attendu pour 2026. Il doit s’attaquer à des défis aussi majeurs que les pénuries de ressources, les problèmes de gestion des déchets et la concurrence mondiale. Proposé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et dirigée par Jessika Roswall, commissaire à l’environnement, à la résilience en matière d’eau et à une économie circulaire compétitive, ce texte devra permettre à l’Union européenne à la fois de protéger son environnement, de maintenir son avantage compétitif et de stimuler les investissements dans les technologies transformatrices. Cette loi à venir est porteuse d’espoir pour la Reuse Economy car elle peut permettre de doter l’Union européenne de mécanismes capables de rendre les modèles de l’économie circulaire performants et compétitifs.
Des solutions complémentaires peuvent encore être trouvées du côté des données pour valoriser les modèles circulaires. La directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) impose dès 2024 aux grandes entreprises de mesurer et de publier leur impact sur l’environnement et la société, ainsi que la manière dont les enjeux de durabilité (environnementaux, sociaux et de gouvernance) les affectent. Plus largement, il serait intéressant d’étendre ces mesures à l’ensemble de l’économie. La REuse Economy pourrait valoriser sa contribution à la société, au-delà du financier, avec l’introduction d’indicateurs d’impacts environnementaux et sociétaux en plus du PIB.
Conclusion
Cinq ans après sa promulgation, la loi AGEC reste structurante et a donné une place majeure au réemploi. Elle a permis de faire mûrir les mentalités et de mettre la France sur la voie d’un changement de paradigme crucial en faveur de l’économie circulaire.
Passées les expérimentations, nous devons aujourd’hui transformer l’essai. Il est temps de valider et de déployer massivement ces modèles de mutation en les rendant viables à long terme. Pour cela, nous avons besoin de courage et de stabilité politique pour porter ces sujets et embarquer le marché. Nous avons également besoin de mettre en œuvre une véritable politique de consommation pour transformer en profondeur et simultanément l’offre et la demande. Enfin nous devons penser une Reuse Economy performante qui permette d’assurer un gain complet pour la société. C’est là l’occasion de s’appuyer sur les propositions des deux rapports parus en 2024 (Impact loi AGEC et Performances des REP) et sur le futur « EU Circular Economy Act » prévu au niveau européen en 2026, pour parfaire les règles actuelles et rendre ces nouveaux modèles souhaitables et viables sur le long terme.