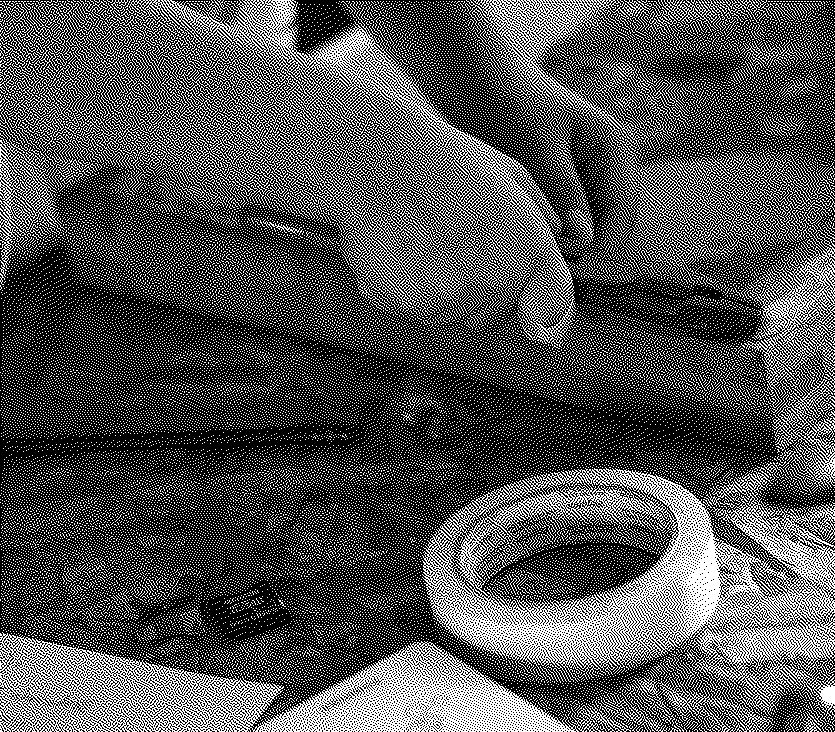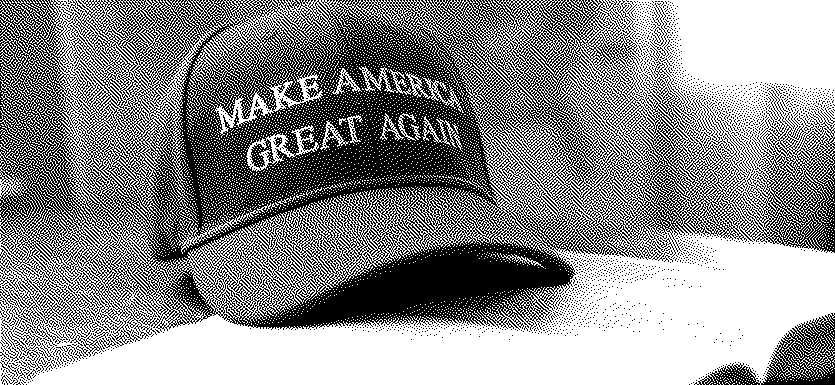La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) fête ses cinq ans. Elle s’inscrit dans une politique publique globale visant à instaurer une transition vers une économie plus durable tout en renforçant notre indépendance stratégique. Cette politique publique globale de soutien à l’économie circulaire a réellement pris forme lors du premier quinquennat d’Emmanuel Macron, à l’initiative de la Secrétaire d’Etat à la Transition Ecologique Brune Poirson. Imaginée avec l’objectif de rendre nos modes de production et de consommation plus durables, elle s’est articulée autour de plusieurs leviers complémentaires et amorcés successivement :
- Une concertation large multi-partie-prenantes menant à l’élaboration d’une feuille de route pour l’économie circulaire (FREC) composées de 50 mesures,
- Une réforme fiscale avec une hausse planifiée de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) visant à rendre les activités d’économie circulaire plus compétitives,
- Une série d’engagements volontaires, à l’image du pacte national sur les emballages plastiques ou les engagements pour la croissance verte (ECV), permettant de mettre en mouvement et en lumière les acteurs économiques les plus engagés,
- Un accompagnement économique des entreprises et des collectivités locales via le plan de relance opéré par l’ADEME et doté d’une enveloppe dédiée aux thématiques économie circulaire.
Loin d’être une législation isolée, la loi AGEC s’intègre donc à un ensemble d’outils visant à favoriser l’économie circulaire développés sous l’impulsion de la Secrétaire d’Etat à la Transition Ecologique. Cette volonté politique affirmée a été l’occasion de positionner la France aux avant-postes Européens en matière de réduction des gaspillages et de promotion de modèles de consommation plus durable. Cinq ans après l’adoption de la loi AGEC, où en sommes-nous réellement ?
Une loi portée dans un contexte socio-économique particulier
La loi AGEC a vu le jour dans un climat social et politique marqué par la crise des gilets jaunes, avec la mise en exergue de la nécessité de concilier transition écologique et pouvoir d’achat. Contrairement à d’autres thématiques environnementales pouvant être perçues comme contraignantes pour les ménages (réduction de la voiture individuelle, limite à la construction pavillonnaire, taxe sur la consommation d’énergie fossile…), l’économie circulaire a cette particularité de pouvoir concilier réponses aux enjeux environnementaux et sociaux. En allongeant la durée de vie des produits, en favorisant le réemploi et la réparation, ou encore en luttant contre le gaspillage alimentaire, l’économie circulaire permet de protéger le budget des Français. Autre particularité forte, en se basant sur la valorisation d’une ressource locale par excellence (nos déchets notamment), elle permet la création d’emplois de proximité difficilement délocalisables, à l’image des centres de réparation, des unités de tri, des usines de recyclage ou encore des ressourceries.
Cette triple promesse – écologique, de pouvoir d’achat et de développement d’emplois locaux – a contribué à son acceptation par une large partie de la population et des acteurs économiques. Elle a d’ailleurs été l’une des seules lois récentes en matière de protection de l’environnement à être votée à l’unanimité des groupes parlementaires, puis à être saluée unanimement par les associations de protection de l’environnement. Toutefois, si les intentions étaient claires et ambitieuses, la mise en œuvre concrète soulève des défis majeurs.
Une mise en œuvre progressive et encore inachevée
Si les 130 articles de la loi AGEC ont posé des jalons essentiels, son application est loin d’être achevée. Certaines mesures phares ont pris du temps à se concrétiser et d’autres ne sont entrées en vigueur que récemment ou le seront dans les prochains mois. Par exemple, l’extension des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) se poursuit, avec l’apparition prochainement de nouvelles obligations pour les emballages industriels et commerciaux. De même, la transformation de l’indice de réparabilité en indice de durabilité, qui vise à renforcer l’information des consommateurs et à inciter les fabricants à concevoir des produits plus résistants, entre actuellement en pratique.
La transformation des modèles économiques de production et de consommation prendra du temps. Cinq ans restent une durée relativement courte pour juger pleinement de l’impact d’une politique publique aussi globale. Il semble donc être prématuré d’en tirer trop de conclusions définitives, d’autant plus que certaines mesures continuent d’être affinées et adaptées aux réalités du marché.
Des angles morts et des défis persistants
Si la loi AGEC représente une avancée indéniable, certains enjeux restent en suspens. L’un des principaux défis concerne la vulnérabilité de notre économie aux facteurs internationaux. La France, comme d’autres pays européens, est confrontée à une concurrence de pays aux normes environnementales et sociales dégradées. Sur les questions d’économie circulaire, cela se traduit notamment par des exportations de déchets encore trop massives vers des pays en développement. Ils peuvent alors être traités à bas prix dans des conditions souvent précaires et néfastes pour la santé des populations locales et l’environnement, quand ils ne sont pas tout simplement brulés dans des décharges illégales ou relargués directement en mer.
Par ailleurs, l’importation de matières recyclées soulève également de nombreuses interrogations. Si le recyclage est un pilier essentiel de l’économie circulaire, il ne doit pas se faire au détriment des conditions sanitaires et environnementales. Or, certains matériaux recyclés entrant sur le territoire français proviennent de pays où les normes et contrôles sont faibles, posant un risque pour la sécurité des consommateurs et celle de l’environnement. Ils peuvent ainsi contenir des substances dangereuses comme les polluants éternels (PFAS) ou encore des retardateurs de flammes (composés pouvant être classés CMR – cancérigène, mutagène ou reprotoxique) qui n’auront pas été bien identifiés et éliminés lors des phases de tri et contamineront la conception de nouveaux produits puis nos environnements et affecteront notre santé.
Peut-être de manière plus criante encore, la montée en puissance des industries liées à l’économie circulaire en France se heurte à une fragilité inhérente à cette concurrence déloyale. Comment investir sur le territoire quand il est aussi simple de se débarrasser de ses déchets en les exportant dans des pays à bas coûts ? La hausse de la fiscalité sur l’élimination des déchets en France n’avait pas pour objectif d’augmenter les exports (légaux et illégaux), mais de créer des filières françaises et européennes vertueuses. La France et l’Europe ne sont pas des îles isolées, mais des économies en pleine compétition. A ce titre, la protection de l’environnement et la santé des populations ne peuvent pas être les variables d’ajustement. Cette situation appelle à une régulation plus stricte des flux de déchets sortant de nos frontières vers des pays en développement et de matières recyclées entrant sur le marché.
Quel avenir pour l’économie circulaire ?
5 ans après, la transformation pour une économie plus circulaire reste un chantier en construction. La loi AGEC a permis d’amorcer un changement de paradigme et de structurer une dynamique autour des évolutions de modèle, mais des défis restent encore à surmonter pour atteindre ses objectifs. Son succès dépendra de la capacité des pouvoirs publics à assurer une application rigoureuse des mesures adoptées, tout en s’adaptant aux évolutions économiques et sociales, ainsi qu’à la réalité d’une mondialisation féroce.
Au-delà du réemploi, de la réparation et du recyclage, les nouveaux modèles économiques ainsi que la gestion des ressources doivent également être développés. Il s’agit de promouvoir l’écoconception, l’écologie industrielle et territoriale qui permet aux collectivités locales et aux entreprises de créer des synergies locales ou encore l’économie de la fonctionnalité qui remplace la vente d’un produit par son usage, luttant ainsi contre l’obsolescence programmée.
L’intégration de critères environnementaux plus stricts dans les accords commerciaux, le renforcement des contrôles sur les flux de déchets et de matières recyclées, ainsi que l’amélioration de l’accompagnement économique des filières françaises sont autant de leviers qui devront être mobilisés pour consolider cette transition. La loi AGEC a posé les bases d’un changement profond, mais il est essentiel de poursuivre cet effort sur le long terme afin d’ancrer définitivement l’économie circulaire dans notre modèle de développement.
En définitive, si les résultats de la loi AGEC peuvent encore être amplifiés, son impact sur la sensibilisation des citoyens et des entreprises, ainsi que sur l’évolution des pratiques industrielles, est indéniable. Dans un contexte politique où les consensus sont de plus en plus durs à trouver, il revient aux décideurs de prolonger cette dynamique et de combler les lacunes existantes pour que l’économie circulaire devienne une réalité pleinement intégrée à notre modèle de société.