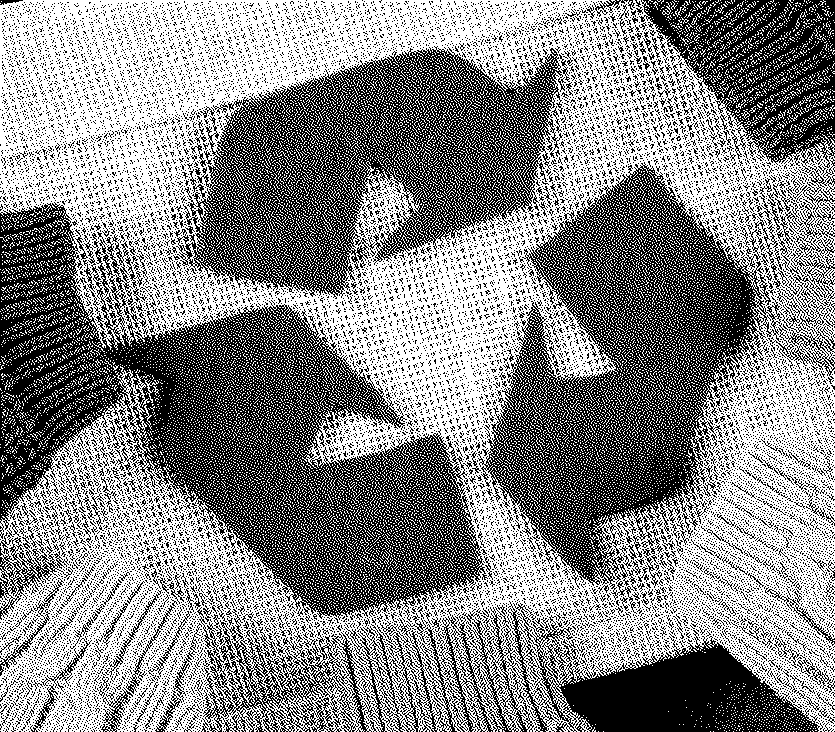La loi AGEC : une mise en œuvre à accélérer
En 2019, élue députée depuis deux ans, je prenais les rênes d’un travail fondateur autour d’une loi qui allait devenir la loi AGEC. Après de longs mois de travail et de concertation avec les acteurs de terrain et les ministères concernés, à l’élaboration de la feuille de route de l’économie circulaire, nous sommes parvenus à retranscrire les éléments législatifs et faire voter cette loi. Elle allait bouleverser le secteur et le préparer aux nouveaux défis et aux nouvelles habitudes qui allaient émerger dans le secteur du traitement des déchets, de la responsabilité des producteurs et, plus généralement, du lent passage d’une économie linéaire à une économie circulaire. Ces travaux ont mis la France à l’avant-garde sur le plan international.
Quelques temps plus tard, convaincue de la justesse de ce combat, je prenais également la tête du Conseil national de l’économie circulaire (CNEC), structure rattachée au Ministère de la Transition Écologique et destiné à coordonner et structurer les efforts nationaux en matière d’économie circulaire avec plus d’une quarantaine d’acteurs (associations, syndicats, entreprises, fédérations, collectivités locales, État, personnalités qualifiées) dans le cadre de l’économie circulaire et, bien entendu, dans l’application de la loi AGEC : le travail effectué et les avis formulé ont montré tout l’engagement des parties prenantes dans ce travail. Cette instance est désormais présidée par Jean-Michel Buf.
Alors que les actions se mettaient progressivement en place, en 2024, j’ai oeuvré pour lancer une mission parlementaire d’évaluation afin de recueillir les avis, mesurer les progrès afin d’aboutir in fine, à des recommandations, des évolutions réglementaires ou législatives, des actions pour accélérer le processus et adapter les dispositifs. Débutée en novembre 2023, en compagnie de mon collègue Stéphane Delautrette, cette mission a présenté ses conclusions en mai 2024 à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Si les avancées et l’évolution culturelle sont indéniables, nous avons également noté des retards, des blocages et des opportunités encore inexploitées.
Une ambition claire, des orientations multiples
Avec ses 130 articles, la loi AGEC reposait sur quatre axes majeurs : réduire les déchets, mieux informer le consommateur, lutter contre le gaspillage et promouvoir le réemploi ainsi que la réutilisation. À ces objectifs s’ajoute un cinquième pilier essentiel : le renforcement de la responsabilité des producteurs, application concrète du principe du « pollueur-payeur ». Ce point est justement central pour engager un profond changement industriel culturel et enclencher la circularité d’une boucle encore trop linéaire jusqu’à maintenant. En effet, il était extrêmement important de pouvoir impliquer les producteurs tout au long de la chaîne de valeur, dès la conception d’un produit et faciliter l’allongement de la vie du produit ou son recyclage. Aujourd’hui, il s’agit de remonter vers une éco-conception plus efficace pour en faire un passage obligé pour les producteurs convaincus que c’est efficace et pérenne !
Dès sa promulgation, nous avons noté un fort engagement des acteurs, tant sur le fond que sur la méthode que nous avions utilisée. Cependant, le temps du législateur, celui de l’acteur économique et les besoins de résultats ne sont pas les mêmes et nous avons vite ressenti le besoin impérieux d’accélérer, massifier et industrialiser les dispositions de la loi. En effet, certaines mesures, bien que prometteuses, restent trop peu appliquées ou peinent à surmonter des obstacles techniques, financiers ou réglementaires, tant au niveau national qu’européen.
Des obstacles systémiques identifiés
Ce travail d’évaluation nous a permis d’identifier deux écueils majeurs qui ont freiné la pleine application de la loi AGEC. Tout d’abord des données parcellaires et tardives : on a constaté un manque de données fiables et actualisées, ce qui, couplé à des objectifs échelonnés sur plusieurs années et parfois flous, limite un suivi rigoureux des avancées. Depuis, le travail de l’Ademe a porté ses fruits. Ensuite, un focus trop centré sur le recyclage : bien que la loi ait créé plusieurs filières à responsabilité élargie des producteurs (REP), leur mise en place simultanée a entraîné une surcharge de travail pour les acteurs concernés. Les efforts se concentrent sur le tri, la collecte et le recyclage, souvent au détriment d’une approche globale de l’économie circulaire incluant la prévention, l’écoconception et le réemploi. C’est un vrai regret mais cela laisse également des marges d’amélioration exploitables par les acteurs concernés qui peuvent également trouver leur intérêt dans ces axes de développement. Par ailleurs, le système est peu dissuasif, si les objectifs n’ont pas été atteints.
Enfin, et ce fut une véritable déconvenue lors notre travail d’évaluation, nous avons perdu une bataille européenne pour ne pas l’avoir menée : certaines dispositions phares de la loi, comme l’indice de durabilité des smartphones, se sont heurtées à des choix de critères au niveau européen qui réduisent l’ambition et l’efficacité de l’indice, notamment la non prise en compte du critère prix ; le portage des combats et ambitions au niveau européen n’a pas été fait de la meilleure des manières. J’ai été extrêmement surprise des auditions qui nous ont permis d’en savoir plus sur le combat européen de nos lois. C’est notamment au cours d’une de ces auditions que j’ai appris que certaines législations européennes ont été élaborées, discutées et votées sans que les émissaires français fassent valoir nos avancées législatives et règlementaires. Une telle légèreté peut avoir pour conséquence une législation européenne parallèle voire contradictoire avec la nôtre ! Par exemple, l’indice de réparabilité vise à favoriser des produits durables et réparables. Cependant, il repose sur des cadres méthodologiques différents en Europe et en France. La France a perdu au profit d’un cadre européen moins exigeant ou moins adapté à ses ambitions environnementales, faisant également courir le risque aux entreprises françaises d’avoir dû adapter leurs méthodes et leur chaine de production vers le mieux-disant alors que le reste du continent a pu se contenter de moins.
Comment accepter, en tant que législatrice, que le travail de la représentation nationale qui , par ailleurs, pour une fois, a été bien accueilli par tous les bancs , puisse être négligé à ce point ? Cela fait justement partie de nos préconisations afin qu’il puisse y avoir une meilleure coordination entre le travail national et le travail européen. Cela engage à redoubler de vigilance pour les prochaines batailles européennes par la représentation française et en faire un portage politique sérieux.
Un bilan mitigé, mais des progrès indéniables
Lors d’un premier rapport de suivi en septembre 2020, seules 5 % des mesures d’application prévues avaient été adoptées. En mai 2024, ce taux atteint 88 %, avec 78 décrets publiés sur les 89 attendus : bien entendu je ne peux qu’être satisfaite par ce chiffre mais, en l’analysant, je le trouve d’une part insuffisant pour répondre aux ambitions de la loi et à un rythme trop lent. D’autre part, les nouvelles filières REP, bien qu’essentielles, peinent à atteindre leurs objectifs. Pour accélérer leur transition vers de véritables « filières de l’économie circulaire », il est indispensable d’aller vers une révision de leur gouvernance tout en maintenant le principe du pollueur-payeur.
100 propositions pour une économie circulaire renforcée
Ce rapport m’a donné l’opportunité de formuler, avec mon co-rappporteur, Stéphane Delautrette, 100 recommandations pour surmonter les blocages identifiés. Parmi celles-ci, une meilleure collecte des données, une clarification des objectifs et des indicateurs, ainsi qu’une montée en puissance des initiatives en faveur de la réduction des déchets à la source. Ce dernier point est central pour engager une baisse, absolument nécessaire, du volume de déchet global puisque comme nous le savons tous, le meilleur déchet est celui que nous ne produisons pas.
Nous ne pouvons clairement manquer cette opportunité que nous offre la loi AGEC d’agir en même temps sur l’écologie et l’économie tout en mobilisant collectivement les producteurs, les consommateurs et les pouvoirs publics : c’est par ce biais que nous pourrons transformer les systèmes de production et de consommation actuels.
L’urgence d’une accélération
Ce travail intense m’a amenée à un constat clair : l’ambition est là et nous pouvons nous en féliciter mais les actions doivent s’intensifier et le portage politique doit revenir sur le devant de la scène. Continuer l’accompagnement nécessaire des investissements, matériels et humains ; accélérer la mise en œuvre des mesures pour l’allongement des produits, le développement des réseaux de réparation, le réemploi, la consigne pour réemploi et recyclage en accompagnant les collectivités ; renforcer la coopération européenne et accélérer la transformation des habitudes de consommation sont autant de défis à relever pour que la France devienne un modèle en matière d’économie circulaire. C’est justement dans cette optique que la loi AGEC est un outil dont tous les acteurs (industriels, associations, consommateurs, collectivités locales, État) doivent impérativement se saisir : un outil qui doit leur permettre de se transformer eux-mêmes, parce que le profond changement dans les modes de production et de consommation doit commencer par un intense changement culturel des habitudes.
L’avenir de la loi AGEC dépend de notre capacité collective à transformer l’essai. Le potentiel est immense, à condition de rester actifs, agiles et créatif afin de faire de cette ambition une réalité concrète.