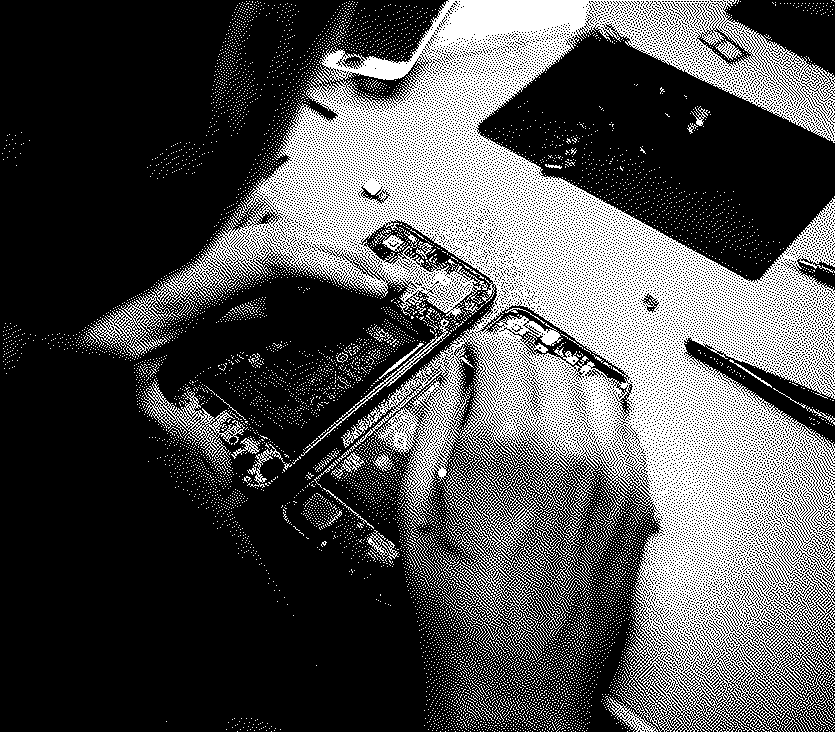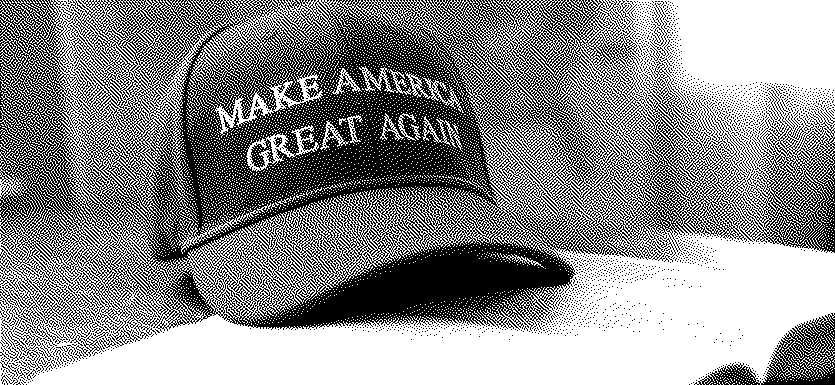La loi Agec a permis de mettre en lumière des leviers essentiels pour accélérer la transition vers une économie circulaire en France, tout en affirmant le rôle stratégique des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) dans cette transformation. Les éco-organismes, véritables bras armés des REP, se sont imposés comme des acteurs incontournables dans la nécessaire refonte des modèles de production, de la consommation et surtout de la gestion des déchets.
Pourtant, ce premier bilan met également en évidence les nombreux défis qui restent encore à surmonter. Du côté de la REP Textile, Linge de maison et Chaussures (TLC), les faiblesses structurelles du cahier des charges entravent le développement de solutions locales, efficientes et pérennes de collecte, de seconde main, de tri et de recyclage – limitant ainsi la capacité de la filière à atteindre pleinement les ambitions d’économie circulaire fixées par la loi.
Dans ce contexte, il devient urgent de repenser en profondeur le modèle économique et industriel de la filière textile & chaussure. Au-delà des ajustements réglementaires, c’est une transformation structurelle ambitieuse qui doit être engagée sous l’impulsion des pouvoirs publics, pour engager une transition environnementale crédible et durable portée par l’ensemble des acteurs du secteur. Il en va non seulement de la réalisation des objectifs environnementaux inscrits dans la loi AGEC, mais également de la crédibilité de la stratégie nationale en faveur d’une économie plus circulaire et plus durable.
Une dynamique vertueuse enclenchée par la loi AGEC, mais insuffisante aux regards des enjeux de la filière REP TLC
Des éco-modulations mal calibrées
L’un des apports notables de la loi AGEC réside dans la mise en place d’un système incitatif de primes/pénalités sur les éco-contributions payées par les metteurs en marché à l’éco-organisme. Cependant, si ces éco-modulations1 visent à encourager l’éco-conception, elles souffrent parfois d’incohérences, notamment lorsqu’elles permettent des éco-contributions négatives. Une telle approche, difficilement justifiable, revient à exonérer certains produits de leur contribution au financement de la gestion de leur fin de vie, en contradiction avec les principes fondamentaux de la REP.
De plus, le cahier des charges des éco-organismes de la REP TLC prévoit notamment une prime pour l’incorporation de matière recyclée dans le processus de fabrication, soumis à un critère de proximité conçu pour favoriser le développement d’une filière de recyclage locale. Cette disposition, prometteuse sur le papier pour réduire la dépendance aux matières vierges et structurer une filière européenne de recyclage, peine pourtant à s’imposer. Les critères fixés apparaissent déconnectés des réalités du marché, limitant leur applicabilité et l’appropriation concrète de cette disposition par les metteurs en marché.
Enfin, l’objectif ambitieux fixé par l’article 5 de la loi — atteindre 100 % de plastique recyclé d’ici 2025 — semble lui aussi irréaliste dans le contexte actuel. Ce décalage avec les capacités industrielles disponibles met en lumière la nécessité d’un réajustement des ambitions et des moyens pour parvenir à des résultats concrets.
Fonds réemploi et réparation : des dispositifs à l’impact limité
La loi AGEC a également introduit des Fonds Réemploi et Réparation dans plusieurs filières REP pour promouvoir la réutilisation et la réparation des produits.
Dans la filière REP TLC, le cahier des charges actuel stipule que le Fonds réemploi et réutilisation, exclusivement destiné aux acteurs de l’ESS, doit représenter 5 % des éco-contributions collectées par l’éco-organisme. Refashion a organisé ce fonds autour de deux axes principaux :
- Un soutien à la traçabilité pour accompagner les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) à se doter de processus et d’outils pour améliorer la traçabilité des gisements collectés et réemployés ;
- Un appel à manifestation d’intérêt (AMI) piloté par les 6 têtes de réseaux de l’ESS et doté d’enveloppes financières dédiées.
En plus de ce dispositif prévu par la loi AGEC et commun à plusieurs filières REP, le cahier des charges de la REP TLC prévoit une enveloppe additionnelle de 77 M€ sur la période 2023 – 2028 destinée à renforcer la ré-employabilité des textiles et chaussures usagés via des actions complémentaires.
Malgré ces initiatives prometteuses, le Fonds réemploi et réutilisation se heurte à plusieurs limites qui entravent son efficacité et son impact réel : des données souvent incomplètes, retardées ou peu fiables, basées sur des estimations, compliquent l’évaluation des impacts, notamment sur les tonnages de réemploi.
S’agissant du Fonds Réparation, le cahier des charges de la filière TLC impose à l’éco-organisme d’allouer progressivement des ressources financières conséquentes (150 M€ sur 6 ans) pour soutenir la réparation des textiles et chaussures.
Dans ce cadre, Refashion a d’abord lancé le dispositif « Bonus Réparation », conçu pour réduire le coût des réparations pour les citoyens. Ce bonus s’applique aux réparations effectuées par des réparateurs professionnels labellisés, répondant aux exigences légales et aux critères de labellisation définis par l’éco-organisme.
En parallèle, Refashion a initié le déploiement du volet « Actions Complémentaires » du Fonds Réparation pour maximiser l’impact du Bonus Réparation, autour de trois objectifs clés :
- Rendre visible le réseau de réparateurs et leur savoir-faire,
- Sensibiliser le grand public à la réparation,
- Accompagner la montée en compétence des professionnels de la filière.
Même si ces initiatives ont permis de lancer le sujet avec des résultats positifs et des objectifs atteints, l’allongement de la durée de vie des produits de la filière ne pourra pas passer uniquement par un bonus sur le coût des réparations. Le dispositif se heurte en effet à plusieurs obstacles propres à la filière TLC : le coût des réparations demeure souvent plus élevé que celui d’un produit neuf, dissuadant ainsi les consommateurs d’y avoir recours ; le maillage des artisans retoucheurs/cordonniers insuffisant en France et un manque de confiance de la part des consommateurs quant à la qualité et à la durabilité des réparations réalisées.
Pour aller plus loin, une approche globale est nécessaire. Il faut encourager l’auto-réparation, former davantage de réparateurs qualifiés, impliquer les metteurs en marché et mieux informer les consommateurs sur les solutions de réparation existantes. C’est à ce prix que la réparation pourra s’ancrer durablement dans les habitudes des Français et contribuer à une véritable économie circulaire.
Une nécessaire harmonisation avec l’affichage environnemental européen
Dans la continuité des mesures visant à mieux informer et responsabiliser les consommateurs, la loi AGEC a cherché à renforcer un dispositif volontaire d’information des consommateurs, imaginé en 2015 déjà avec la loi pour la transition énergétique pour la croissance verte.
Ainsi, la mise en place progressive d’un affichage environnemental pour les produits textiles, révisée par la loi climat et résilience et encadrée par un décret et un arrêté mis en consultation fin 20242, devrait devenir obligatoire dans les années à venir. Son ambition est claire : mieux orienter les consommateurs dans leurs choix d’achat.
L’initiative est intéressante, mais sa mise en œuvre doit faire l’objet d’une véritable réflexion collective. Refashion pointe notamment une méthodologie encore perfectible, avec des critères d’affichage pas suffisamment adaptés aux réalités du marché, ce qui risque d’affaiblir la crédibilité des résultats. À cela s’ajoute une instabilité réglementaire, faute de calendrier clair pour la mise en œuvre obligatoire et d’alignement avec les échéances européennes (PEFCR), prévues pour 2027. Enfin, l’exclusion des chaussures et du linge de maison réduit la portée de l’affichage et crée une iniquité dans l’application des éco-modulations, privant certains producteurs des incitations pourtant prévues par le dispositif.
Repenser les outils de gouvernance et de contrôle des filières REP
L’instauration d’outils de gouvernance et de contrôle au sein des filières REP était une ambition forte de la loi AGEC. Ces dispositifs visaient à garantir la transparence des actions des éco-organismes et à renforcer leur coordination avec les parties prenantes ; mais leur mise en œuvre s’est parfois révélée contre-productive.
Ainsi, le comité des parties prenantes (CPP), conçu pour associer l’ensemble des acteurs de l’écosystème à la gouvernance de la filière, souffre de lourdeurs administratives et peine à produire des résultats concrets. Son fonctionnement, souvent perçu comme un exercice formel, appelle une simplification et une réorientation vers des échanges plus stratégiques et constructifs.
De son côté, le dispositif de suivi des filières REP de l’ADEME (la DSREP) et son interface Syderep, censés garantir la transparence et l’évaluation des performances, gagneraient à être optimisés. Complexes, coûteux et peu intuitifs, ces outils peinent à répondre aux besoins opérationnels des filières.
Si la loi AGEC a permis d’initier des avancées notables et de poser les jalons d’une économie circulaire ambitieuse, les résultats, cinq ans après son adoption, montrent que ces efforts restent insuffisants face aux défis structurels de la filière REP TLC. À ce stade, repenser le modèle et adapter les dispositifs aux réalités du terrain devient indispensable pour assurer une transition réellement efficace.
Une nécessaire transformation structurelle de la filière TLC
La filière REP TLC se trouve aujourd’hui à un tournant décisif, confrontée à une crise structurelle majeure. La saturation des capacités de stockage due à l’effondrement des débouchés internationaux menace de paralyser durablement la gestion des textiles et chaussures usagés en France et en Europe. Pour éviter une impasse, il est urgent d’engager une réflexion profonde et concertée de son fonctionnement.
La crise actuelle met en évidence l’épuisement du modèle basé sur l’exportation de fripes, un système qui dépend de débouchés internationaux de plus en plus incertains. Pour sortir de cette dépendance, la filière doit s’orienter vers une gestion des déchets textiles axée sur la 2nde main en France et en Europe, le recyclage et la valorisation en local.
Amplifier l’impact de la loi AGEC nécessite de rééquilibrer les investissements financiers en allouant davantage de fonds au développement d’une industrie du recyclage. Cette évolution offrirait une opportunité unique de renforcer la souveraineté en ressources tout en accélérant la transition vers une véritable économie circulaire locale. Inspirée d’autres filières REP comme celles des équipements électriques ou de l’ameublement, cette approche permettrait de maximiser la valorisation des textiles usagés et de mieux répondre aux attentes environnementales croissantes.
Cette transformation structurelle passe également par un renforcement de la traçabilité des déchets textiles. Refashion appelle à une application rigoureuse de la législation existante sur la détention, le transport et l’export des déchets, tout en intensifiant les contrôles et en appliquant des sanctions dissuasives en cas d’infraction.
Par ailleurs, le phénomène des « freeriders », ces metteurs en marché échappant à leurs obligations de contribution, continue de fragiliser la filière. Face à ce problème, qui risque de s’amplifier d’autant plus à l’échelle européenne, Refashion appelle à renforcer les contrôles et les sanctions, et à envisager une obligation de vigilance pour les distributeurs et pour les places de marché.
La transition vers un modèle pleinement circulaire aura un impact direct sur les structures de l’ESS, majoritaires dans la collecte et le tri des textiles et chaussures usagés. Ces acteurs seront amenés à adapter leurs activités et leurs processus de travail aux exigences fortes de traçabilité et de priorités environnementales. Pour réussir cette mutation, il semble essentiel d’accompagner le développement de formations dédiées aux métiers émergents : réparation, hygiénisation, reconditionnement, préparation au recyclage et valorisation des matériaux. Ces initiatives doivent tenir compte des profils variés des travailleurs, pour assurer une transition inclusive et durable.
Enfin, l’efficacité de la transformation repose sur une coordination entre les réglementations françaises et les règlementations européennes à venir : mise en œuvre du Règlement éco-conception, révision de la Directive cadre sur les Déchets, Règlement sur le transfert des déchets, Directive Green Claims, etc.
Refashion insiste notamment sur la nécessité d’un affichage environnemental aligné sur le PEFCR Footwear & Apparel3 pour garantir une comparabilité transparente des produits et une information fiable pour les consommateurs. Dans le même temps, l’élargissement des éco-modulations inter-filières, par exemple en intégrant des matières recyclées dans d’autres secteurs comme le bâtiment ou le transport, pourrait accélérer la demande et stimuler l’innovation.
La filière REP TLC ne peut se contenter d’ajustements à la marge : elle doit embrasser une transformation structurelle ambitieuse. En développant un écosystème local et circulaire, en renforçant la traçabilité et les contrôles, et en accompagnant la transition des acteurs, elle peut relever les défis environnementaux et économiques tout en devenant un modèle de résilience. La loi AGEC, si elle s’accompagne des réformes nécessaires, peut alors être le point de départ d’une véritable révolution circulaire.