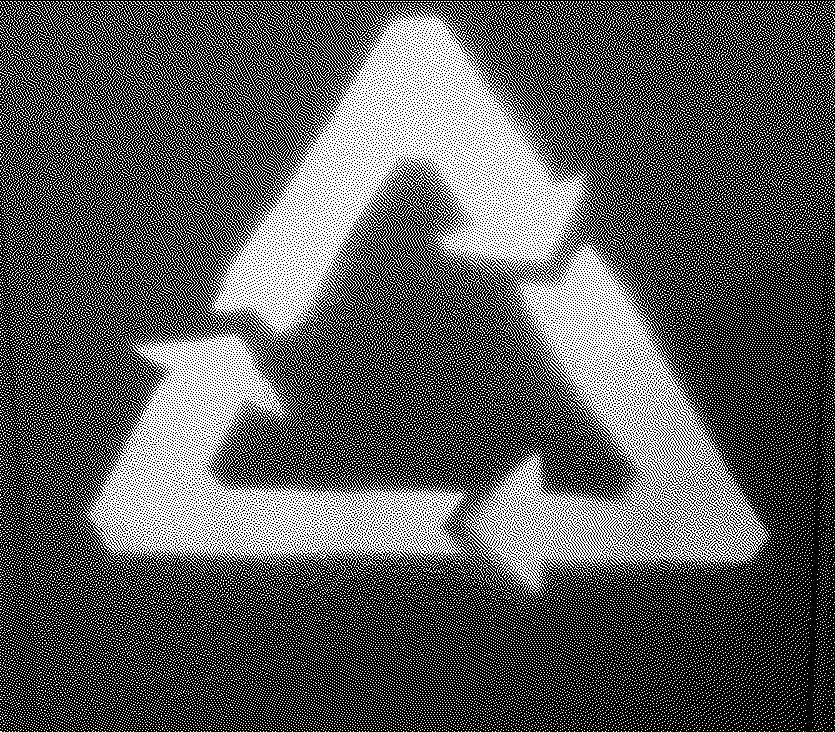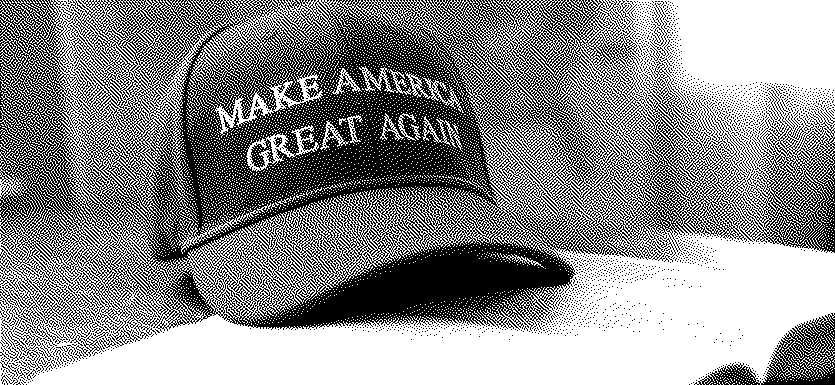Portée par des convictions fortes, la loi AGEC a politiquement changé le regard des pouvoirs publics sur le sujet et influencé le paquet européen pour l’économie circulaire du Green Deal.
Elle n’est pas venue de nulle part, puisque depuis 2015 et l’inscription dans la loi, sur proposition de l’Institut National de l’Économie Circulaire (INEC), d’une définition de l’économie circulaire, les pouvoirs publics et l’écosystème avaient travaillé à la mise en œuvre d’une feuille de route posant les bases d’une vision française de ce modèle.
Après un quinquennat dédié à sa mise en place, force est de constater que les mesures qui en sont issues sont insuffisamment mises en œuvre ou ont largement été revues.
Le destin de certaines mesures emblématiques de cette loi témoigne de ces difficultés.
Qui sait aujourd’hui que la loi AGEC a interdit le Black Friday ? La mesure n’a jamais été appliquée, puisque le véhicule législatif choisi est contraire au droit européen.
Le bonus réparation, formidable outil mais inconnu des consommateurs et des professionnels, peine à trouver son utilité avec, en 2024, seulement 18% d’un budget de 154 millions d’euros effectivement dépensés.1
La mise en œuvre du tri à la source des biodéchets se fait très progressivement avec moins de 40% des Français disposant de solutions de tri en juin 2024 d’après l’ADEME.2
L’affichage environnemental a vu son calendrier et son périmètre d’application ajustés en raison des nombreuses difficultés liées aux méthodes de calcul et pourrait voir bientôt le jour dans un seul secteur : le textile.
La loi a également fixé des objectifs ambitieux de collecte et de réduction de mise sur le marché d’emballages ménagers. Or, dans l’ensemble, les tonnages d’emballages en plastique à usage unique mis sur le marché (ménagers et professionnels) augmentent (+ 3,3 % entre 2018 et 2021)3. Cette tendance à la hausse ne suit donc pas la trajectoire de réduction de 20% en tonnage fixée pour 2025 et plus largement en vue de l’objectif réglementaire de fin de mise en marché des emballages en plastique à usage unique en 2040. Le taux de réemploi est estimé à 0,3 % dans la filière des emballages ménagers, loin des 5 % prévus pour 2023.
D’autres mesures, qui sont à saluer dans leur principe, risquent de déstabiliser des filières circulaires déjà en place. On pense notamment à l’interdiction de destruction des invendus non alimentaires qui, par effet domino, menace les filières solidaires de réemploi, notamment dans le textile, et soulève des interrogations légitimes.
En dressant ce bilan, un constat s’impose : la loi AGEC ne suffira pas sans constance dans l’accompagnement et la mise en œuvre d’un nouveau modèle économique de la circularité.
Cette loi est une amorce, une conviction, elle ne pourra être pleinement effective qu’en bénéficiant du soutien de politiques constantes et ambitieuses en matière de circularité.
Elle est une boîte à outils, qui doit nous donner les moyens de construire l’économie circulaire de demain.
Elle est une loi de bonne volonté, d’incitation, d’encouragement, dont le pilier principal est le consommateur. Son impensé demeure la constitution de l’offre circulaire et sa pérennité face à la concurrence des modèles économiques traditionnels.
Finalement, les changements opérés se concentrent sur l’aval et restent ceux qui heurtent le moins nos modes de consommation classiques. Les mesures concernant l’amont et qui ont le plus d’impact (écoconception & réduction) demeurent largement insuffisantes dans leur application pour permettre une transformation circulaire de l’ensemble des chaines de valeur.
Loin des postures morales qui peuvent affecter le débat sur l’écologie, la nécessité de recourir à l’économie circulaire repose pourtant sur un constat concret : la question de la bonne allocation de nos ressources sera le nœud d’une transition écologique réussie.
Pour dépasser AGEC, il nous faudra une vision et un pilote.
- Une vision : L’économie circulaire comme seul horizon soutenable
- Favoriser une approche intégrée de nos politiques de décarbonation
Faire de l’économie circulaire une réalité en France et en Europe, c’est avant tout réussir notre transition écologique. Climat, biodiversité et économie circulaire forment les piliers indissociables d’une politique environnementale cohérente.
L’INEC a pu en faire la démonstration dans son étude datant de 2022 « SNBC sous contrainte de ressources »4, en modélisant les besoins en ressources nécessaires à la décarbonation de nos économies. Sa conclusion est sans appel : sans prise en compte de l’enjeu de ressources et donc sans déploiement à grande échelle des mécanismes d’économie circulaire, il n’y aura pas de possibilité d’atteindre nos objectifs de décarbonation.
Ici, tout sera affaire de politiques publiques. Pour préserver la ressource et planifier sa bonne allocation dans des secteurs soumis à un risque pénurique à plus ou moins long terme (eau, minerais, sols, biomasse etc.), la puissance publique devra assurer une gestion équitable, sous peine que la ressource aille au plus offrant.
Pour cela, elle devra notamment s’appuyer sur une analyse précise et une quantification des flux, préalable indispensable à une gouvernance efficace.
- Déployer une gouvernance s’appuyant sur une meilleure coopération entre les acteurs
La transformation circulaire de notre économie ne peut s’accomplir que sur l’ensemble des chaines de valeurs. C’est l’une des difficultés majeures de cette transition. Les acteurs volontaires ont peu de chances de succès s’ils se lancent seuls car ils sont partie intégrante d’une logistique et de filières complexes.
La gouvernance de l’économie circulaire doit intégrer ces sujets et favoriser une coopération maximale entre ces acteurs. Elle dispose pour cela de nombreux outils, de l’échelon territorial, comme les Projets alimentaires territoriaux, au niveau national, où les filières REP peuvent constituer le creuset d’une coopération efficace, particulièrement en outre-mer.
Par ailleurs, les mouvements de balanciers institutionnels permanents, découpant les compétences liées à l’économie circulaire entre différents ministères et interlocuteurs ne sont pas de nature à rassurer les acteurs économiques. Pourquoi ne pas créer un guichet unique de l’économie circulaire au sein de l’appareil d’Etat, qui pourrait prendre la forme d’un délégué interministériel par exemple ?
Dans cette grande stratégie de planification des besoins et des débouchés sur l’ensemble de la chaîne de valeur, il convient de ne pas oublier un acteur essentiel, l’Europe.
L’échelon européen, celui du marché unique, est amené à jouer un rôle moteur dans la conduite de cette transformation. L’Europe demeure l’échelon pertinent et l’entité planificatrice par excellence. L’INEC le rappelait dans son « Programme européen pour les ressources »5, publié à l’occasion des élections européennes : l’Union européenne s’est fondée sur les questions de ressources.
A l’heure du retour en force des questions de souveraineté et de maîtrise des ressources, ces enjeux doivent nourrir un nouveau pacte politique européen pour une économie sobre et souveraine. L’objectif : reprendre le contrôle de notre avenir commun tout en garantissant la viabilité de nos modes de vie.
- Un pilote : la puissance publique comme seul garant d’une allocation des ressources démocratique, efficace et juste
- Mobiliser l’outil fiscal et financier comme levier de transformation
Face à des dispositifs issus de la loi AGEC qui n’arrivent pas à démarrer pleinement, l’outil fiscal doit agir comme levier pour rééquilibrer une concurrence, aujourd’hui biaisée, entre des acteurs vertueux et des activités et comportements néfastes.
Cette question, depuis longtemps installée dans le débat public, est entravée par une absence de volonté politique en matière de fiscalité circulaire au vu des phénomènes délétères qui émergent chaque jour. La crise dans le secteur du textile due à l’afflux massif de vêtements issus de la fast fashion en est une illustration criante. La fiscalité doit rapidement s’adapter pour contrer des pratiques qui nous conduisent droit dans le mur. La proposition de loi sur la fast fashion, votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale est un début de réponse, elle doit désormais aller au bout de son parcours législatif.
Il convient également de mieux organiser le soutien aux modèles économiques circulaires à travers le développement d’outils financiers efficaces. L’INEC a pu en faire le compte dans ses « 40 propositions pour une industrie circulaire »6. Livrets, bonus, aides directes ou indirectes, ces dispositifs, encore trop rares, représentent pourtant des leviers importants pour le développement du secteur.
- Soutenir et massifier l’offre circulaire sur le long terme
Derrière les grands desseins, il existe une multitude de blocages, petits et grands, qui illustrent bien la difficulté de faire émerger une activité d’économie circulaire. C’est là que l’action des pouvoirs publics peut être rapidement déterminante.
Comment ne pas citer le cas emblématique du remboursement par la sécurité sociale des aides techniques médicales reconditionnées ? Une mesure votée dans le budget 2020 et qui attend toujours son décret d’application. Derrière ce blocage, c’est une filière entière, constituée en majorité d’acteurs de l’économie sociale et solidaire, qui attend fébrilement la décision d’un des sept ministres de la santé qui se sont succédé depuis.
L’enjeu n’est pas minime et ce cas est évoqué à dessein : le potentiel gisement d’aides techniques de seconde main est considérable, le potentiel d’emplois, non négligeable, et les bénéfices financiers et écologiques, significatifs.
Cet exemple interroge sur la priorité accordée par les pouvoirs publics à assurer la continuité de leurs engagements.
Un effort particulier doit permettre de simplifier le cadre d’action des collectivités et de faire de l’achat public un levier d’économie circulaire. Les initiatives ne manquent pas mais les blocages demeurent nombreux. L’article 58 de la loi AGEC, qui oblige les acheteurs de l’État et des collectivités à acheter un minimum de produits circulaires, pourrait constituer un formidable levier. Il risque pourtant de tomber dans l’oubli, faute de sensibilisation des acheteurs et des élus, qui ignorent jusqu’à l’existence de cette disposition.
D’autres aspects doivent aussi être traités par les pouvoirs publics, de l’accès au foncier pour des modèles peu rentables jusqu’à la formation des métiers en tension liés à la transition, comme celui de réparateur.
Enfin, le pouvoir législatif et réglementaire a un rôle à jouer dans la définition de l’économie circulaire afin d’accroître son impact et limiter les potentiels effets pervers. Qu’est-ce qu’un produit reconditionné ? Peut-il être issu des stocks d’invendus neufs ou produit à plusieurs milliers de kilomètres de nos frontières ? Comment définir le réemploi afin d’y intégrer prioritairement l’économie sociale et solidaire et garantir un traitement efficace des volumes ? Comment permettre au don de trouver toute sa place dans l’économie circulaire sans que certaines pratiques ne viennent déstabiliser des secteurs entiers ?
Autant de questions qui devront être tranchées par la puissance publique.