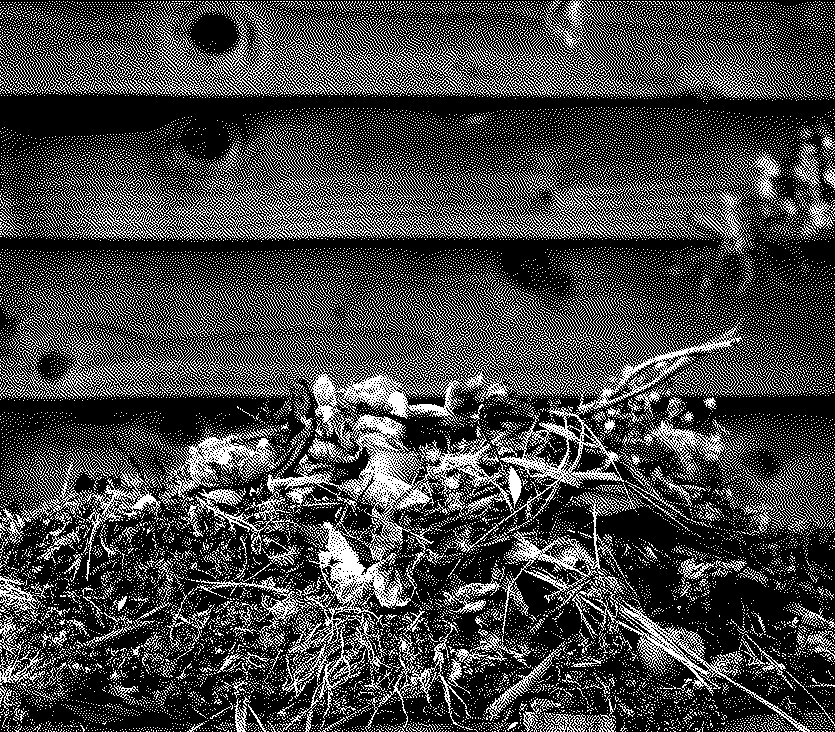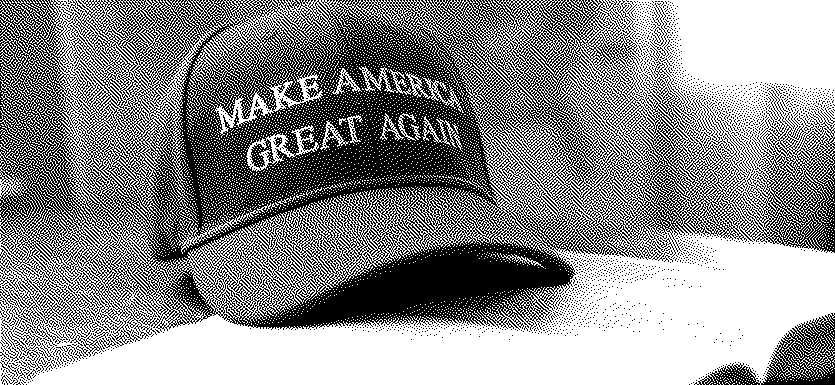En février 2020, l’adoption de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) était largement saluée comme une avancée significative en faveur de la réduction et de la valorisation des déchets.
Objectifs de réduction des déchets, interdiction d’un certain nombre d’objets en plastique à usage unique, soutien au réemploi et à la réparation, tri des déchets alimentaires… la loi AGEC couvre un large périmètre en matière d’économie circulaire, y compris dans des domaines jusque-là peu présents dans les politiques publiques.
Pourtant, cinq ans après son adoption, force est de constater que sa mise en œuvre n’a pas été à la hauteur de ses ambitions prometteuses : un certain nombre de mesures ont été retardées voire abandonnées, quand d’autres ont perdu de leur substance au gré du processus réglementaire, notamment sous l’action de certains lobbys.
Le principe pollueur-payeur, un tigre de papier
La loi AGEC fixait comme objectif de consolider le cadre dit des filières à « responsabilité élargie du producteur » (REP), qui traduisent le principe pollueur-payeur dans le domaine de la gestion des déchets, en imposant aux entreprises mettant sur le marché des produits de financer, filière par filière, leur fin de vie. En fixant de nouveaux objectifs aux filières préexistantes et en créant 11 nouvelles filières (emballages professionnels, déchets du bâtiment, jouets…), la loi AGEC venait conforter le principe pollueur-payeur.
Malheureusement, si le principe des filières REP est pertinent et vertueux, leur impact concret sur la réduction et le cycle de vie des déchets est loin d’être aussi satisfaisante. Plusieurs limites inhérentes à leur fonctionnement et à leur gouvernance entravent en effet l’efficacité du système.
Les différentes filières et leurs éco-organismes (les entités chargées de collecter les éco-contributions des entreprises commercialisatrices et de financer la fin de vie des produits) se voient bien fixer des objectifs à atteindre en matière de collecte, de réemploi et de recyclage au travers de cahiers des charges fixés par l’Etat. Las ! La non-atteinte des objectifs n’entraîne aucune pénalité directe. Le seul mécanisme de sanctions financières prévu est à la discrétion de l’Etat.
Ainsi, dans les quatre filières pour lesquelles des données sont disponibles, les quantités réemployées ou réutilisées sont jusqu’ici inférieures aux objectifs1. Pourtant, seul l’éco-organisme en charge de la filière des mégots a reçu une sanction financière.
Or si la non-atteinte des objectifs réglementaires n’entraîne aucune conséquence fâcheuse, comment espérer que des entreprises s’y soumettent ? Et même du point de vue des entreprises concernées, est-il bien sécurisant que les sanctions soient à la discrétion du gouvernement ?
Je plaide donc pour que le cadre des filières REP évolue pour prévoir des pénalités financières automatiques et prévues à l’avance en cas de non-atteinte des objectifs de réduction, de réemploi et de recyclage des déchets qu’elles produisent.
Les contributions des éco-organismes au réemploi doivent ainsi significativement augmenter pour remplir les objectifs fixés, notamment en soutenant les acteurs du réemploi solidaire : les nombreuses ressourceries et recycleries animées par des associations et des structures de l’économie sociale et solidaire partout sur le territoire jouent un rôle clé en la matière, sans bénéficier des financements correspondants.
Les objectifs de réduction méritent également une attention toute particulière, car ils doivent être réaffirmés comme la priorité première. Et si une partie des objectifs de tri repose sur les consommateurs-citoyens et les moyens déployés par les collectivités territoriales, il n’en va pas de même pour les objectifs de réduction à la source des mises sur le marché, qui dépendent avant tout des industriels.
La réduction à la source, le parent pauvre
La loi AGEC a fixé des objectifs de réduction des produits mis sur le marché pour un certain nombre de filières. Ainsi, la filière des emballages ménagers a pour objectif de réduire de 15% les mises en marché d’emballages ménagers d’ici à 2030 par rapport à 2010. Pourtant, à date, les emballages ménagers mis sur le marché ont augmenté de 7%2 par rapport à 2019. Pour l’instant, nous prenons donc le chemin inverse.
On pourrait également citer la filière de l’électroménager, qui n’en a pas encore terminé avec l’obsolescence programmée, malgré les progrès à mettre au crédit de la loi AGEC en matière d’incitation et de soutien à la réparation.
Autre exemple, la filière textile : les quantités de vêtements mises en marché ont explosé avec l’avènement de la fast fashion. Ainsi, entre 2021 et 2022, les quantités de textiles mises sur le marché ont bondi de 16%3 pour atteindre près de 819 000 tonnes de textiles, linges de maison et chaussures mises en vente en France.
Il est urgent d’agir pour endiguer ces flux de produits superflus ou de très mauvaise qualité, dont les prix bas sont le reflet du dumping social et environnemental, et qui pour certains deviennent des déchets avant même d’avoir été vendus !
Cela passe par l’instauration d’éco-contributions dissuasives sur ces produits. Outre la réduction de l’impact écologique des différentes filières et de nos modes de production et de consommation, une telle politique aurait l’avantage de favoriser les fabricants français et européens, qui respectent des normes sociales et environnementales plus exigeantes.
Cela implique également des normes plus strictes sur l’éco-conception des produits, ainsi que sur l’information fournie aux consommateurs au sujet de l’impact environnemental (émissions de gaz à effet de serre, atteintes à la biodiversité, consommation d’eau, de matières premières…) des produits mis en vente.
En ce qui concerne les emballages, cela passe également par l’interdiction des emballages superflus et le retour de la consigne, avec le développement de contenants réemployables et standardisés, dont l’utilisation doit progressivement devenir obligatoire. Compte tenu des importants coûts d’investissement initiaux en jeu et de la nécessité de mutualiser les infrastructures de collecte, de logistique et de lavage, cela ne pourra se faire sans une implication forte de l’Etat.
Quand l’Etat se met hors la loi
Au-delà des filières dont la naissance est longue et dont l’efficacité questionnable, certaines sont tout bonnement détricotées avant même leur création. C’est notamment le cas de la filière des textiles sanitaires à usage unique (TSUU). Les déchets de cette filière (lingettes, couches, protections hygiéniques, essuie-tout…) représentent un poids significatif de 35 kg par Français.es et par an et sont en quasi-totalité incinérés ou enfouis.
Or, le périmètre de la filière a été largement mis à mal. Ainsi, le cahier des charges a été publié en catimini fin 2024 en l’absence de gouvernement et malgré une opposition d’une large partie des associations d’élus, environnementales et d’acteurs de la filière à son contenu.
En effet, le cahier des charges prévoit la création d’une filière REP pour les seules lingettes, soit seulement 1% des textiles sanitaires à usage unique, au mépris de la loi AGEC ! Pourtant, en ce qui concerne les couches par exemple, des alternatives existent : de nombreuses collectivités dont Paris expérimentent ainsi les couches compostables, qui disposent d’une filière de valorisation, mais doivent être soutenues pour pouvoir se généraliser.
Les déchets alimentaires, un gisement considérable
La loi AGEC a créé l’obligation pour les collectivités locales de proposer une solution de tri des déchets alimentaires à leurs habitants à compter du 1er janvier 2024, une disposition pertinente et nécessaire compte tenu du très faible taux de tri de ces déchets en France, contrairement à d’autres pays européens nettement plus avancés en la matière, qui représentent un gisement considérable : environ 30% des poubelles des ménages sont composées de déchets alimentaires !
Cependant, 1 an après l’entrée en vigueur de cette obligation, moins de 40% des Français bénéficient aujourd’hui d’une solution de tri.
Cela n’est guère étonnant : si un certain nombre de collectivités très volontaires se sont fortement impliquées, beaucoup se sentent démunies face à la complexité technique et organisationnelle de la tâche, et à l’absence de soutien financier de l’Etat (le principal dispositif de soutien, le Fonds Vert, géré par l’ADEME, ayant été sabré dans les derniers budgets). L’Etat est non seulement absent financièrement, mais aussi en termes de communication. Aucune campagne de sensibilisation nationale n’a ainsi été organisée depuis 1 an. Aucune obligation n’est faite non plus aux metteurs sur le marché de denrées alimentaires (supermarchés par exemple) de communiquer auprès de leurs clients sur les solutions de tri des déchets alimentaires sur leur territoire.
La bonne volonté des citoyens et des collectivités ne suffira pas si les acteurs disposant des moyens de communication et de sensibilisation les plus importants ne s’y impliquent pas.
***
La loi AGEC a ouvert une voie, mais depuis 5 ans trop peu de chemin a été parcouru. L’économie circulaire offre pourtant de nombreuses opportunités : celle de réduire l’impact écologique de nos modes de production et de consommation bien sûr, mais aussi celle de corriger les dérives d’une économie linéaire, encourageant le dumping social et environnemental, où les prix bas attirent les consommateurs au détriment de l’emploi et de la planète. Il n’est pas trop tard pour changer de braquet, mais il est urgent d’agir à tous les niveaux.
A son échelle, la Ville de Paris s’est fixé l’objectif de réduire d’ici 2030 de 100 000 tonnes le volume de déchets produits chaque année sur le territoire parisien à travers une nouvelle stratégie adoptée en décembre 2024. Pour y parvenir, il faudra néanmoins que la loi AGEC remplisse elle aussi ses objectifs d’ici là !