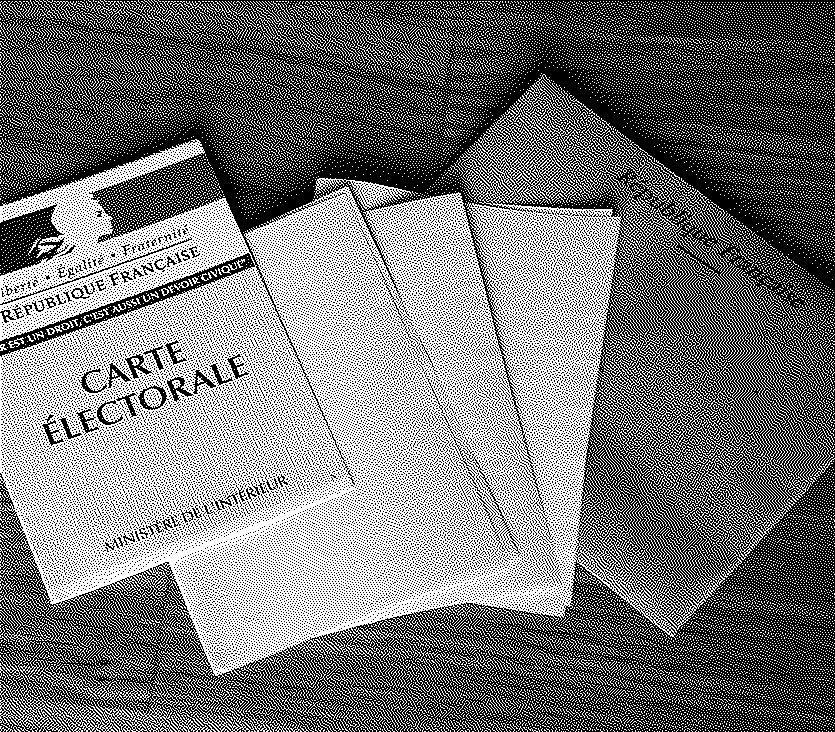Lire la réponse de Thierry Pech
Les enjeux politiques majeurs d’aujourd’hui se décrivent à partir d’une série d’opposés : Europe/anti-Europe, Ukraine/Poutine, coproduction de biens publics/redistribution publique de biens privés, politique migratoire européenne raisonnée /obsession nationale positive ou négative du migrant… Ces clivages engendrent sur notre continent une opposition logique entre progressistes et réactionnaires.
En France, la mouvance réactionnaire, animé par le Rassemblement national (RN) et La France insoumise (LFI), se retrouve sur ces enjeux. Il voudrait aussi revenir en arrière sur tous les points qui ont fait l’objet de réformes, plus ou moins récentes. Son atout est un populisme débridé fondé sur des simplismes, là où la complexité pourtant s’impose. Il ne se soucie pas de développement mais uniquement de redistribution mécanique illimitée, qui ruinerait au passage les finances publiques. En politique étrangère, en dépit de cache-sexe microscopiques, chacun sait que les connivences de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon avec les pires despotes de la planète n’ont pas disparu. Leurs discours reposent enfin sur des communautarismes ethnoreligieux, celui des « souchiens » « judéo-chrétiens », pour l’une, de l’islamisme, pour l’autre. Ils espèrent que la somme de leurs clientélismes respectifs leur offrira une majorité. On retrouve cette forte convergence tant dans la similitude entre le projet législatif du RN et la contribution de LFI à celui du Nouveau Front Populaire. Tout cela, joint à leurs approches autoritaires dans des domaines touchant au caractère républicain de l’État (Etat de droit, séparation des pouvoirs, libertés civiles), laisse penser, que, au-delà des mesures réactionnaires, c’est une posture d’inspiration totalitaire qui se profile.
Simultanément, les mutations actuelles touchent les deux partis de gouvernement historique, PS et LR. Sur les grands sujets d’aujourd’hui, qui, pour certains, ont été pris à bras le corps par Emmanuel Macron depuis 2017, avec pour conséquences de créer contre lui de puissantes alliances corporatistes, les deux vieux partis n’ont clairement rien à dire et ils l’ont prouvé : la force actuelle du RN repose sur le fait qu’il est le seul parti d’opposition qui ait tiré parti de sept ans de continuité gouvernementale. Ni la gauche, ni la droite n’ont progressé depuis 2017. Pour espérer survivre, pensent les dirigeants de ces partis, être conservateur ne suffit pas : il faut être réactionnaire et compenser sur les marges ce qu’on perd au centre, d’où la très forte tentation pour le bloc PS-LR de se faire satelliser par les extrêmes. Olivier Faure, Sandrine Rousseau et leurs amis ont donné l’exemple en 2022 en faisant du PS et d’EELV des succursales ancillaires de LFI. Leur nouveau disciple, Éric Ciotti, s’est lancé dans un processus symétrique en se mettant au service de Marine Le Pen.
Le problème de cette stratégie est que, si elle présente une certaine rationalité pour des politiciens cyniques, elle ne convient pas forcément aux citoyens, qui comprennent depuis un moment que le deal qui a organisé l’opposition gauche/droite pendant un siècle et demi, la liberté contre l’égalité, n’a plus de sens. La scène politique se partage donc non en trois blocs : (extrême) gauche, centre, (extrême) droite, mais en trois mouvances : progressiste, conservatrice et réactionnaire.
Ce qu’on appelle clarification est donc la réponse à la question suivante : voulez-vous revenir à un rapport gauche/droite, malgré son obsolescence et valider les contorsions et les brouillages que cela implique ou voulez-vous assumer un autre type de découpage, fondé sur des orientations plus pertinentes ?
La mutation s’est déjà produite en douceur dans la plupart des pays occidentaux, notamment ceux qui, grâce à la proportionnelle s’ajustent en permanence à la dynamique du débat public. Si cette configuration se mettait en place dans la vitesse de croisière de la vie politique française, cela se traduirait par le renvoi dans les cordes du bloc réactionnaire et une alternance entre conservateurs et progressistes sur la base de coalitions variables. Les partis peuvent eux aussi, en effet, se déplacer sur cet axe. En Allemagne, le SPD, les Verts et les Libéraux ont ainsi conclu une alliance de gouvernement sur un programme qui s’inscrit dans un progressisme contemporain. Deux ans et demi après sa constitution, elle a obtenu aux dernières Européennes 31% des voix, contre 29% pour l’opposition conservatrice CDU-CSU.
En France aussi on peut imaginer, surtout bien sûr si la proportionnelle finit par être adoptée, une palette d’alliances possibles qui proposeraient différentes manières de combiner une part de progressisme et de conservatisme, sachant que les partis peuvent évoluer : ainsi les Verts français, qui ont réussi à se faire rejeter par les électeurs alors que la conscience écologique n’a jamais été si forte dans la société, pourraient fort bien se libérer des TOC de l’extrême gauche et devenir un parti progressiste comme les Grünen ont su le faire en Allemagne.
La dynamique de clarification est bien en cours. Il y a au moins quatre moments pour la faire avancer à l’occasion de ces législatives : les alliances électorales, le vote du premier tour, le vote du second tour et les coalitions à l’Assemblée. Le premier acte se termine dans une certaine confusion, avec un LR fracturé et, d’après les sondages, seulement la moitié des sympathisants socialistes ou écologistes prêts à voter pour le Nouveau front populaire. Le scrutin reste ouvert. Si, par exemple, les électeurs de Raphaël Glucksmann et de Yannick Jadot ou des modérés de LR-canal historique sont cohérents, ils écarteront les extrêmes et renforceront, non tant le « camp » présidentiel que la possibilité d’un gouvernement, aux contours à définir, qui échappe au bloc réactionnaire constitué par RN et LFI. Et s’ils envoient au parlement suffisamment de députés capables de se situer dans cette perspective, la dissolution aura bien fait progresser la vie politique en la mettant au diapason de ce que les citoyens demandent.